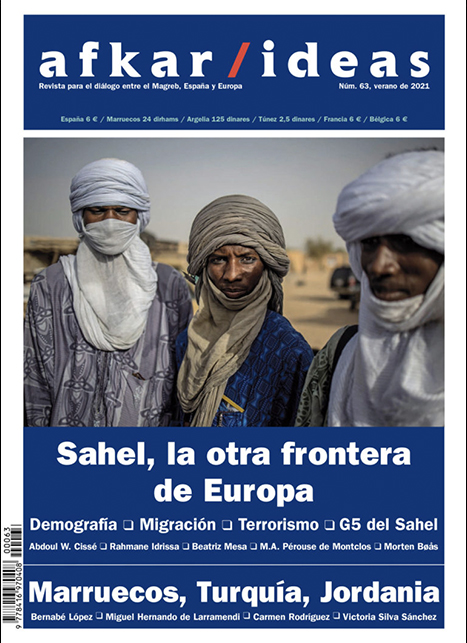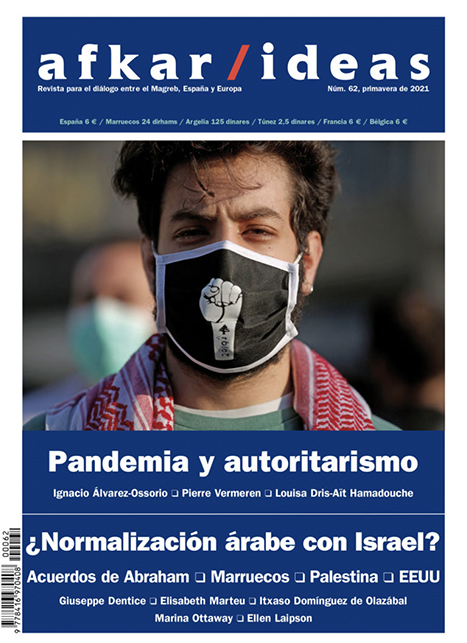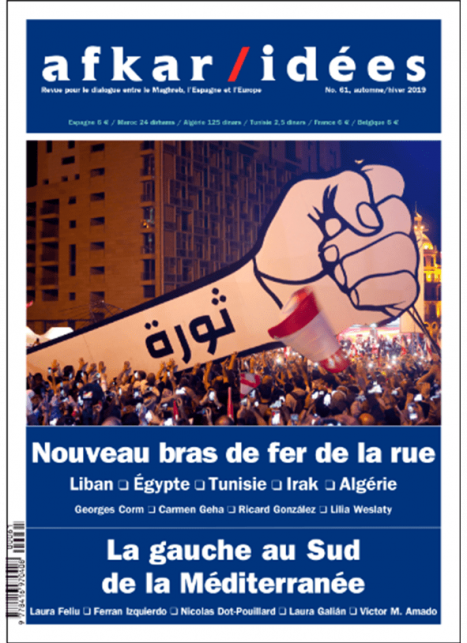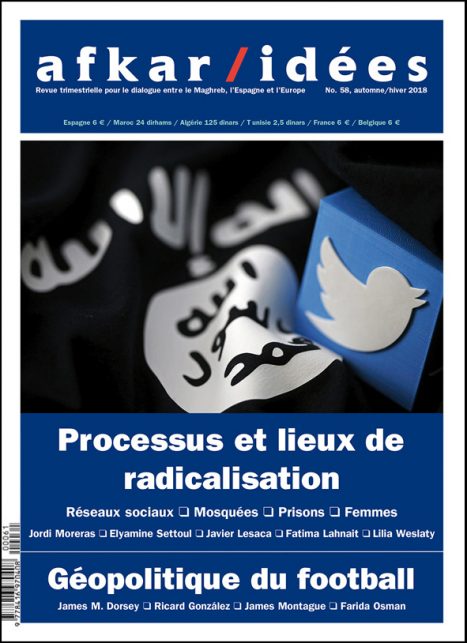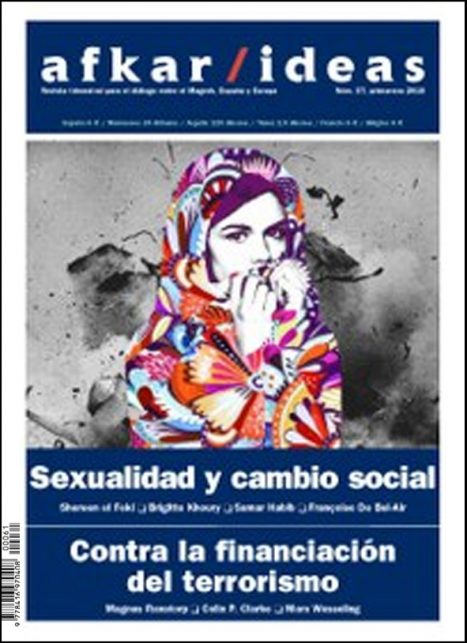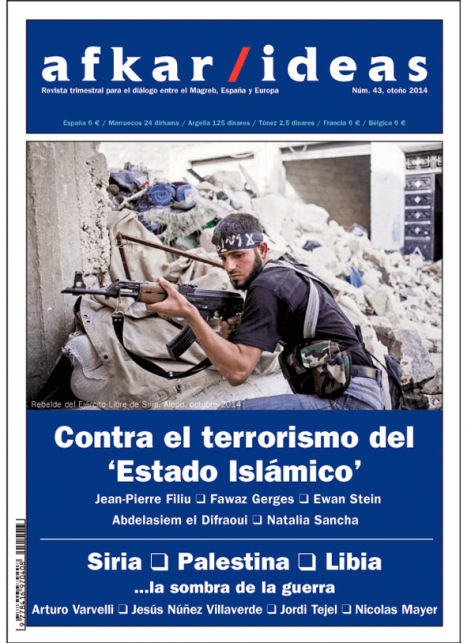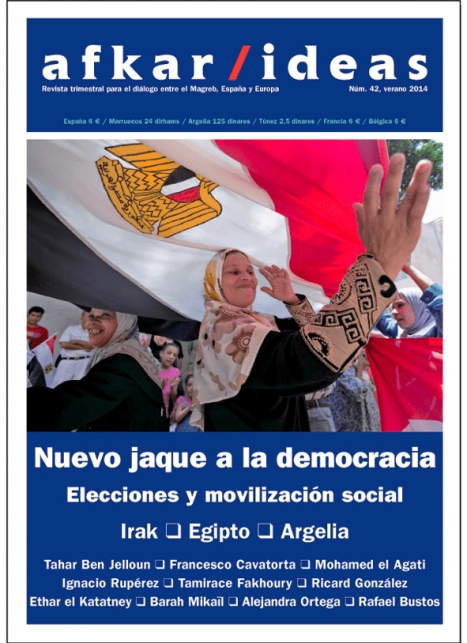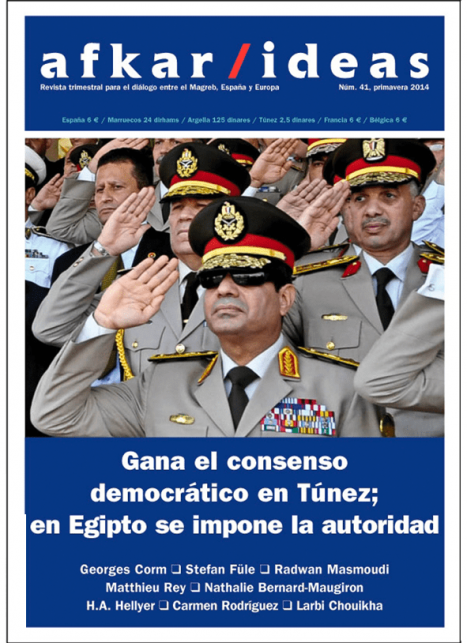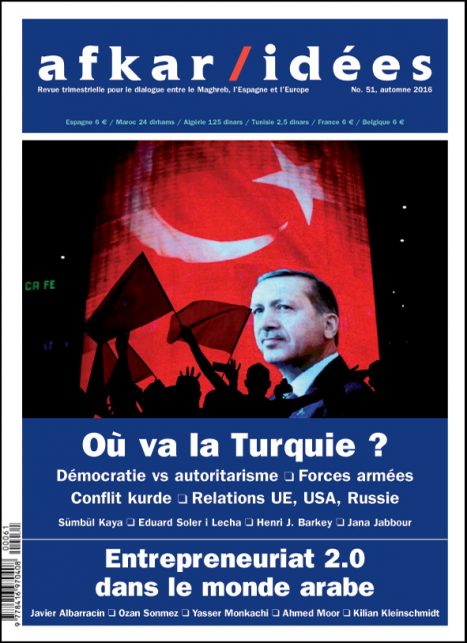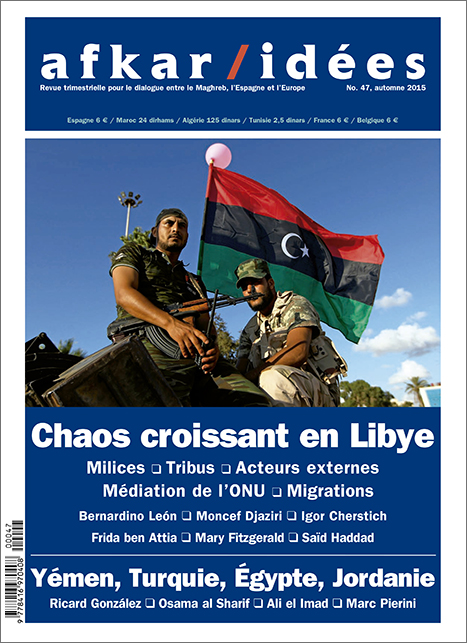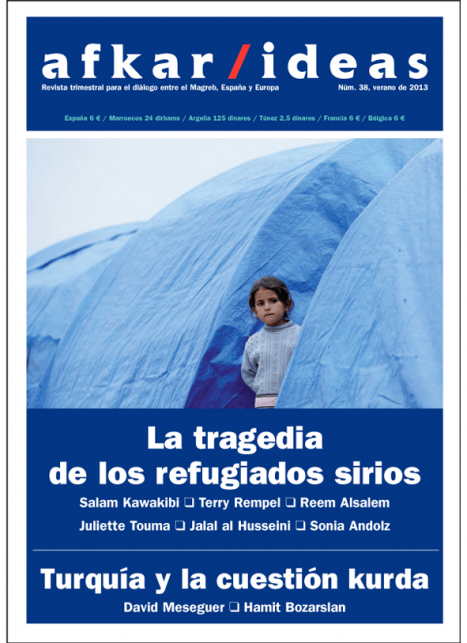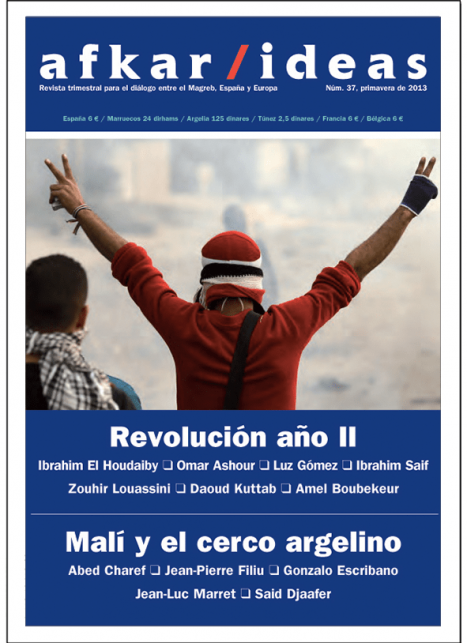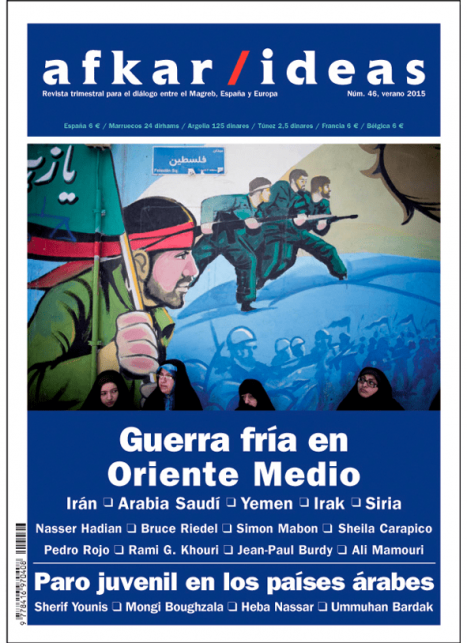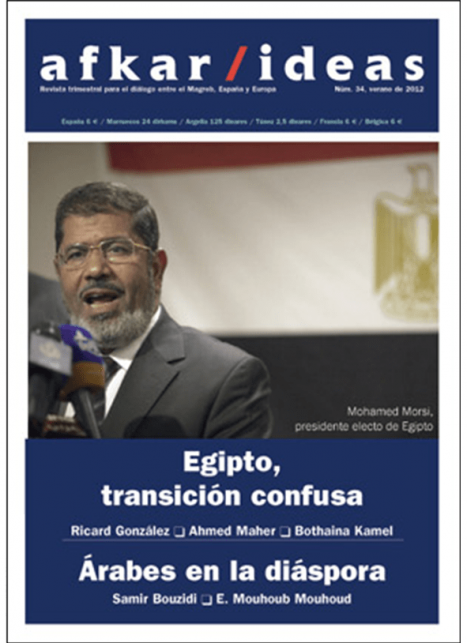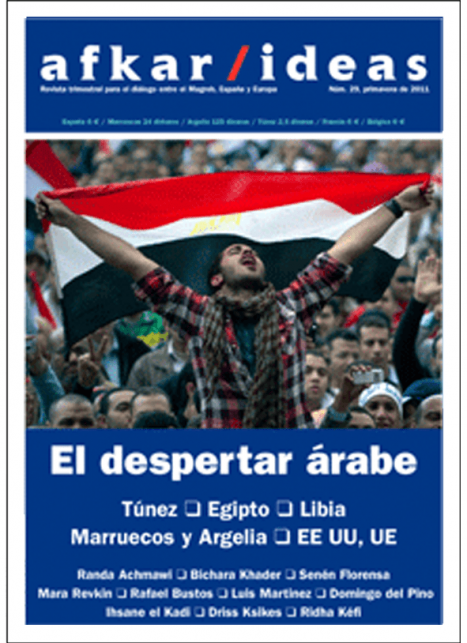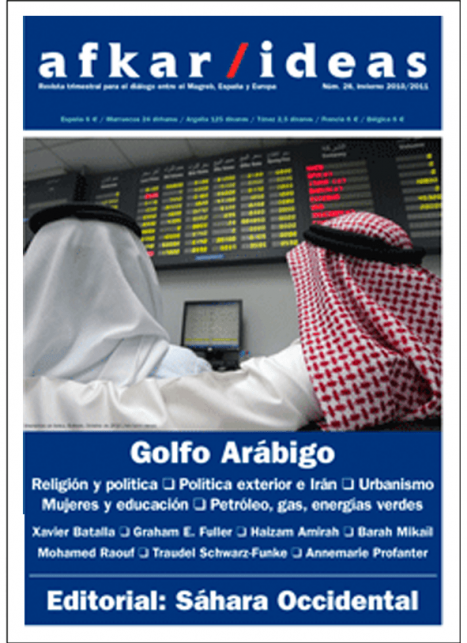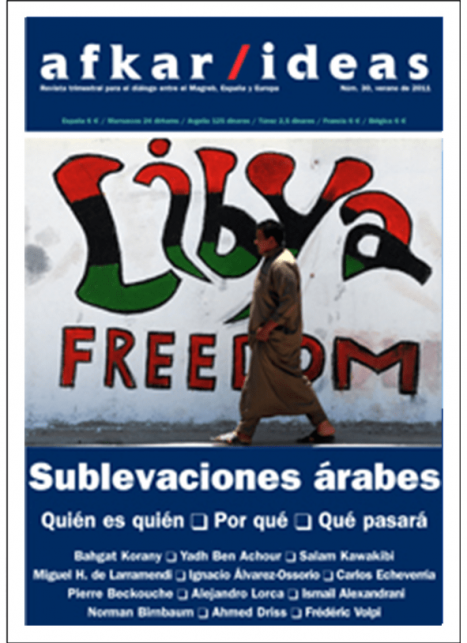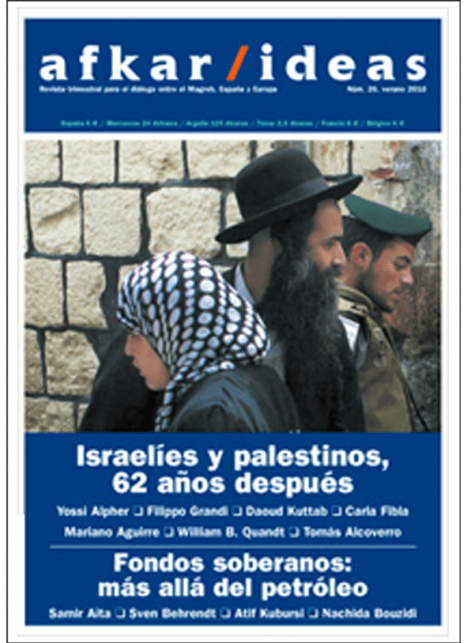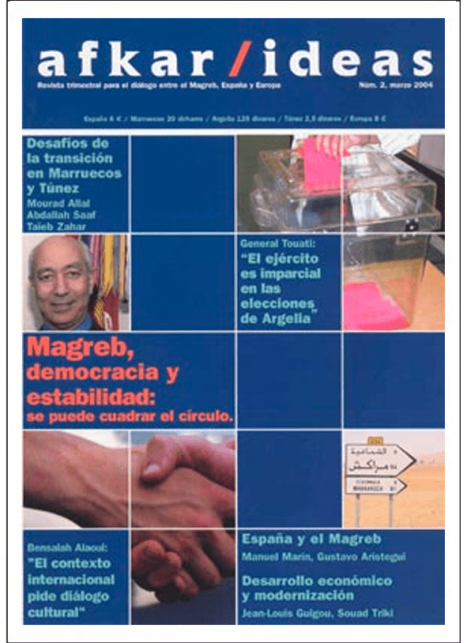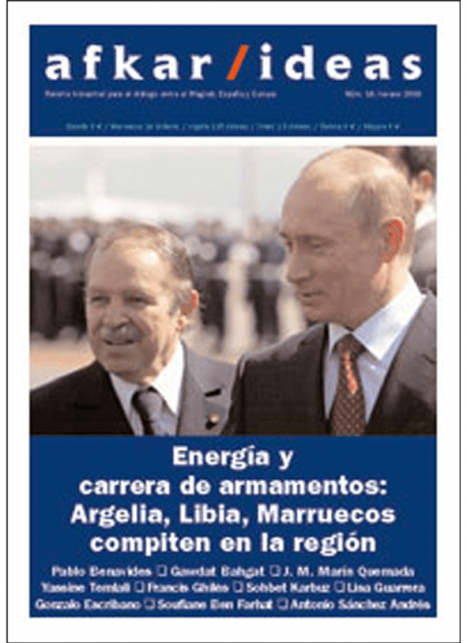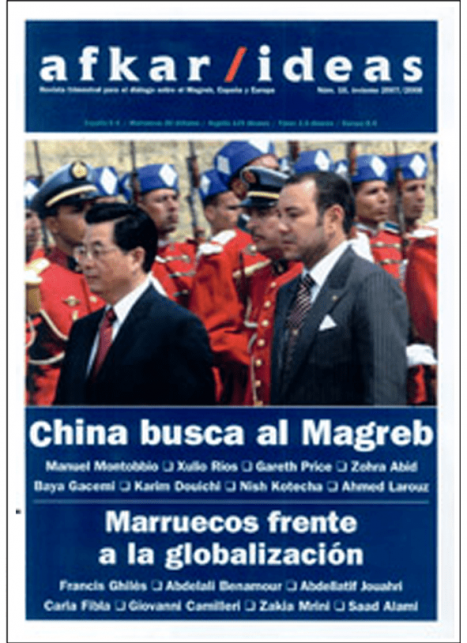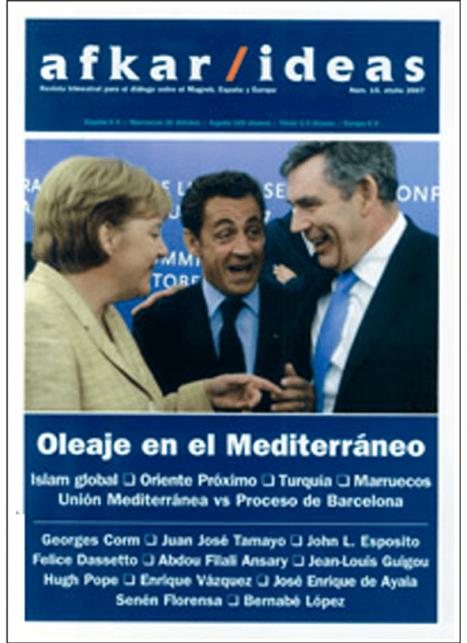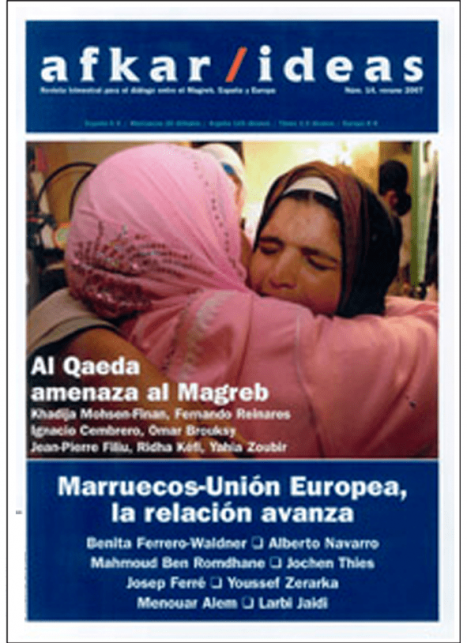Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Une géopolitique de l’impunité : entre Gaza, la Cisjordanie et le monde
À Gaza, ce n’est pas une catastrophe humanitaire qui se déroule, sous l’œil des caméras, mais un projet politique d’élimination. Les chiffres des morts, des blessés et des déplacés, bien que bouleversants, ne suffisent pas à décrire ce qui se passe. Car ce n’est pas seulement de la violence qui se déploie, mais aussi une logique soutenue de dépossession, qui n’a pas commencé en octobre 2023 et qui ne s’arrête pas aux frontières de la bande de Gaza.
Le discours international dominant a tenté de présenter la guerre à Gaza comme un tournant. Mais plus qu’un avant et un après, on assiste surtout à la consolidation d’un régime fondé sur la fragmentation du peuple palestinien, sur l’impunité juridique de son occupant et sur une architecture internationale qui, lorsqu’elle ne le soutient pas, le tolère.
Gaza s’est effondrée, emportant avec elle la promesse que le système international peut garantir des droits, la protection et la justice dans des conditions d’occupation permanente.
La même violence – devenue incontestable à Gaza – traverse la Cisjordanie, s’intensifie contre les Palestiniens de 1948, se projette sur la diaspora et se réactive là où le discours hégémonique commence à vaciller, à savoir dans les universités, les parlements, les syndicats et les médias. L’exception palestinienne ne réside pas seulement dans son histoire, mais dans le type de silence qu’elle parvient encore à imposer.
Face à cela, la réponse d’une grande partie du Nord global a oscillé entre une indifférence active et une complicité déclarée. L’Europe et les États-Unis ont érodé encore davantage leur légitimité en tant que références normatives en appliquant, avec cynisme, une légalité sélective. Pendant ce temps, dans le Sud global, une autre position commence à se faire entendre, une position qui ne découle pas, pour l’essentiel, d’un calcul géostratégique immédiat, mais d’une identification historique à la mémoire coloniale et à l’inégalité structurelle. Il s’agit de celle de l’Afrique du Sud devant la CIJ, de l’Amérique latine retirant ses ambassadeurs, des collectifs africains, asiatiques et caribéens réactivant des réseaux de solidarité : une lutte est ouverte pour redéfinir le sens de la justice internationale, et la Palestine en est le centre.
GAZA : MORT EN BOUCLE
Depuis octobre 2023, Gaza a été transformée en un espace de destruction systématique à une échelle difficile à concevoir. L’objectif principal de ce que l’on a appelé la « réponse militaire israélienne » n’était pas la neutralisation des capacités armées, mais la dévastation de la vie même : habitations, hôpitaux, écoles, universités, réseaux d’eau et d’électricité, archives, cimetières, êtres humains.
Les Nations unies ont qualifié la situation d’ « enfer humanitaire ». Des experts en génocide ont alerté sur des schémas d’extermination. La CIJ a reconnu l’existence d’indices raisonnables de violations graves du droit International ; plus encore, du crime de génocide, comme l’affirment des dizaines de juristes de renom.
Gaza continue néanmoins d’être trop souvent traitée comme une exception géopolitique où tout devient justifiable, dès lors que c’est formulé dans le langage de la sécurité, que ce soit celle d’Israël ou celle de la région. Il ne s’agit pas seulement du nombre de morts – qui dépasse déjà les 53 000 (même si l’on soupçonne que le chiffre réel est bien plus élevé, notamment si l’on tient compte des morts indirectes) – ni du déplacement forcé de presque toute la population. Il s’agit d’une logique soutenue d’élimination.
Élimination physique, mais aussi politique, culturelle et du savoir : archives détruites, universités bombardées, bibliothèques et hôpitaux rasés. Gaza est présentée comme étant « inhabitable », alors qu’en réalité, elle a été systématiquement transformée en un lieu où il est interdit d’habiter. Le discours officiel israélien a recours à la catégorie de « bouclier humain » pour justifier chaque attaque. Mais cette stratégie de communication ne cache pas sa cohérence avec des décennies de punition collective. Depuis 2007, Gaza est soumise à un blocus terrestre, maritime et aérien qui restreint l’accès aux biens de première nécessité, qui empêche la reconstruction et qui limite les conditions minimales de vie. L’offensive qui s’est intensifiée jusqu’à un niveau maximal en 2023 n’est pas en rupture avec cette politique : elle en est l’aboutissement logique. Face à cette réalité, la communauté internationale a déployé une double réponse : d’une part, des déclarations de préoccupation sans véritables conséquences juridiques ou politiques ; et d’autre part, un approvisionnement constant en armement et en financement, et une couverture diplomatique à Israël par des pays tels que les États-Unis, l’Allemagne ou le Royaume-Uni.
CISJORDANIE : EXPANSION COLONIALE ET FRAGMENTATION POLITIQUE
Pendant que Gaza brûle sous les bombardements, un autre type de violence – moins visible, mais tout aussi létale – se consolide en Cisjordanie. Il s’agit d’une architecture d’occupation qui combine présence militaire, expansion territoriale et fragmentation administrative pour neutraliser toute forme de vie palestinienne autonome.
Depuis octobre 2023, ce processus s’est accéléré. Le nombre de Palestiniens tués par l’armée ou par des colons armés a dépassé celui des années précédentes, même en l’absence de ce que l’on considère habituellement comme des affrontements ouverts. Les incursions nocturnes sont devenues routinières. Les postes de contrôle, les démolitions et les arrestations massives renforcent une politique d’asphyxie constante. Les colons, protégés et souvent accompagnés par l’armée, agissent avec une impunité de plus en plus explicite.
L’expansion des colonies illégales a continué de progresser sans entrave, tandis que l’État israélien légalise rétroactivement de nouvelles constructions et permet l’expulsion forcée de communautés palestiniennes entières. La violence des colons n’est ni anecdotique ni marginale : elle fait partie d’une stratégie coordonnée de déplacement visant à modifier de manière irréversible la géographie démographique de la Cisjordanie.
L’Autorité palestinienne, affaiblie institutionnellement et discréditée socialement, n’a pas été capable d’offrir une réponse politique efficace. Sa coopération en matière de sécurité avec Israël en a fait, aux yeux de nombreux Palestiniens, une structure administrative subordonnée plutôt qu’un acteur national légitime. La déconnexion entre les élites politiques et/ou économiques de Ramallah et les communautés sous occupation est de plus en plus marquée, et le vide ainsi créé est comblé par des réseaux de solidarité locale, des formes de résistance spontanée ou, dans certains cas, par de nouvelles expressions armées qui émergent en dehors des cadres traditionnels du pouvoir.
La fragmentation territoriale imposée par les accords d’Oslo reste l’un des principaux obstacles à l’articulation politique. Les zones A, B et C divisent non seulement le territoire, mais aussi les possibilités d’action collective. À cela s’ajoutent des phénomènes comme l’ONGisation. Cette division, loin de conduire à une autonomie progressive, a fonctionné comme un système de contrôle échelonné qui renforce la dépendance, en limitant la mobilité et en entravant la planification urbaine, économique et politique.
LE SIÈGE DES PALESTINIENS DE 1948 ET LA DIASPORA
Le récit dominant tend à représenter les Palestiniens comme une population localisée exclusivement à Gaza ou en Cisjordanie. Pourtant, une part significative de ceux qui vivent sous le régime israélien – ou à son ombre –
se trouve en dehors de ces territoires, que ce soit à l’intérieur des frontières reconnues de l’État d’Israël ou dispersée à travers le monde, du Liban à Berlin. Depuis octobre 2023, ces communautés font l’objet d’une intensification de la surveillance, de la criminalisation et de la répression, non pas pour avoir participé à des actes violents, mais pour avoir osé s’exprimer.
À l’intérieur d’Israël, les Palestiniens ayant la citoyenneté israélienne, désignés « Palestiniens de 1948 », ont fait face à un climat de répression soutenue. Les manifestations ont été durement réprimées. Des arrestations ont eu lieu pour des publications sur les réseaux sociaux, pour le port de drapeaux palestiniens ou même pour avoir manifesté leur solidarité avec Gaza par des gestes symboliques. Cette répression n’est pas nouvelle, mais elle a atteint un degré de systématicité alarmant. Des organisations de défense des droits de l’Homme ont documenté des licenciements arbitraires, des interrogatoires sans garanties, des perquisitions domiciliaires et une censure institutionnelle. Dans de nombreux cas, les recours légaux pour contester ces mesures sont bloqués par un système judiciaire qui normalise l’exceptionnalité, lorsqu’il s’agit de l’identité palestinienne perçue depuis des décennies comme une cinquième colonne. La citoyenneté, dans ce contexte, ne garantit pas la protection : elle marque plutôt le seuil de la surveillance.
Dans la diaspora, le siège prend des formes plus subtiles, mais tout aussi efficaces. Les communautés palestiniennes en Europe et en Amérique du Nord ont assisté au renforcement des mesures de surveillance, à la fermeture des espaces de rassemblement, à l’interdiction des expressions culturelles et à la surveillance du langage. De Paris à Toronto, de Londres à Santiago, le message est clair : exprimer sa solidarité avec la Palestine, c’est se placer en dehors du consensus autorisé. Cette extension du régime de « silenciement » a atteint un nouveau tournant aux universités. Des cas comme celui de Mahmoud Khalil, arrêté et accusé d’incitation pour avoir exprimé sa douleur face aux morts dans la bande de Gaza, illustrent comment la liberté d’expression est traitée comme une menace, dès lors qu’elle émane de corps palestiniens.
ISRAËL EN TANT QUE PUISSANCE DÉSTABILISATRICE
Israël a réussi à consolider une image internationale de garant de la stabilité dans une région considérée comme volatile. Mais il suffit d’observer sa politique étrangère récente pour constater que son influence n’a pas contribué à contenir les tensions, mais à les produire. Au nom de sa sécurité nationale – un concept façonné avec une élasticité stratégique –, Israël est intervenu sur une grande partie de ses frontières : bombardements de la Syrie et du Yémen, extension de sa guerre au Liban et déploiement de capacités technologiques de surveillance dans de nombreux contextes, même au-delà du Proche-Orient. En juin, Israël a intensifié cette pratique en menant des frappes aériennes contre des présumés cibles militaires et politiques en Iran, qui ont également touché des civils.
Cette projection militaire constante repose sur une logique d’anticipation permanente. Sous la prémisse que toute menace potentielle doit être neutralisée avant même d’émerger, l’usage de la force est justifié au-delà des frontières reconnues, sans autorisation internationale et en marge – encore et toujours – de la légalité. La frontière, dans ce schéma, n’est pas une ligne délimitant des souverainetés, mais un espace malléable où Israël se réserve le droit d’agir unilatéralement. La doctrine de « sécurité préventive » n’a pas seulement été normalisée, mais elle a aussi été reproduite.
Alors que de nombreuses puissances occidentales ont opté pour l’ambiguïté ou le silence, plusieurs acteurs du Sud global ont émergé comme références morales et politiques autour de la question palestinienne
Une grande partie des accords bilatéraux de coopération en matière de défense, de renseignement et de sécurité entre Israël et des pays du Sud ou du Nord global ont eu pour objet l’exportation de technologies et de savoir-faire militaires forgés dans des contextes d’occupation. Ce n’est pas seulement un drone qui est vendu, mais la promesse d’une efficacité fondée sur leur usage contre des corps palestiniens. À cette stratégie s’ajoute la consolidation des accords d’Abraham, qui ont redessiné la carte diplomatique de la région. Ce qui avait commencé comme une tentative de normalisation avec les EAU, Bahreïn, le Maroc et le Soudan a abouti à un nouvel axe de coopération économique et militaire. Ces pactes ont permis à Israël de rompre son relatif isolement régional sans avoir à traiter les causes structurelles du contexte en Palestine historique. En échange, les pays signataires obtiennent un accès à des technologies de contrôle, à des investissements et à un soutien international.
LE SUD GLOBAL : RUPTURE DIPLOMATIQUE ET RÉÉQUILIBRAGE SYMBOLIQUE
À un moment où de nombreuses puissances occidentales ont opté pour l’ambiguïté ou le silence, plusieurs acteurs du Sud global ont émergé comme des références morales et politiques autour de la question palestinienne. Il ne s’agit pas uniquement de déclarations diplomatiques, mais d’une réactivation de principes juridiques, historiques et symboliques qui déstabilisent l’ordre international établi, remettant en question la sélectivité de ses normes et rouvrant le débat sur la fonction réelle des institutions multilatérales.
L’Afrique du Sud a été le symbole le plus clair de ce tournant. Sa plainte contre Israël devant la CIJ pour des actes potentiels de génocide a marqué un tournant, non seulement par son contenu juridique, mais aussi par ce qu’elle représente en termes de leadership politique: un pays du Sud qui, en évoquant son expérience de l’apartheid, interpelle directement les structures internationales qui ont protégé Israël pendant des décennies contre toute conséquence légale significative. Le geste sud-africain a rompu avec la logique de soumission silencieuse et a revendiqué une mémoire historique partagée entre des peuples ayant subi des systèmes de domination raciale et coloniale. L’exemple sud-africain n’a pas été isolé. Des gouvernements comme ceux de la Colombie, du Brésil, de la Bolivie ou du Chili ont rappelé leurs ambassadeurs pour consultations, rompu leurs relations diplomatiques ou dénoncé ouvertement les crimes commis à Gaza.
Bien que ces positions varient en fermeté et en cohérence, elles expriment un changement de climat politique. Même les pays qui maintiennent des relations officielles avec Israël ont dû faire face à une pression croissante de leurs sociétés civiles, où la Palestine a été adoptée comme une cause transversale articulant les luttes contre le racisme, le colonialisme et l’autoritarisme. Dans des espaces multilatéraux tels que le G77, la CELAC ou l’Union africaine, les résolutions exigeant la fin immédiate de la violence, la levée du blocus imposé à la bande de Gaza et l’application effective du droit International se sont multipliées.
Bien que bon nombre de ces résolutions ne disposent pas de mécanismes contraignants, elles sont politiquement significatives : elles reconfigurent les alignements mondiaux et expriment une volonté collective de cesser de traiter la Palestine comme une exception. Ce positionnement du Sud global possède en outre une dimension culturelle et symbolique. Dans des villes africaines, asiatiques et latino-américaines, le drapeau palestinien flotte sur les peintures murales, dans les manifestations et sur les scènes artistiques.
Une mémoire anticoloniale se réactive, trouvant en la Palestine un miroir douloureusement reconnaissable. Cette identification n’est ni tactique ni conjoncturelle : elle est structurelle. La Palestine n’apparaît pas seulement comme une victime, mais comme un catalyseur d’une critique plus large de l’ordre mondial. Ce mouvement n’est évidemment pas exempt de contradictions. Des gouvernements comme celui de l’Inde ont maintenu une politique ambiguë, voire proche d’Israël, motivée par des intérêts stratégiques et commerciaux. Et il y a aussi le cas de la Chine, qui soutient la réconciliation palestinienne, tout en investissant de fortes sommes d’argent dans le port de Haïfa, un nœud indispensable de sa stratégie de connectivité et d’infrastructures dans la région.
LE NORD GLOBAL : COMPLICITÉ STRUCTURELLE ET PUNITION SYMBOLIQUE
La continuité du régime israélien d’occupation, d’apartheid et de violence systématique ne serait pas possible sans le soutien constant du Nord global. De Washington à Bruxelles, en passant par Berlin, Paris ou Londres, les gouvernements et les institutions qui se présentent comme garants de l’ordre international fondé sur des normes ont échoué, non seulement par omission, mais aussi par action.
À la complicité diplomatique et militaire s’est ajoutée, ces derniers mois, une vague de censure institutionnelle, de répression symbolique et de sanction envers ceux qui osent briser le consensus dominant. Les États-Unis sont le soutien le plus ferme d’Israël sur les plans politique, financier et militaire. Leur rôle n’a pas substantiellement changé entre les administrations républicaines ou démocrates. Les vetos systématiques au Conseil de sécurité des Nations unies, le soutien militaire ininterrompu, la justification publique de chaque offensive et la protection juridique face à d’éventuelles conséquences internationales font partie d’une relation stratégique fondée sur l’impunité. Même la réalité d’un génocide n’a pas suffi à Washington pour conditionner son soutien ou remettre en question la rhétorique de sécurité totale invoquée par le gouvernement israélien.
L’Europe, quant à elle, a joué un rôle plus sophistiqué, mais non moins engagé en faveur du statu quo. L’UE et ses États membres insistent pour défendre les droits de l’Homme et le droit International, mais leurs actions ont été, au mieux, tièdes et, au pire, activement complices. Les sanctions économiques, la pression politique ou les mesures diplomatiques appliquées dans d’autres contextes – comme l’invasion russe en Ukraine – ont été absentes dans le cas palestinien. Les relations commerciales, les projets de coopération et les accords d’association avec Israël non seulement se maintiennent, mais se renforcent. Du moins jusqu’à présent, car aucun seuil ne semblait suffisant pour modifier cette inertie.
Dans le Nord global, la solidarité avec la Palestine est devenue, pour beaucoup, une sorte d’hérésie institutionnelle
À cette complicité institutionnelle s’ajoute une architecture de répression symbolique et discursive. Dans les universités, les médias, les musées, les syndicats et les organismes internationaux, une stratégie de « silenciement » a été déployée contre ceux qui expriment leur solidarité avec la Palestine ou qui critiquent ouvertement la violence du régime israélien. Étudiants expulsés, universitaires sanctionnés, événements annulés, artistes déprogrammés, journalistes censurés : tout semble indiquer que le problème ne réside pas seulement dans ce qui se passe à Gaza, mais dans le fait même de le nommer. Les universités, en particulier, ont été des espaces clés de cette censure. Les campements, communiqués et manifestations étudiantes ont fait l’objet d’une répression incluant des interventions policières disproportionnées, des accusations infondées d’antisémitisme, des menaces juridiques et disciplinaires, ainsi que l’exigence d’adopter des positions « équilibrées » qui dissolvent toute différence entre l’occupant et l’occupé.
La liberté académique, si souvent invoquée dans d’autres contextes, est devenue conditionnelle. Pour beaucoup, la solidarité avec la Palestine est devenue une sorte d’hérésie institutionnelle. Le silence qui prévaut dans le Nord global ne peut s’expliquer uniquement par la peur. Il résulte en partie d’un renoncement sélectif à la cohérence éthique. Nombre de voix qui s’étaient élevées avec fermeté face à d’autres tragédies ont aujourd’hui opté pour la neutralité ou l’évitement.
CONCLUSION : DE LA GESTION DU CONFLIT À L’URGENCE DE LA RUPTURE
Le discours dominant insiste pour parler de gestion du conflit, de reconnaissances nécessaires mais sans doute inutiles, de processus de paix à relancer ou d’équilibres à restaurer. Or, la Palestine n’est pas un conflit à gérer, mais une structure à démanteler.
Ce n’est pas seulement Gaza qui s’est effondrée, mais la promesse que le système international peut garantir des droits, la protection et la justice dans des conditions d’occupation permanente. Ce qui se passe aujourd’hui en Palestine historique n’est pas une anomalie à corriger en marge : c’est le symptôme d’un ordre profondément biaisé, fondé sur des hiérarchies d’humanité et conçu pour perdurer. On ne peut pas séparer les violences déployées à Gaza, en Cisjordanie, contre les Palestiniens de 1948 ou dans la diaspora. Ce sont des expressions d’une même logique : déposséder un peuple de sa terre, de sa voix, de ses corps et de son droit à exister politiquement.
Cette logique opère non seulement avec des tanks ou des drones, mais aussi avec des discours, des lois, des silences, des vetos et des algorithmes. Et ceux qui y contribuent, par action ou par omission, ne peuvent plus s’abriter derrière la complexité. Face à cette continuité structurelle, le Sud global commence à offrir un horizon différent : non exempt de contradictions, mais capable de nommer le colonialisme, là où d’autres voient la stabilité; d’activer des principes, là où d’autres offrent des gestes symboliques ; et de dénoncer l’intolérable, non pas parce qu’il est nouveau, mais parce qu’il l’a toujours été.
En revanche, le Nord global fait face à une profonde crise de légitimité : parce que le droit qu’il invoque n’est pas appliqué, la liberté qu’il promeut est conditionnée et la punition est réservée à ceux qui refusent de se taire. La question palestinienne ne peut plus être traitée comme un simple dossier diplomatique en suspens. C’est une épreuve structurelle qui remet en jeu la place des peuples colonisés dans le système international./