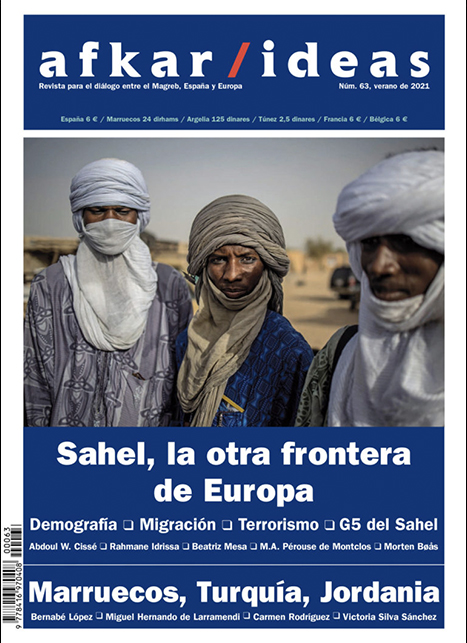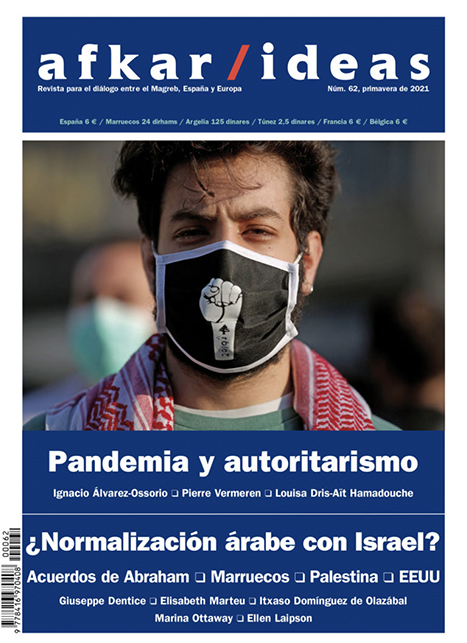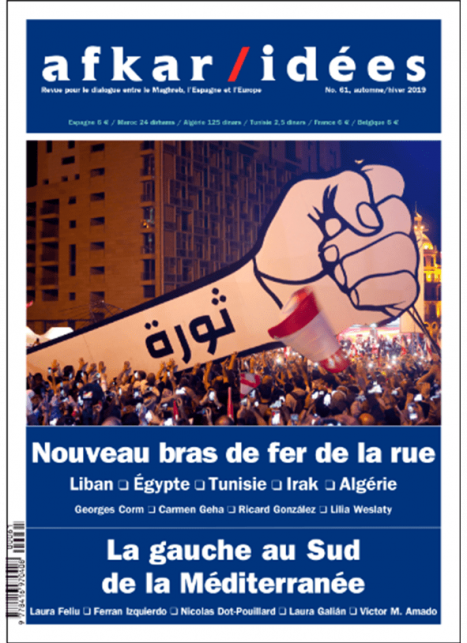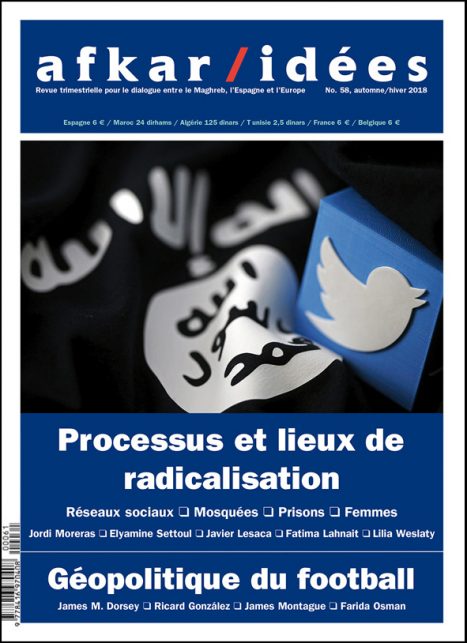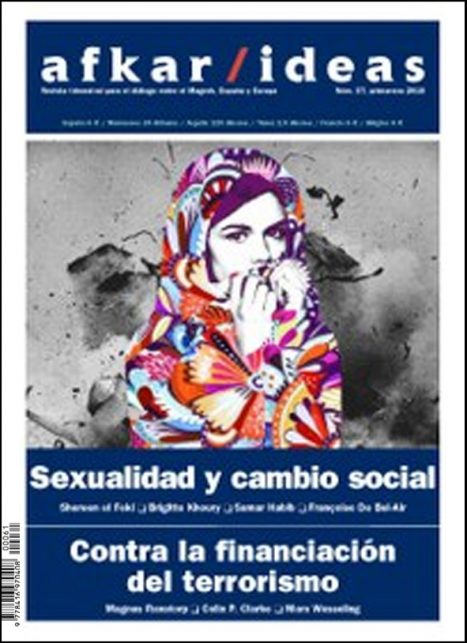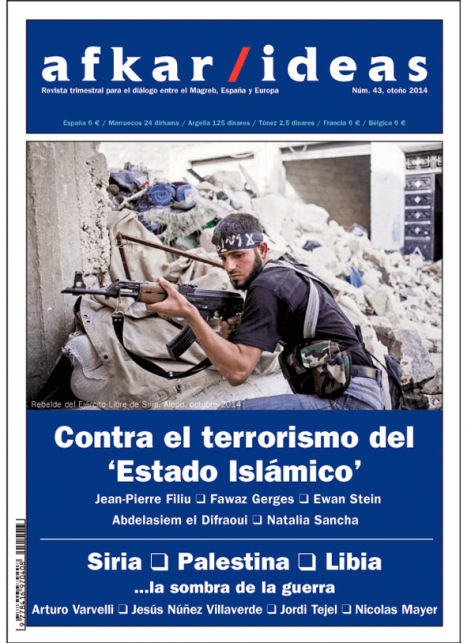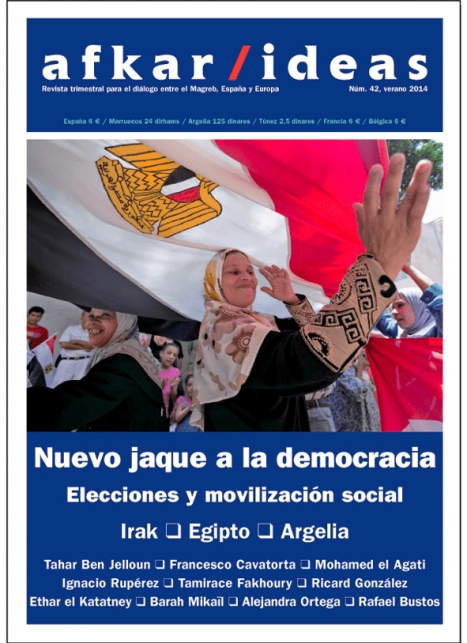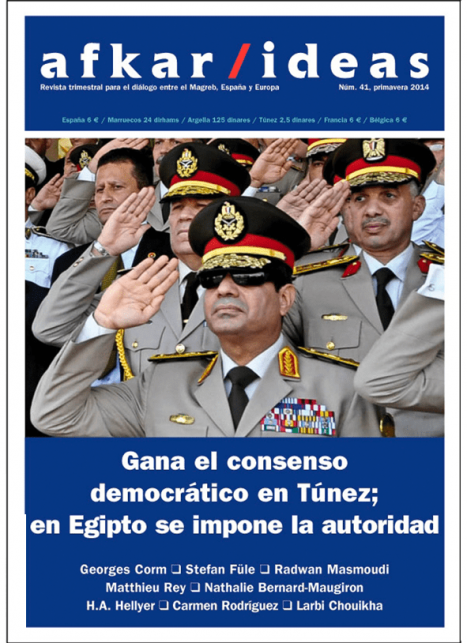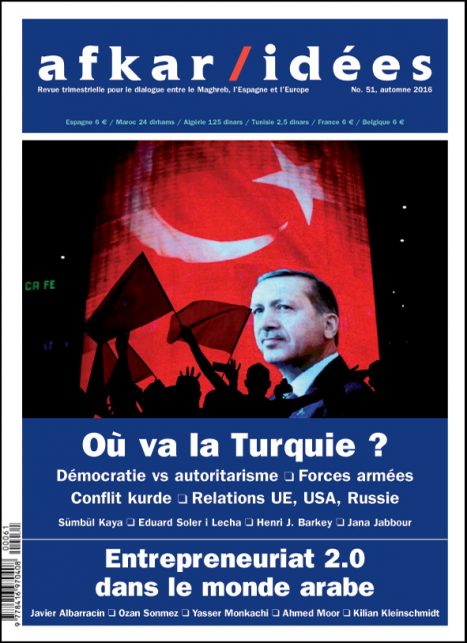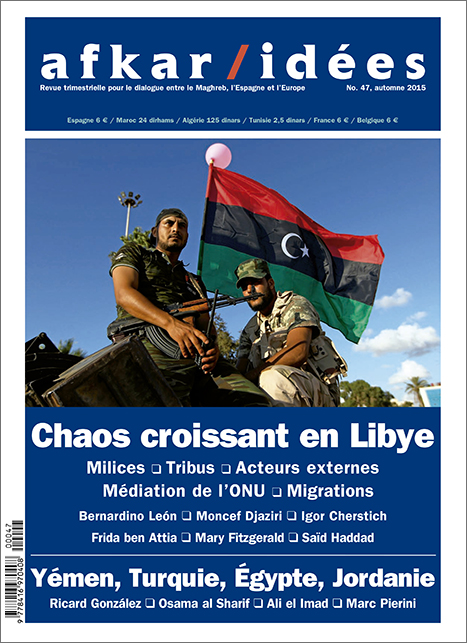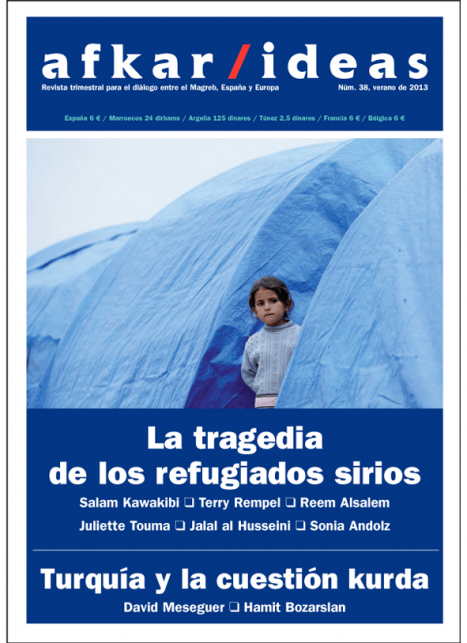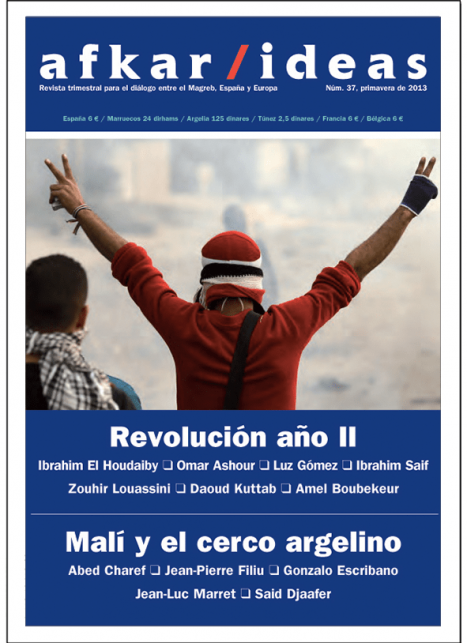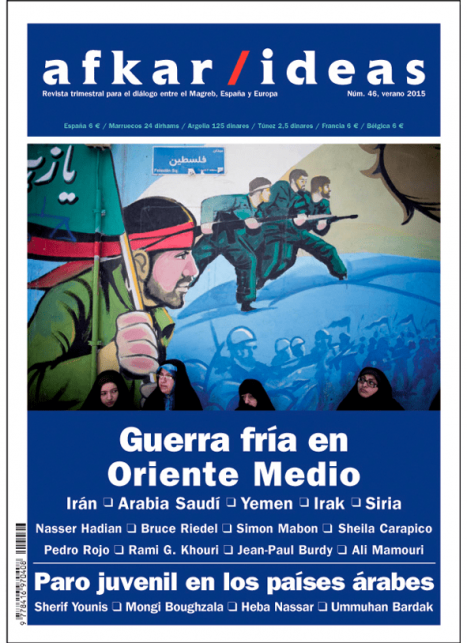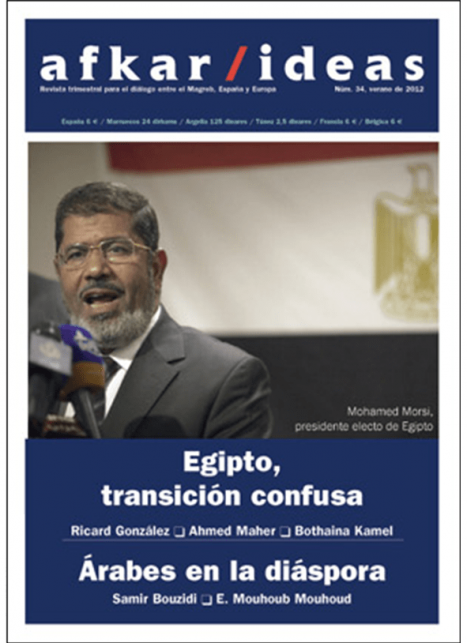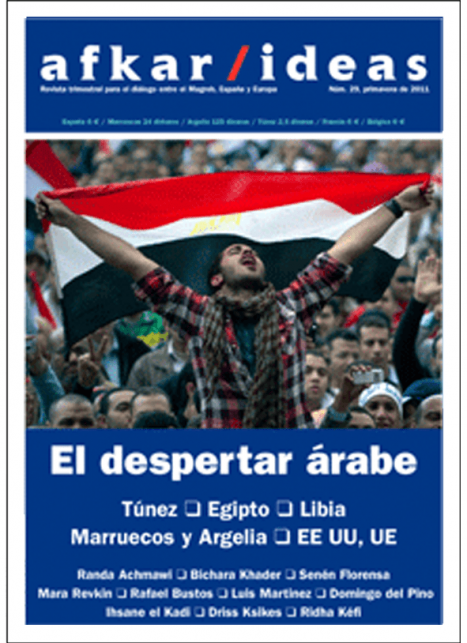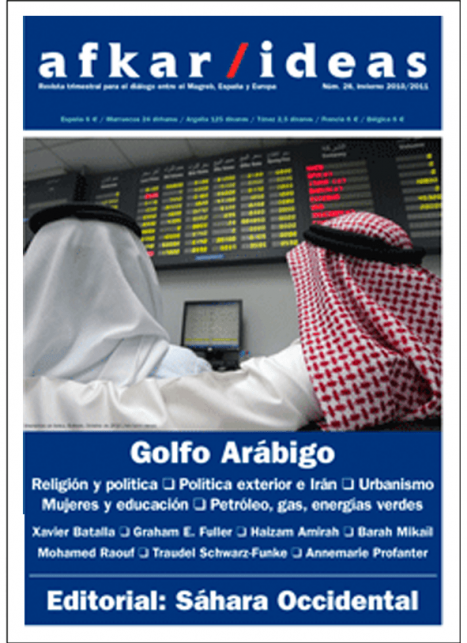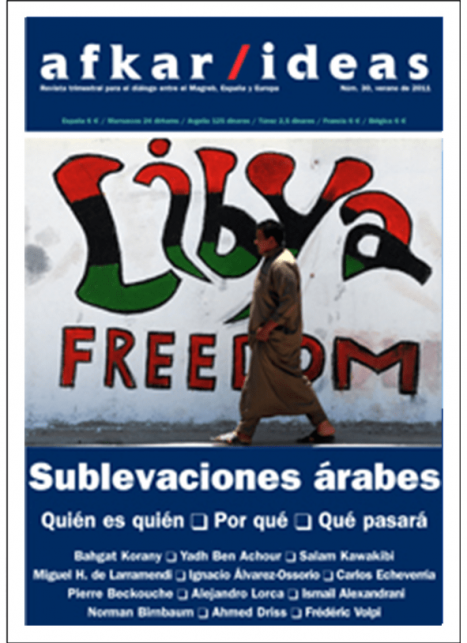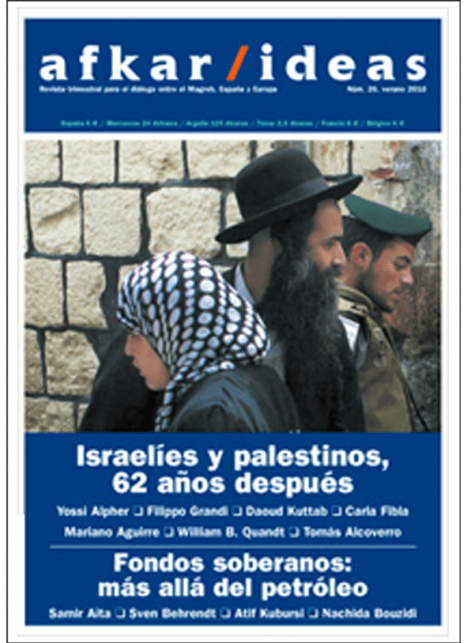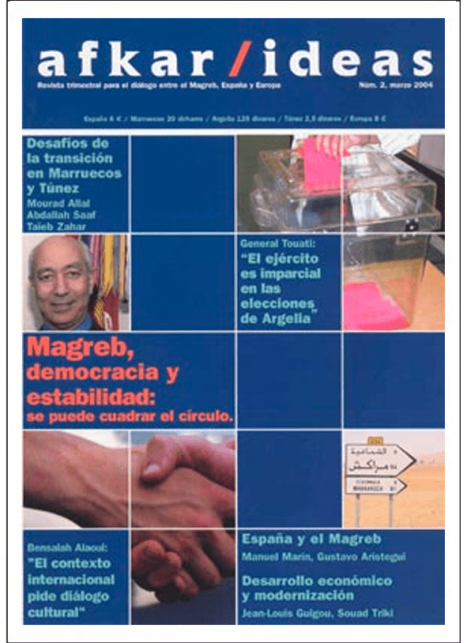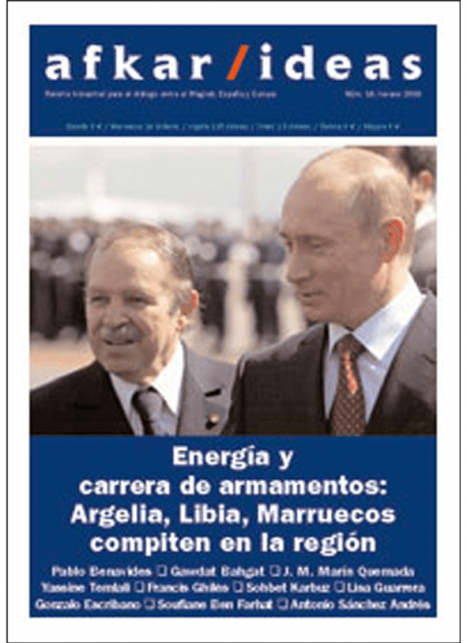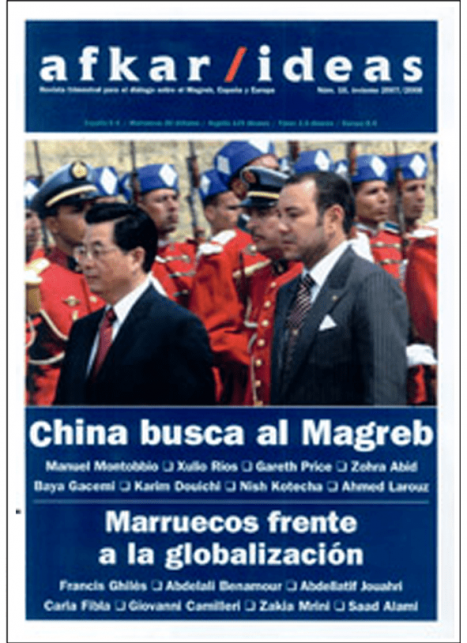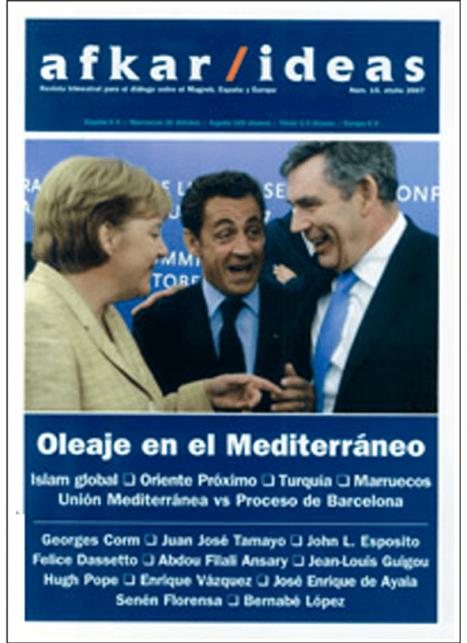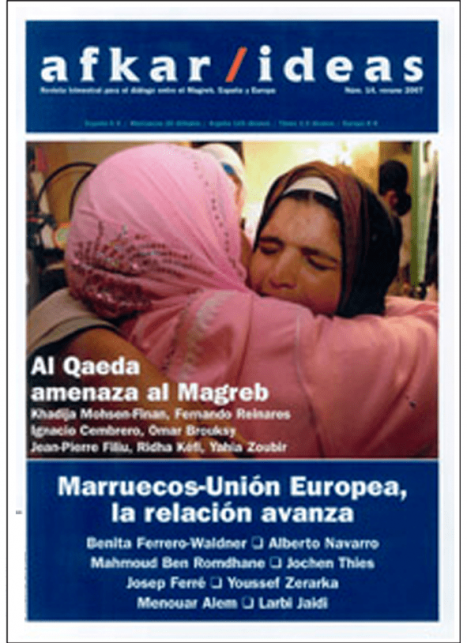Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Soudan : tentative de décryptage d’un calvaire africain
La tragédie qui se déroule au Soudan depuis le 15 avril 2023 ne se prête pas facilement à l’analyse, le pays ayant été déserté par tous les observateurs étrangers dans les premières heures du conflit. Ne restent que les récits fragmentaires mais terrifiants, des rares acteurs humanitaires qui parviennent à opérer au Darfour, loin de la capitale et du centre du pays, et les images et récits fournis par les belligérants eux-mêmes sur internet, comme celles offertes par Radio Dabanga : aujourd’hui, la géolocalisation, l’usage généralisé des portables par les acteurs de terrain, permettent de suivre dans toute sa réalité le déroulement des opérations de la guerre sur le terrain. Cependant, ces informations font souvent l’impasse sur les facteurs déclenchants de ce conflit et sur ses conséquences pour le Soudan, mais aussi pour son environnement régional et international.
Le nom même de Soudan évoque une succession des drames et de conflits :
– Famine au Darfour, attribuée à la désertification, de 1984 à 1985, qui amena la chute du général Jaafar Nimeiri, face à une intifada populaire qui déboucha sur un nouveau coup d’État militaire en juin 1989 ;
– Guerres civiles, comme celle qui, déclenchée en mai 1983, déboucha en 2011 sur l’indépendance du Soudan du Sud ;
– Soulèvement armé au Darfour en 2003, maté par une répression, qualifiée outrageusement de « génocide », mais qui se solda par 300 000 victimes, et le déplacement forcé de millions d’autres.
Oublié par les grandes puissances, le pays vit une guerre fratricide sous la forme d’un affrontement sans merci entre deux organes qui, jusqu’alors, avaient été complices dans le soutien à la dictature.
Le Soudan paraît ainsi voué à une succession de fatalités dévastatrices, frappant des régions excentrées et négligées de ce pays qui fut jusqu’en 2011 le plus vaste d’Afrique (2,5 millions de km2) et qui, après la sécession du Sud en juillet 2011, garde une superficie de 1,65 million de km2, dont la moitié désertique, pour une population d’environ 40 millions d’habitants.
Depuis le 15 avril 2023, un nouvel épisode de cette série tragique s’est ouvert, sous la forme d’un affrontement sans merci entre l’armée régulière et ses supplétifs des Forces de Soutien Rapide (FSR) : une guerre fratricide (et non pas une guerre civile), entre deux organes jusque-là complices dans le soutien à la dictature militaire réinstaurée en juin 1989, sous la direction du général Omar Al Béchir, et une orientation idéologique islamiste, inspirée par le penseur Hassan el Tourabi.
Les FSR sont à l’origine d’une milice locale supplétive de l’armée régulière encore mobilisée par la guerre au Sud Soudan en rébellion. Après l’indépendance du Soudan du Sud en 2011, et la perte des revenus du pétrole qui en a résulté, elle a été chargée de protéger le chef de l’État, mis sous mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, pour crimes de guerre et crimes contre l‘humanité au Darfour, contre une menace de destitution par ses rivaux au sein de l’armée.

bakir/anadolu via getty images
La complicité de ces deux forces armées dans la mise à l’écart du chef de l’État, le 15 avril 2019, s’est muée en rivalité après le coup d’arrêt, en octobre 2021, à la « transition démocratique » incarnée par Abdallah Hamdok, le premier ministre issu de la société civile.
L’armée a en effet souhaité intégrer les FSR dans ses rangs, dans le but de s’approprier ses abondantes sources de revenus : engagement mercenaire au Yémen, pour le compte des Émirats arabes unis, contrôle des frontières, donc des trafics de migrants et de marchandises avec le Tchad et la Libye (avec un soutien financier de l’Union européenne), association avec le groupe Wagner pour le transit des miliciens russes et de leurs chargements entre la Libye et la République centrafricaine, et surtout contrôle des gisements aurifères du Darfour. D’où la rupture brutale du 15 avril 2023.
Les forces en présence
Le conflit en cours n’est donc pas un conflit entre une armée régulière et un groupe rebelle, mais entre deux forces prédatrices concurrentes. L’armée, qui dirige le pays depuis l‘indépendance en 1956, avec de courtes périodes d’intifadas populaires vite réprimées, comme en octobre 1964 et en avril 1985, est un corps hiérarchisé, discipliné, dirigé par des officiers en majorité originaires du centre géographique et politique du pays, le « Soudan utile « de la vallée du Nil et des provinces de l‘Est. Toutefois l’indépendance acquise par le Soudan du Sud en juillet 2011 lui a retiré son accès privilégié à la manne pétrolière et à des trafics fructueux, ainsi que sa légitimité à conduire la nation.
Néanmoins, elle dispose toujours d’un armement lourd et de la maîtrise des airs, de garnisons réparties sur l’ensemble du territoire, d’un appareil logistique éprouvé, et de sa longue expérience de gestion de l’État.
Le Soudan paraît voué à une succession de fatalités dévastatrices, frappant des régions excentrées et négligées de ce pays qui fut jusqu’à la sécession du Sud en juillet 2011, le plus vaste d’Afrique
Les FSR disposent, elles, d’une base géographique et ethnique précise : ses forces proviennent du Darfour, et plus particulièrement des tribus nomades du Nord de la province, dont le pastoralisme chamelier est victime de la désertification qui frappe l’ensemble du Sahel. Cet ancien sultanat contrôlant une importante piste caravanière transsaharienne en direction de l’Égypte, est centré sur un massif montagneux volcanique, bien arrosé, abritant sur ses flancs des peuples de paysans sédentaires comme les Four, et sur son pourtour des peuples d’éleveurs plus ou moins arabisés : chameliers sur les marges du Sahara, éleveurs de chèvres et de moutons, et de vaches plus au Sud. Un système économique de complémentarité et d’échanges entre éleveurs et paysans, sédentaires et nomades, islamisés depuis le début du XVIIème siècle, y a fonctionné harmonieusement jusqu’au début du XXème siècle.
L’implantation coloniale sur l’axe du Nil et la création de Khartoum au confluent des deux Nils, tout en introduisant la pax britannica à la fin du XIXème siècle, a supprimé les revenus du commerce transsaharien, y compris celui des esclaves, tandis que la croissance de la population a provoqué un déséquilibre avec les ressources disponibles. La sécheresse et la désertification à partir des années soixante ont créé des tensions entre les groupes pour l’accès aux ressources, et entraîné un mouvement de migration d’abord vers la vallée du Nil et les plaines fertiles de l’Est, puis plus récemment vers l’Europe.
Après une première grande phase de famine, en 1983-1985, qui entraîna la chute du régime du maréchal Nimeiri (1969-1985), l’absence de tout effort de développement, de la part du gouvernement de Khartoum, fut la cause de l’insurrection, en 2003, du Sudan Liberation Movement (SLM), qui, sur le modèle du SPLM au Sud-Soudan, réclamait une répartition équilibrée des ressources de l’État : le pouvoir central opta pour une répression confiée non pas à l’armée nationale, encore mobilisée au Sud, mais à des soldats de fortune recrutés sur une base tribale, celle des nomades chameliers déstabilisés par la sécheresse, les tristement célèbres janjawids. Elle fit 300 000 victimes civiles, et entraîna le déplacement forcé de la population rurale dans des camps aux abords des grandes villes. Un débat, animé à l’échelle internationale par des acteurs en vue de Hollywood, sous le slogan « Save the Darfur » s’ouvrit en Occident sur l’utilisation de la notion de « génocide ». Cette lecture strictement raciale et religieuse de la répression masquait cependant un conflit existentiel pour l’accès à la terre et à l’eau. Cette lecture, mue par une volonté de stigmatiser une domination arabo-musulmane fantasmée, à l’encontre d’une population présentée comme « africaine », a néanmoins fait florès dans les media et les cercles dirigeants occidentaux.
Elle n’en demeure pas moins opératoire dans le conflit actuel : parmi d’autres communautés paysannes, les Massalit, un peuple de paysans du Darfour occidental, entre Tchad et Soudan, sont aujourd’hui la cible d’une effroyable épuration ethnique, de la part de leurs voisins éleveurs nomades, en quête de terres fertiles.
Le jeu politique derrière la guerre met aux prises deux visions pour le Soudan : l’une, laïque et décentralisée, menée par les FSR, dont la crédibilité démocratique est pour le moins sujette à caution ; l’autre, plus classique, repose sur l’alliance entre l’armée nationale et le mouvement islamiste radical, qui a prévalu durant la dictature du général Al Béchir
Le conflit au Darfour s’est désormais étendu à l’ensemble du pays. Le Mouvement pour la Justice et l’Égalité (JEM), efficace et structuré autour du clan Kobé de l’ethnie zaghawa, au pouvoir au Tchad voisin, vise à prendre le pouvoir à Khartoum, en s’appuyant sur une résilience exceptionnelle et sur une adhésion à l’islam radical de Hassan el Tourabi. Ce dernier avait eu le mérite de pressentir le renversement démographique et social centre/périphérie qui s’amorçait au Soudan, et avait apporté son soutien aux cadres émergents des périphéries, autour d’un islam adapté à la modernité. Pour autant, c’est un autre Zaghawa, d’un autre clan et de basse caste, Minni Minawi, naguère modeste chef d’une scission du SLM, qui est désormais gouverneur du Darfour, tandis que le dirigeant historique du SLM, Abdel Wahid Mohamed Nour, un Four radicalement laïque, après des années d’exil à Paris, a repris le maquis sur les flancs inexpugnables du Jebel Marra.
L’armée a obtenu le soutien d’une Coalition de mouvements armés du Darfour, mais ce soutien ne reflète que leur méfiance à l’égard des FSR.
À l’inverse, une coalition de mouvements civils et des FSR réunis en février 2025 à Nairobi a conçu un projet de Constitution tenant compte de la diversité régionale et des aspirations démocratiques, selon Radio France International (RFI) : un socle commun opposé à la fois au retour à une dictature militaire et à un éventuel projet politique islamiste.
Le jeu politique derrière l’affrontement armé met donc aux prises deux visions pour le Soudan : l’une, laïque et décentralisée, réunissant une quinzaine de mouvements civils, est menée par les FSR, dont la crédibilité démocratique est pour le moins sujette à caution : l’autre, plus classique, repose sur l’alliance entre l’armée nationale et le mouvement islamiste radical, qui a prévalu durant les 30 années de dictature du général Omar Al Béchir (1989-2019).
Le déroulement du conflit
Il semble que l’affrontement entre ces deux groupes pourrait se régler par le sort des armes. Le conflit enclenché au printemps de 2023, par le refus des FSR d’intégrer l’armée régulière, est en effet entré dans une troisième phase, dont l’issue est encore incertaine sur le terrain, même si l’armée semble avoir le dessus, en reprenant le contrôle du « Soudan utile » depuis l’automne 2024, avec en point d’orgue la reprise du palais présidentiel en mars 2025.
Dans une première phase, grâce à leur mobilité, et à leur présence antérieure sur place, les FSR s’étaient emparés de vastes territoires, opérant la jonction entre leur base du Darfour et la capitale où ils avaient été appelés par l’armée pour mater le printemps de Khartoum. Mais leur dynamique s’est essoufflée dans les terres fertiles de la Mésopotamie soudanaise, entre Nil Bleu et Nil Blanc, tandis que le gouvernement militaire replié à Port Soudan acquérait une relative légitimation internationale, soutenue par l’Égypte et la Turquie.
Les FSR, ne disposant pas des moyens de consolider leurs conquêtes, faute d’une logistique appropriée, vivant sur le pays, se sont aliénées le soutien de la population et sont dans une phase de repli vers leur bastion du Darfour, d’où leur parvient l’armement fourni par les Émirats arabes unis, leur principal soutien extérieur. Les FSR contrôlent la quasi-totalité de la province, à l’exception de la caserne de l’armée qu’elles, toutefois, encerclent, elles-mêmes encerclées par la Coalition des groupes alliés de l’armée : une situation bloquée mais dévastatrice dont les civils sont les premières victimes, en particulier le gigantesque camp de déplacés d’Abou Chok. La situation y est d’autant plus effroyable que l’aide humanitaire ne peut pas parvenir du Tchad où elle est acheminée, sauf à être pillée. Mais la question se pose de savoir si elle va pour autant retrouver une légitimité populaire, après avoir mené le pays au désastre, et si les divers mouvements armés, à base ethnique ou politique, vont accepter un retour à la case départ. La « transition démocratique », avortée des années 2019-2021, a laissé des traces, et les débats se sont désormais déplacés du côté des FSR, qui cherchent à se doter d’une légitimité populaire, en cherchant à établir une plate-forme de gouvernement avec les mouvements de la société civile. Leurs soutiens ne sont pas négligeables, s’agissant de la plupart des pays voisins du Soudan, de manière plus ou moins avouée, et pour des motifs divers : le cas des EAU est à part, puisqu’il repose sur le commerce illégal de l’or soudanais. L’Éthiopie est évidemment hostile à l’armée soudanaise, puisque celle-ci est soutenue par l’Égypte, avec au centre la question du partage des eaux du Nil. En plus, si le Soudan du Sud est lui-même en proie à une guerre civile dévastatrice, le Tchad, l’Ouganda et le Kenya penchent en faveur des FSR. L’or généreusement versé à leurs dirigeants y est pour beaucoup, mais pas seulement : la crainte de l’activisme de l’islam politique est omniprésente dans ces pays à l’unité nationale fragile, et ou la Turquie et l’Iran sont suspects d’entrisme délétère.
Les grandes puissances face au conflit
Les grandes puissances sont en revanche étrangement absentes d’un conflit dont elles ne semblent maîtriser ni les acteurs, ni les enjeux : elles ne se préoccupent apparemment que de tenter d’apporter une aide humanitaire qui ne parvient pas à franchir la frontière, sauf à être pillée par les belligérants.
Les États-Unis ont bien tenté une médiation, en 2023, de pair avec l’Arabie saoudite, sans résultat tangible à ce jour. L’Arabie saoudite est pourtant la plus préoccupée, sans doute, par cette plongée dans le chaos, à proximité de la mer Rouge dont le rivage doit être le théâtre de sa « Vision 2030 ». Comme les Émirats arabes unis, elle a établi des liens précoces avec les FSR qui lui ont fourni des mercenaires dans le conflit yéménite ; mais le conflit qui déchire le Soudan peut aussi révéler en filigrane, une divergence avec l’activisme agressif des Émirats arabes unis.
La Russie est partagée entre, d’une part, la préoccupation de son accès, depuis la Libye orientale tenue par le maréchal Haftar aux ressources minières de la RCA, avec l’aide des FSR, et d’autre part l’obtention sans cesse repoussée d’une base navale à édifier sur la mer Rouge tenue par l’armée, ultime étape de son projet séculaire d’accès aux mers chaudes.
La Chine est sans doute préoccupée par ses intérêts économiques, puisque les puits de pétrole du Soudan du Sud sont opérés par des compagnies chinoises ou sino-malaysiennes ; mais ils sont devenus inaccessibles, l’oléoduc acheminant le pétrole à la mer Rouge étant mis hors d’usage.
Quant à l’Iran, depuis longtemps présent au Soudan pour des raisons idéologiques autant qu’économiques, il est sans doute en faveur du retour de l’armée aux affaires.
Les grandes puissances sont étrangement absentes d’un conflit dont elles ne semblent maîtriser ni les acteurs, ni les enjeux
D’un côté comme de l’autre, des alliances et des soutiens plus ou moins avoués, mais souvent contradictoires :
le conflit soudanais est une équation à multiples variables, sans gagnant à ce jour, mais dont le perdant est, une fois encore, le peuple soudanais, pourtant épris de paix et de développement, libéré de ses vieux démons.
Face à cet échec des puissances extérieures à imposer une issue pacifique au conflit, la diplomatie africaine ne reste pas inactive : l’Union africaine dispose sans doute de compétences pour faire entendre raison aux belligérants, et, l’IGAD (Intergovernmental Authority on Development), l’organisation régionale de la Corne de l’Afrique, a une compétence déjà bien établie sur le dossier Sud-Soudanais qu’elle avait largement contribué à faire aboutir.
On ne peut que constater l’absence de l’Europe dans ce tour d’horizon : certes, d’autres conflits accaparent l’attention ; mais on pourrait rappeler que c’est la colonisation qui a tracé des frontières et perturbé des équilibres, et que l’occasion pourrait être venue d’aider l’Afrique à se stabiliser pour un développement mutuellement profitable. À l’heure où la compétition à l’échelle globale s’intensifie, l’Europe aurait tout à gagner à repenser et resserrer ses liens avec ce continent qui lui fait face de l’autre côté de la Méditerranée, pour peser plus efficacement dans le concert des grandes puissances./