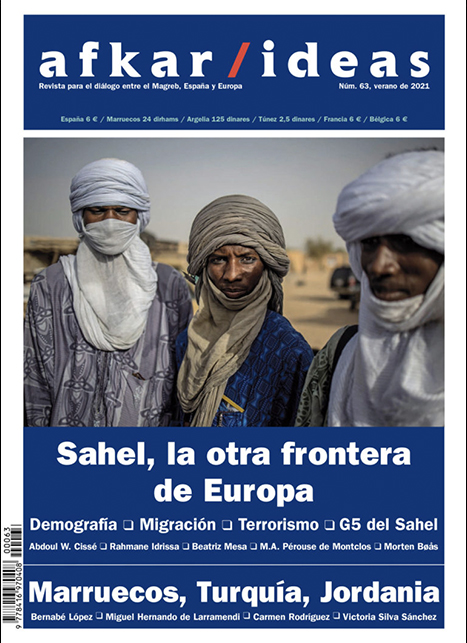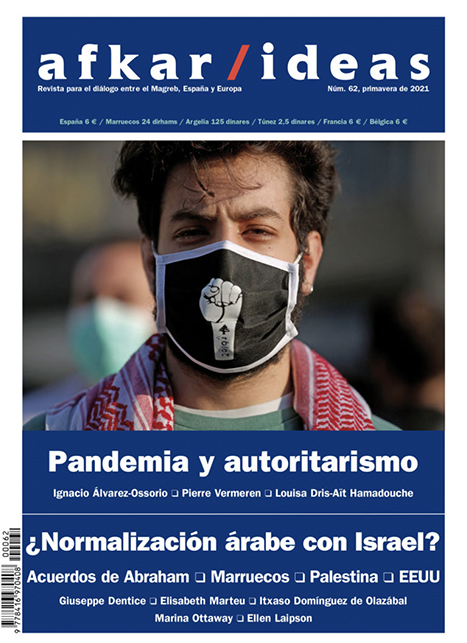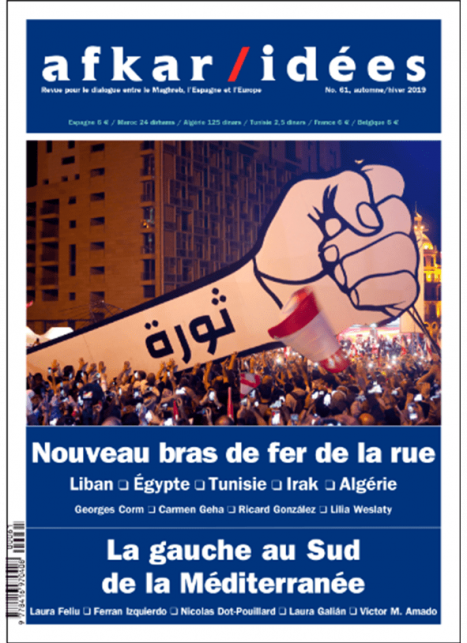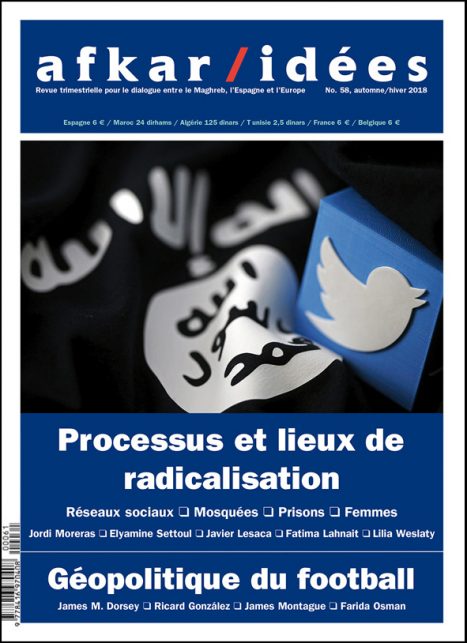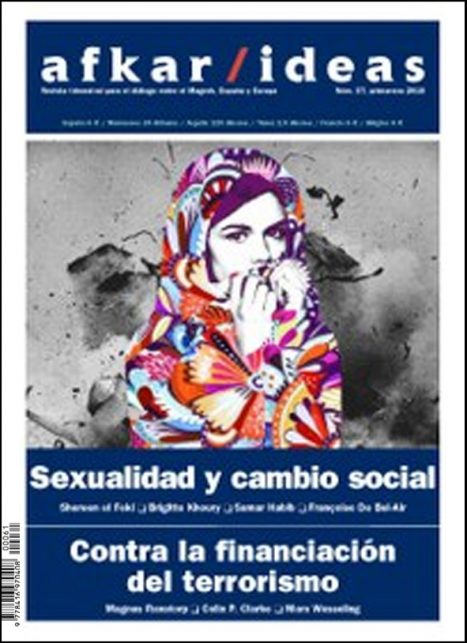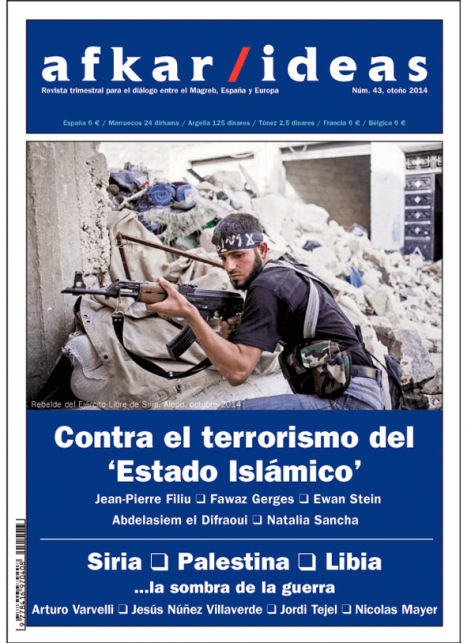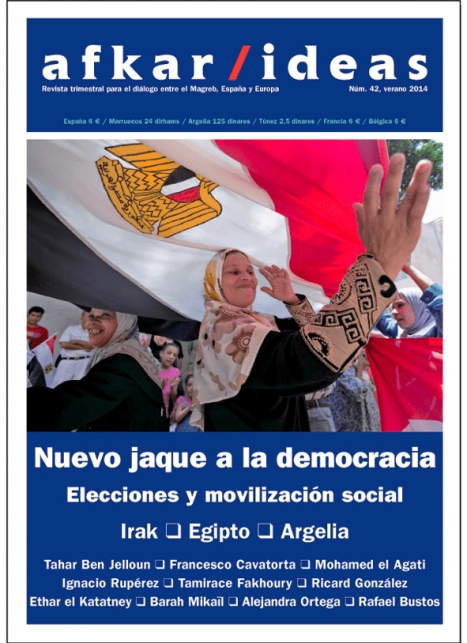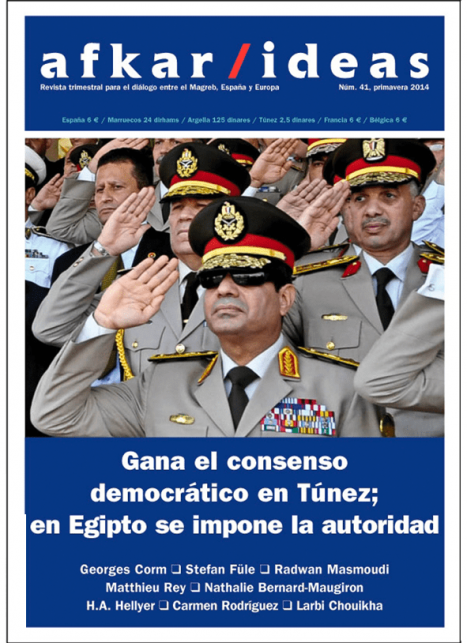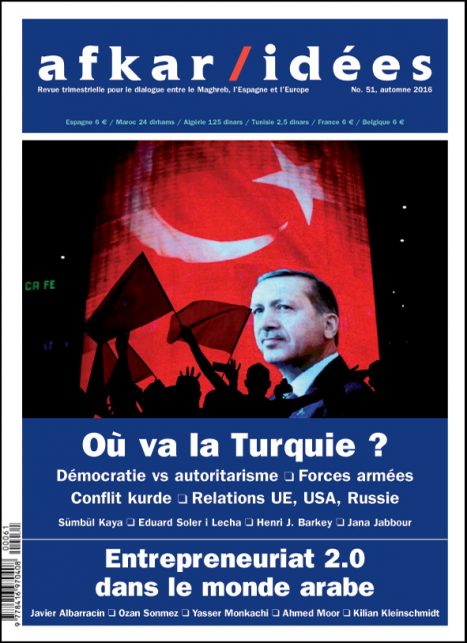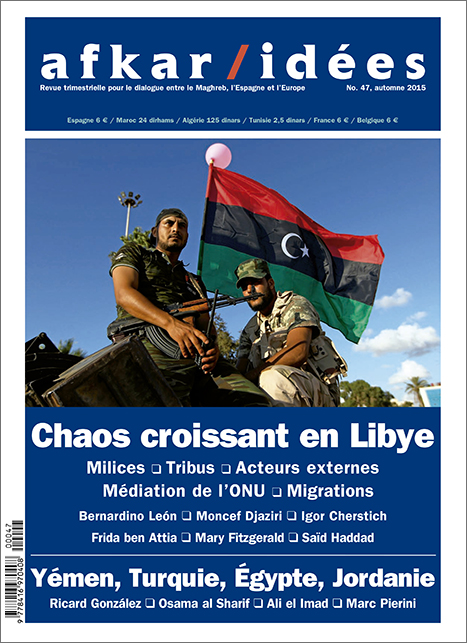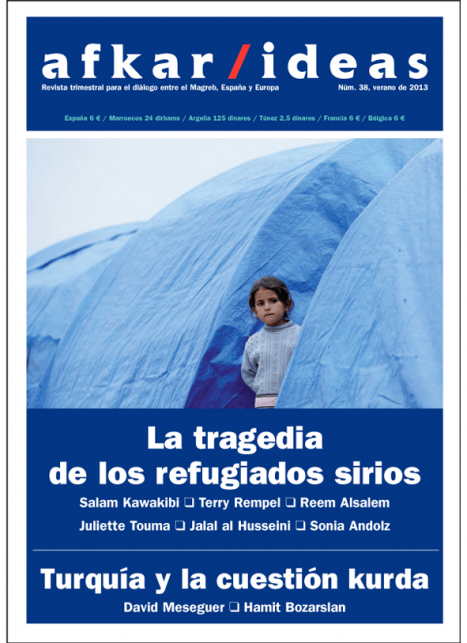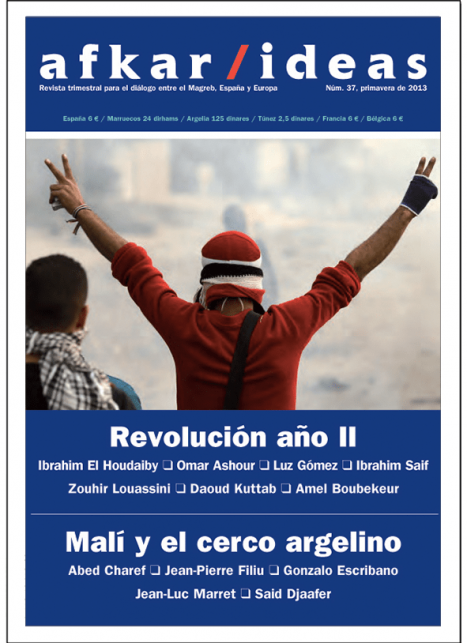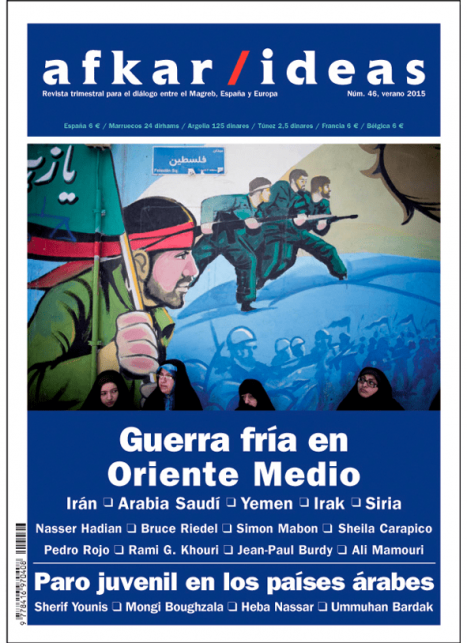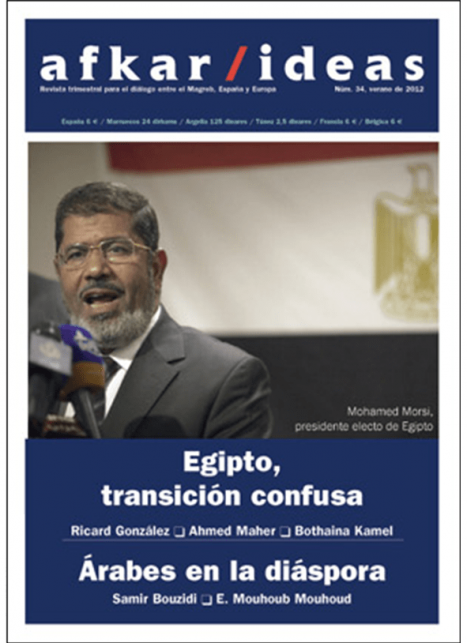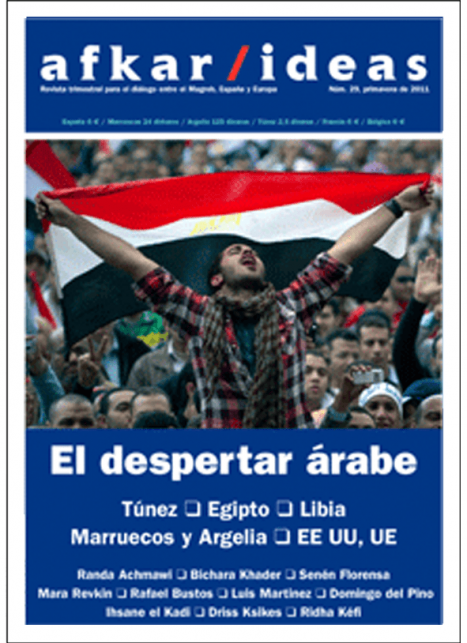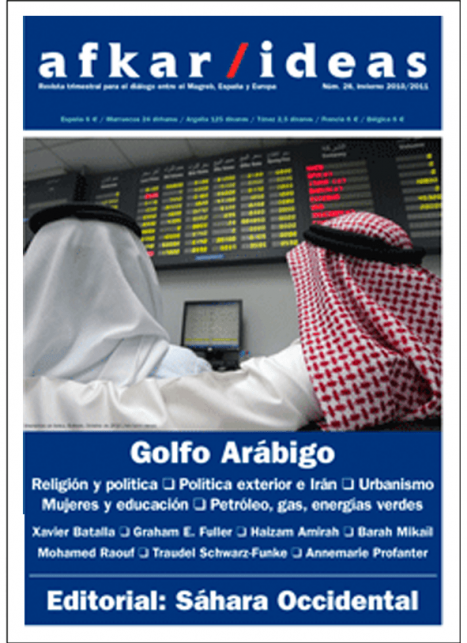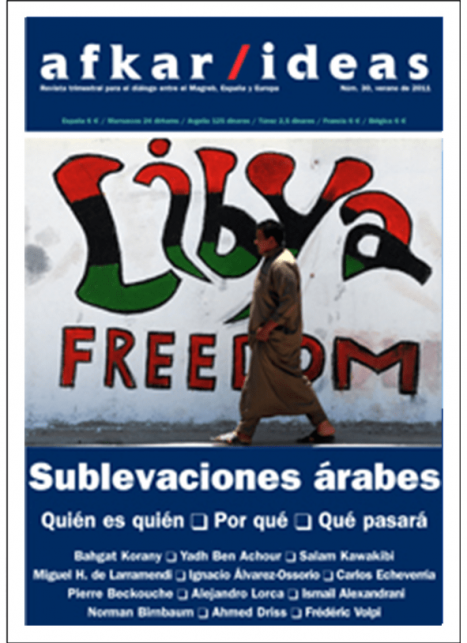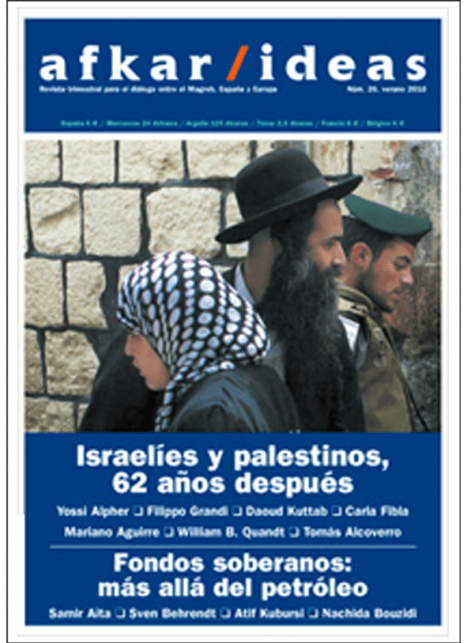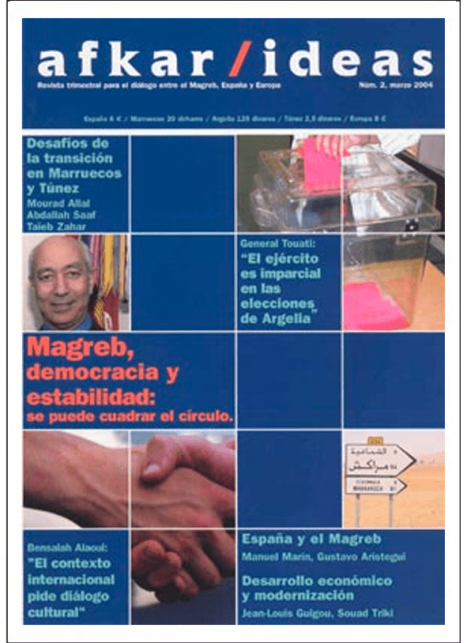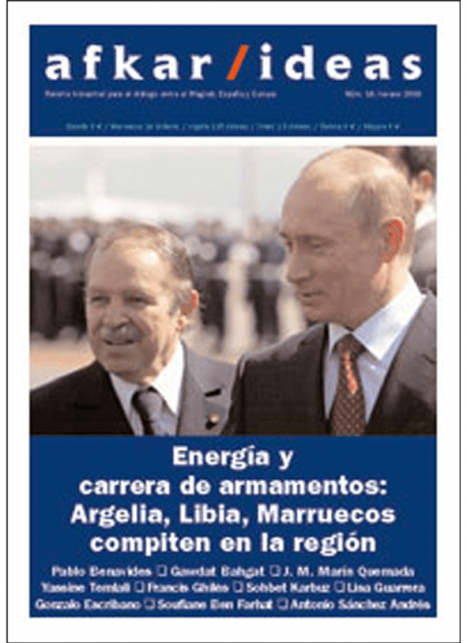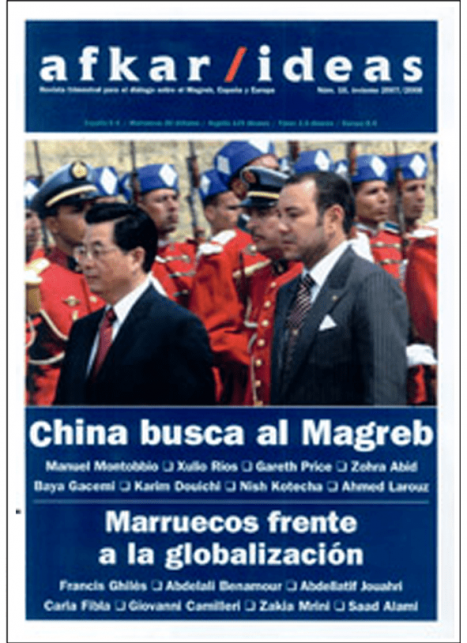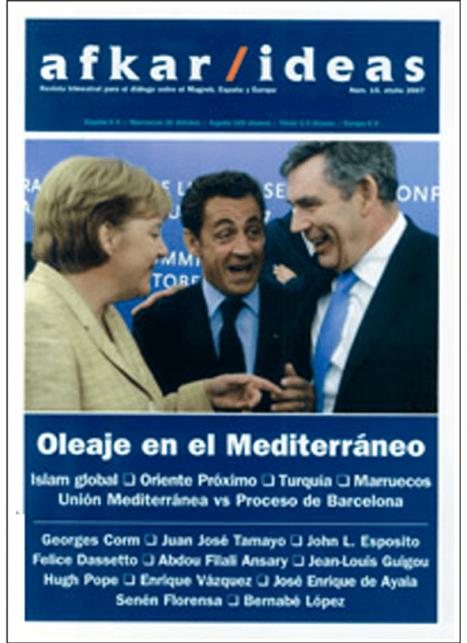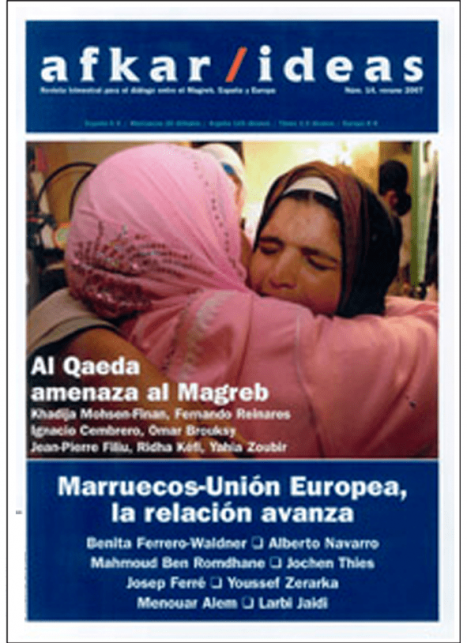Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Les enjeux strategiques des mineraux critiques
Dix-sept éléments du tableau périodique dénommés « minéraux critiques » ou « terres rares » jouent un rôle majeur dans les calculs et les stratégies de divers pays. À bien des égards, les terres rares sont les intrants de la société industrielle du siècle présent. Elles sont vitales pour des produits clés allant des produits de haute technologie (smartphones et moniteurs) aux systèmes de conversion d’énergie (éoliennes, panneaux photovoltaïques et machines électriques) et technologies militaires (lasers et radar). Les difficultés à les remplacer par des matériaux alternatifs font des terres rares des ressources stratégiques uniques. Parmi leurs nombreuses applications possibles, certains de ces métaux (par exemple, indium et gallium) sont importants pour la production de semi-conducteurs, qui représentent une pierre angulaire des industries de pointe considérées comme un « impératif géopolitique », aggravé par les tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine. Par conséquent, le sort des semi-conducteurs et des terres rares est étroitement lié à cette course mondiale exponentielle à la technologie de 4ème génération et au leadership industriel.
Bien que le marché des terres rares soit relativement limité en termes de volume, tout pays qui le domine jouit d’une influence géopolitique et d’un effet de levier significatifs sur les autres pays. En fait l’extraction des métaux de terres rares implique de surmonter deux défis. D’abord, pour extraire de minuscules quantités des 17 métaux de terres rares, il faut enlever de nombreuses tonnes d’agrégats et de roches. Sans contrôles rigoureux, ce type d’opération est très polluant et soumis à de nombreuses opérations illicites. Ensuite, arrive la séparation des métaux suivie de leur préparation pour les utiliser dans les process industriels. Ces opérations sont complexes et coûteuses et bien entendu la Chine peut fournir le produit fini pour 30 % de moins en termes de coût que n’importe quel autre pays. La prédominance de la Chine est le produit de la décision des administrations américaines à partir de la fin des années 1980 de faire de la Chine le cœur de l’industrie manufacturière américaine. L’une des industries que les États-Unis ont déplacée à travers le Pacifique était l’extraction et le traitement des terres rares. Jusqu’à présent, les États-Unis jouissaient d’un monopole. En 2017, l’Union européenne (UE) a formé l’alliance européenne des matières premières afin de commencer à se diversifier. À l’époque, la Chine lui fournissait 98 % de ses besoins en terres rares. Présentement, la Chine fournit toujours 90 % des terres rares dans le monde. Toutefois, l’UE a noué deux partenariats stratégiques depuis la formation de l’alliance. L’un est avec le Canada et l’autre avec l’Ukraine. Le problème, c’est que le deuxième accord est compromis à cause de la crise politico-militaire russo-ukrainienne qui dure depuis début 2022.
LA DYNAMIQUE D’INFLUENCE DES DIFFÉRENTS ACTEURS
La guerre en Ukraine a montré à quel point une dépendance excessive vis-à-vis d’un mono-fournisseur de matières premières peut être fragile. Depuis cette crise de forte intensité, la Méditerranée et son prolongement stratégique qu’est le continent africain se sont révélés le théâtre de manœuvres politico-diplomatiques d’acteurs de puissance. L’ensemble constitue ainsi le premier des théâtres géopolitiques et par voie de conséquence, les enjeux sont à trois niveaux : stratégique, économique et écologique.
La Chine, un acteur clé du Sud global
La Chine est en mouvement croissant pour accroître sa présence sur le continent africain pour garantir les futurs approvisionnements en terres rares et mettre en œuvre ses ambitieux plans industriels de transition énergétique et technologique. Depuis 2018, la Chine a commencé à importer certaines terres rares en réponse à l’augmentation de la demande intérieure et à la suite de restrictions environnementales sur les pratiques d’extraction illégales. Pékin est donc certain d’agir pour sécuriser ses importations et de telles actions se joueront, incontestablement, en Afrique. La Chine est susceptible d’offrir des investissements et des financements dans les infrastructures en échange de ressources et de droits d’exploration minière et énergétique sur le continent africain. Le soutien et la finance de l’État étant indispensables au développement des ressources alternatives en terres rares, la Chine a une longueur d’avance grâce à son influence géoéconomique en Afrique, sa position de grand consommateur, sa mainmise sur l’industrie du raffinage et par-dessus tout sa coopération avec les pays africains sans imposer de conditionnalités politiques. Par voie de conséquence, les acteurs occidentaux vont devoir offrir des conditions sérieusement avantageuses s’ils ne veulent pas prendre du retard dans cette course aux terres rares, et doivent bien comprendre que contenir la domination chinoise dans ce secteur ne va pas être chose facile.
La Chine a une longueur d’avance grâce à
son influence géoéconomique en Afrique,
sa position de grand consommateur,
sa mainmise sur l’industrie du raffinage
et par-dessus tout sa coopération sans
imposer de conditionnalités politiques
Il n’y a pas de transition verte, pas d’internet, pas de nano-recherche médicale, pas d’armement avancé, pas d’Intelligence Artificielle, pratiquement pas de solutions techniques aux problèmes planétaires, sans terres rares. Le père de la révolution économique chinoise, Deng Xiaoping, a compris leur importance et avait déclaré : « Le Moyen-Orient a du pétrole ; la Chine a des métaux de terres rares. » Le marché est présentement dominé par la Chine, qui produit environ 60 % des terres rares mondiales, en transforme et raffine environ 80 %, et est l’acteur central de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Par ailleurs, le club des BRICS en phase d’élargissement en BRICS+ concentreraient environ 90 % des ressources en minerais critiques et stratégiques. Les principales économies mondiales sont actuellement toutes trop dépendantes des importations chinoises : 80 % des importations vers les États-Unis et 98 % des importations vers l’UE proviennent de la Chine. La crainte que des restrictions d’approvisionnement, voire des arrêts, ne causent de graves dommages aux économies, aux industries et aux plans de décarbonations conduit donc de nombreux pays à rechercher des sources alternatives. Les inquiétudes sont apparues pour la première fois en 2010 lorsque, pour des raisons politiques, Pékin avait annoncé l’arrêt des exportations vers le Japon. À l’époque, on estimait qu’environ 97 % des réserves mondiales de terres rares provenaient de Chine.
La montée des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine alimente, également, les inquiétudes. En effet, la Chine a menacé à plusieurs reprises de réduire ou de bloquer les exportations de terres rares vers les États-Unis, ce qui a incité tous les pays importateurs à trouver de nouvelles sources de production afin de réduire la domination chinoise dans ce secteur. La Chine suit une démarche bien établie d’accès aux ressources en échange de la construction d’infrastructures. Elle souhaite avant tout acquérir la matière brute et non transformée.
Les acteurs occidentaux
Les États-Unis sont déterminés à minimiser leur vulnérabilité envers la Chine. En 2019, le Département américain de la Défense a entamé des négociations avec le Malawi et le Burundi pour discuter du soutien à un certain nombre de projets afin d’assurer les futurs approvisionnements en terres rares à partir du continent africain. L’actuelle administration Trump lorgne les ressources minières du Groenland et de l’Ukraine notamment.
L’UE est, également, déterminée à réduire sa dépendance quasi totale vis-à-vis de la Chine, qui pourrait autrement s’avérer un obstacle sérieux à la mise en œuvre du « Green Deal ». Alors que l’UE est désireuse d’accroître l’autonomie stratégique dans ce secteur en développant les gisements et le recyclage nationaux de terres rares, elle a également affirmé en septembre 2020 qu’elle était disposée à établir de nouveaux partenariats stratégiques avec les pays africains notamment de l’Afrique du Nord pour obtenir des approvisionnements supplémentaires.
Dans cette nouvelle dynamique, l’UE tente de riposter. En effet, en décembre 2022, Ursula von der Leyen, a dévoilé le projet « Global Gateway », qui doit mobiliser 300 milliards d’euros de financements publics et privés dans les pays émergents et dont la moitié est destiné à l’Afrique, pour développer des infrastructures. La stratégie consiste surtout à faciliter l’exploitation de grandes réserves de terres rares très peu exploitées détenues par plusieurs pays comme l’Algérie, l’Égypte, le Burundi, le Gabon, la Tanzanie, la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, et d’autres. L’Europe tente d’échapper à sa dépendance de la Chine sur ces minerais et d’accéder à des ressources minières indispensables à la transition énergétique comme le cobalt, le cuivre, le lithium, le strontium, etc. La demande de métaux clés est à la hausse: par exemple, selon la Commission européenne, la demande de lithium de l’UE devrait être multipliée par 12 d’ici 2030 et par 21 d’ici 2050.
L’Australie et le Japon pour leurs parts, souhaitent également accroître leur présence en Afrique. L’Australie, par exemple, bien que déjà le deuxième producteur mondial de terres rares, s’efforce en permanence de développer de nouvelles sources pour réduire la domination chinoise conformément aux intérêts de Washington. Le Japon, quant à lui, soutient, depuis 2010, des projets africains de terres rares, par exemple en Namibie et en Afrique du Sud.
L’ESSOR DE L’AFRIQUE ET DE LA RIVE SUD DE LA MEDITERRANEE OCCIDENTALE
Dans cette ère nouvelle de recomposition des alliances géopolitiques, l’Afrique a une opportunité d’émerger en tant que région de production, ce qui est susceptible d’intensifier la compétition entre les acteurs mondiaux. Le continent africain abrite de nombreux gisements de terres rares, en particulier, dans les pays de l’Est et du Sud comme l’Afrique du Sud, le Burundi, le Kenya, le Madagascar, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la RDC, le Rwanda, la Tanzanie, et la Zambie mais, également, au Nord tel que la région sahelo-saharienne et l’Algérie. Néanmoins, dans l’état actuel des choses, l’Afrique n’a pas encore dépassé le stade du grand potentiel. La seule extraction actuellement en cours concerne le projet Gakara Rare Earth au Burundi et les gisements de Steenkampskraal en Afrique du Sud qui pourraient être mis en service sous peu. Un certain nombre de pays africains ont cependant commencé à mettre en œuvre des projets à différents stades, notamment, Afrique du Sud (Projets Glenover et Phalaborwa), Angola (Longonjo Project), Madagascar (Tatalus), Malawi (Kangankunde), Mozambique (Projet Xiluvo REE), Namibie (Lofdal Heavy Rare Earths Project), Ouganda (Makuutu Project), et Tanzanie (Ngualla Rare Earth Project).
La rive sud de la Méditerranée se
positionne comme une passerelle clé à la
croissance rapide des marchés émergents
en Amérique latine, en Asie et en Afrique
L’aire d’intérêt commun à cheval entre la mer Méditerranée, l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-saharienne dénommée pour la circonstance « Mediterafrique » est devenu courtisée, notamment, pour ses ressources minières nécessaires à la transition énergétique et est devenue le terrain de jeux d’influence. En toile de fond, se joue surtout une guerre d’influence entre les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et l’Afrique du Sud), les États-Unis et l’UE. Selon Statista, Pékin s’est érigé comme partenaire de choix pour l’Afrique. Si l’UE demeure le premier partenaire commercial du continent africain, en 20 ans, la Chine s’est imposée comme le principal fournisseur de marchandises pour plus de 30 pays africains, ainsi que le premier investisseur étranger en Afrique. Depuis 2013, Xi Jinping a d’ailleurs lancé le projet des nouvelles routes de la soie, avec lequel Pékin s’investit et investi dans les pays émergents, en particulier en Afrique.
En termes d’analyse, les nouvelles élites du continent africain seront de plus en plus réticentes à favoriser la coopération avec le Nord, mais plutôt se concentrer sur le développement Sud-Sud. En partie entraînés par des investissements massifs et la demande croissante en provenance des pays BRICS et du Conseil de coopération du Golfe, les entreprises d’Afrique du Nord sont au centre du développement de nouveaux liens régionaux. Par conséquent, la rive sud de la Méditerranée se positionne comme une passerelle clé à la croissance rapide des marchés émergents en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Avec l’augmentation de la coopération Sud-Sud, une nouvelle identité sud-méditerranéenne se développera et la région s’érigera en puissance des marchés émergents de plus en plus influents. L’enjeu pour les pays de la région « Mediterafrique » est de développer une économie de la transformation des minerais ce qui en ferait un facteur de croissance inclusive.
Présentement, l’exploitation des ressources minières du continent africain est faite par d’autres et produit de la richesse qui ne reste pas sur le continent. L’enrichissement des populations locales est un problème majeur de gouvernance. Par exemple la RDC, le Mozambique, le Tchad, le Mali, et le Niger qui regorgent de ressources naturelles minières, sont en incapacité de délivrer à leurs populations un minimum de services sociaux de base. L’exploitation par des pays tiers des ressources minières, la gouvernance locale défaillante et les conflits d’intensité variable qui minent le continent africain sont les facteurs de tension et de guerre des terres rares.
Algérie
Malgré un sous-sol riche en diverses ressources minérales, le secteur minier algérien contribue actuellement à hauteur de seulement 1 % du PIB, qui sera incontestablement en croissance progressive. Selon certaines estimations, l’Algérie posséderait quelques 20 % des réserves mondiales de terres rares, juste après la Chine et l’Afrique du Sud. Durant les 40 dernières années, l’économie algérienne a toujours été rythmée par la production et les prix du gaz et du pétrole. Par voie de conséquence, la transition énergétique avait des difficultés à se mettre en route. Depuis 2020, la relance du développement et la valorisation du secteur minier ont été effectifs. En ce sens, que l’Algérie a décidé d’exploiter les ressources minières disponibles et avérées pour contribuer à l’économie et l’industrie alternatives. En effet, les analyses métallo-géologiques faites par les instituts de géologie et, notamment le Service géologique des États-Unis (USGS), des différents environnements géologiques du pays ont montré qu’ils sont potentiels pour la disponibilité des minéralisations suivantes : métaux précieux (or, argent) ; pierres précieuses et semi-précieuses (diamant, topaze, béryl,…) ; métaux de base (zinc, plomb, cuivre) ; métaux ferreux et non-ferreux (fer, manganèse,…) ; éléments du groupe platine (platine, palladium, iridium,…) ; métaux rares ; minéraux industriels (phosphate, baryte, bentonite, diatomite,….).
Si nous regardons de près, l’important potentiel minier varié de l’Algérie demeure insuffisamment exploité. Son développement devrait s’articuler autour de trois axes. Le premier est le lancement à court terme des projets phares et structurants qui permettront la mise en place d’une nouvelle industrie de transformation et la valorisation des ressources minières. Il s’agit des gisements de fer, de phosphate, de zinc, de plomb et de manganèse. Le second est d’achever les projets de mise en valeur de certains gisements de minéraux industriels qui sont toujours importés par le pays, le carbonate de calcium micronisé et la bentonite. Le troisième concerne les matières nobles et rares dont les gisements sont repérés sur différentes régions du pays. En effet, le Conseil des ministres du 9 février 2024, a approuvé le projet de Loi régissant les activités minières. Les directives du président de la République sont allées dans le sens de contenir toute forme de bureaucratie dans les opérations de recherche et d’exploitation, d’élaborer de nouvelles études plus approfondies, et de différer l’exploitation de certaines terres rares sans en préciser lesquelles afin de les préserver à titre stratégique pour les développements futurs.
Toutefois, les premières explorations effectuées dans les régions du sud du pays (Tamanrasset, Ain Guezzam) par des groupes d’experts algériens et chinois, ont donné des résultats positifs qui ont permis de découvrir des indices de présence de plusieurs ressources minérales et de terres rares (wolfram, tungstène, niobium, tantale, lithium et autres). La plupart des métaux critiques et des terres rares sont situés dans les régions notamment frontalières de l’Est et du Sud-Ouest du pays. Des projets structurants majeurs sont en développement, à savoir, l’exploitation du minerai de fer de la mine de Gara Djebilet à Tindouf, de l’Or du Hoggar, celle de zinc et de plomb de la mine d’Oued Amizour dans la région de Béjaïa, ainsi que la production de phosphate intégré dans les régions de Tébessa et de Souk-Ahras.
Maroc
Le Maroc détient des ressources minières stratégiques et critiques abondantes, avec le phosphate en tête (70 % des réserves mondiales de ce minerai) ainsi que le cobalt, l’argent et le cuivre, tous essentiels pour les technologies vertes. Cette variété lui confère une position clé sur le marché des solutions énergétiques durables. Le potentiel minier permet à ce secteur d’avoir une place prépondérante dans l’économie marocaine. En effet, il contribue en moyenne annuelle à 30 % dans les exportations et à hauteur de 10 % du PIB du pays.
Le Maroc mène actuellement divers projets de prospection de terres rares. Selon l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), les investigations ont validé les ressources du gisement du Mont Tropic et du massif de Tamazight. Le nouveau plan « Maroc Mines 2021–2030 » a pour finalité de booster le secteur minier hors phosphates passant par une refonte institutionnelle de l’organisation du secteur, notamment à travers l’élargissement du périmètre d’intervention de l’ONHYM dans la recherche, l’exploration et la promotion minières.
Égypte
L’Égypte dispose de sous-sols extrêmement riches en ressources minérales, réparties dans différentes régions de son territoire composé à 96 % de désert. Elle détient une des plus grosses réserves de phosphate de la région (septième réserve mondiale), partagée entre les mines de Sebaya et le plateau d’Abu Tartour. Environ 70 % des ressources mobilisées par l’industrie pétrochimique sont extraites localement.
La péninsule du Sinaï, pour sa part dispose, des gisements de matériaux de construction : calcaire, gypse, ferromanganèse, kaolinite, sable de verre, schiste argileux, dolomite. Dans le sud de la péninsule, des gisements de grès cuprifère (cuivre) contiendraient des traces d’uranium et d’argent. L’Égypte dispose également de ressources conséquentes permettant d’alimenter son industrie métallurgique : zinc, minerai de fer, manganèse, cuivre, ilménite. Son sous-sol est doté d’intéressantes ressources minérales utilisées dans le domaine médical comme les kaolins et le tantale, dont la biocompatibilité en fait un composant idéal pour la production d’instruments chirurgicaux, d’implants, prothèses et pacemakers. Par ailleurs, une étude de faisabilité de 2006 a localisé du sable noir, contenant des minerais et métaux lourds utilisés dans les industries de pointe sur le littoral méditerranéen entre les villes de Rosette et Damiette et à l’ouest du port d’Al Arish.
La transition énergétique dans le monde
industrialisé est confrontée à une transition
générationnelle et de gouvernance des
pays détenteurs des ressources minières
stratégiques
Sous exploité, le secteur extractif (hors-hydrocarbures) contribue à hauteur de 1,3 % du PIB égyptien seulement, soit quatre fois moins que le secteur pétrolier (5,1 %) et gazier (5,8 %). Son taux de croissance annuel atteint 3,1 % en moyenne, stable tout en restant légèrement inférieur à celui du PIB total (3,5 %). La contribution du secteur minier à la croissance égyptienne est donc marginale. C’est sur la base de l’audit de la législation en vigueur réalisé par Wood Mackenzie en 2018 que le gouvernement égyptien a élaboré une nouvelle règlementation visant à renforcer l’attractivité de l’exploration minière en Égypte. Les autorités affirment que le secteur minier égyptien vise à poursuivre ses réalisations et prévoit de délivrer 300 licences par an, de lancer au moins trois appels d’offres internationaux par an et de mettre en œuvre un plan ambitieux visant à augmenter la contribution du secteur minier au PIB d’environ 6 %.
CONCLUSION
Il est indéniable que de nouvelles dynamiques mondiales ont placé l’industrie minière sous les projecteurs géopolitiques, lui accordant une attention particulière qui était généralement accordée au secteur pétrolier et gazier. Dans ces jeux d’influence, celui qui favorisera la création de la valeur ajoutée, en imposant un pourcentage de traitement des minerais bruts et de transformation dans les pays d’origine et en améliorant la formation et le transfert de compétences sera accueilli favorablement à bras ouverts. Il est clair que pour le Sud Global, il ne pourrait être indéfiniment question de vendre ses matières premières en échange de biens manufacturés, s’accordent à dire ses nouvelles élites gouvernantes.
Incontestablement la transition énergétique dans le monde industrialisé est confrontée à une transition générationnelle et de gouvernance des pays détenteurs des ressources minières stratégiques. Cette posture d’émancipation économique, deux générations après les indépendances, est largement partagée par les élites gouvernantes des pays du continent africain. Le démarrage de nouveaux projets est actuellement entravé par les lois du marché, qui présentent des défis tels que des coûts élevés, la nécessité d’investissements importants et des considérations d’acceptabilité politique, environnementale et sociale.
Les matières premières critiques sont un vecteur géopolitique majeur des transitions numérique et énergétique. Les pays qui développent l’industrie alternative grande consommatrice de minerais dans leurs efforts pour diversifier leurs relations, vont devoir adopter une approche de diplomatie minière à plusieurs niveaux. La question demeure ouverte quant au façonnage de cette approche : sera-t-elle une approche de coopération partagée ou de confrontation ?/