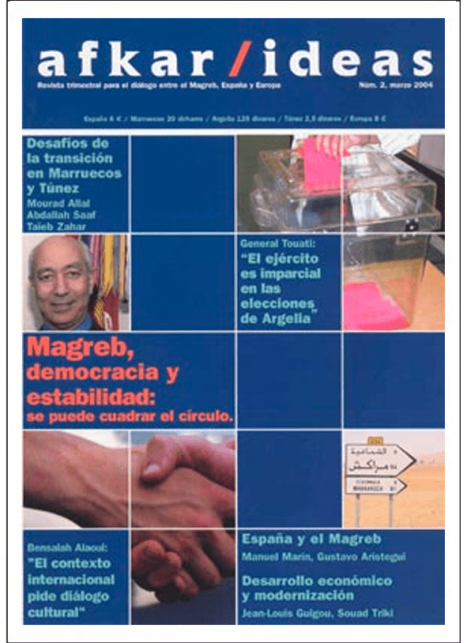Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
La Russie et le monde arabe à l’aune de la guerre en Ukraine

La politique arabe de la Russie postsoviétique repose sur trois piliers : la flexibilité, la stabilité et l’obsidionalité. La flexibilité est affichée dans la doctrine russe en politique étrangère : les alliances contraignantes et la logique de blocs sont délaissées au profit de partenariats, qui laissent une certaine marge de manœuvre. Dans les faits, les printemps arabes ont mis à mal cette posture dans la mesure où la Russie a dû choisir un camp. À l’échelle du monde arabe, la Russie était du côté de la contre-révolution (comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis). À l’échelle de la Syrie, la Russie s’est retrouvée du côté de « l’Axe de la Résistance » (au grand dam de l’Arabie saoudite, mais aussi du Qatar et de la Turquie). Il a fallu attendre ses victoires militaires décisives en Syrie pour que la Russie émerge comme un interlocuteur privilégié de l’ensemble des acteurs régionaux indépendamment des divergences perceptibles à l’occasion des printemps arabes et de la guerre en Syrie.
L’attachement à la « stabilité » passe par trois partis pris : l’importance accordée à la lutte contre le terrorisme, l’hostilité à l’égard d’un islam politique réticulaire représenté notamment par le réseau des Frères musulmans (soutenu à l’occasion des printemps arabes par le duo turco-qatarien) et le soutien apporté aux pouvoirs autoritaires et aux armées (en Syrie, mais aussi en Égypte, en Irak et clandestinement en Libye).
Enfin, l’obsidionalité désigne une mentalité d’assiégé qui vise les puissances « occidentales » (ou euro-atlantiques) au premier rang desquelles se trouve Washington. À proximité de son territoire, la Russie leur reproche l’élargissement de l’Alliance atlantique. Plus loin de son territoire, elle leur reproche une propension à l’ingérence. L’intervention militaire en Libye en 2011 et la chute du régime de Mouammar Kadhafi ont été régulièrement invoquées par Moscou pour justifier une certaine fermeté en faveur du pouvoir en place en Syrie, par exemple.
Après le tournant des printemps arabes qui ont vu se détériorer les relations entre la Russie et certains acteurs moyen-orientaux, arabes (Arabie saoudite, Qatar) ou non (Turquie), les victoires militaires obtenues en Syrie en faveur du camp loyaliste (2016-2018) et la dégradation de l’image des États-Unis (pour l’Arabie saoudite, du fait de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien ; pour la Turquie, à cause du soutien apporté par Washington aux combattants kurdes en Syrie, la défiance à l’égard de Washington ayant été exacerbée par la tentative de coup d’État de 2016) ont largement contribué à redorer le blason de la Russie au Moyen-Orient.
Avec la plateforme d’Astana (accord signé en mai 2017), la Russie s’est retrouvée au cœur d’un trio nonarabe (Russie-Turquie-Iran) exerçant une espèce de tutelle sur le territoire syrien. Parallèlement, l’ensemble des pays du Golfe – indépendamment des différends en Syrie – voient dans la Russie un partenaire incontournable. Citons ici trois exemples. En décembre 2016, la Qatar Investment Authority dépense plus de 11 milliards de dollars pour acheter 19,5 % de la société russe Rosneft. En octobre 2017, le roi saoudien, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, effectue une visite historique à Moscou. En décembre 2018, les Émirats – l’un des principaux partenaires de la Russie dans la région – rouvrent leur ambassade à Damas, ce qui traduit certesune volonté de contrer l’influence turque en Syrie, mais qui constitue aussi un signal positif en faveur du camp loyaliste appuyé par la Russie.
Avec les victoires militaires en Syrie, l’intervention clandestine en Libye et la présence en Afrique subsaharienne, la Russie a
démontré une capacité de projection insoupçonnable il y a 10 ans
L’Afrique du Nord n’est pas en reste. L’Algérie demeure un partenaire privilégié, notamment dans le domaine de l’armement. Pour la période 2015-2019, l’Algérie est le troisième client de Moscou (derrière l’Inde et la Chine). Elle achète environ la moitié des armes russes exportées vers le continent africain. Mais l’activisme russe ne se limite ni à l’Algérie ni au secteur de l’armement. Face aux sanctions et aux contre-sanctions consécutives à l’annexion de la Crimée en 2014, les échanges commerciaux russo-marocains ont connu un regain. Sur le plan géopolitique, la Russie a joué un rôle important dans l’actuel conflit libyen : comme soutien de certains acteurs (du maréchal Khalifa Haftar aux réseaux « kadhafistes ») et comme puissance médiatrice, dans le cadre d’un dialogue russo-turc, comme en Syrie.
Cette position relativement confortable de la Russie en Afrique du Nord et au Moyen-Orient a-t-elle été remise en cause par la guerre en Ukraine ? À cette question, il est possible d’apporter des réponses générales ou des réponses spécifiques à certains dossiers. A priori, la réponse est négative. Ces régions n’ont pas tourné le dos à la Russie. Mais en Afrique comme au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine semble avoir réduit sa marge de manœuvre.
Les grandes leçons diplomatiques de la guerre russe en Ukraine
Il n’existe pas de « communauté internationale » affichant une volonté de condamner et de sanctionner la Russie. Prenons les votes de l’Assemblée générale des Nations unies. En mars, à la suite de l’invasion du territoire ukrainien par la Russie, une résolution a été adoptée par l’Assemblée générale qui « exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine ». Vingt-deux pays africains n’ont pas exprimé d’opinion, soit en ne participant pas au vote, soit en s’abstenant. Si les pays qui ont voté contre sont connus pour leur place marginale sur la scène internationale (Erythrée, Syrie, Corée du Nord, Biélorussie), les absents et les abstentionnistes affichent des profils assez divers. En Asie, il s’agit de pays aussi importants que la Chine et l’Inde. En Afrique, on a affaire à des pays aussi différents que le Maroc, l’Algérie, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Soudan et l’Afrique du Sud.
Un autre vote de l’Assemblée générale des Nations unies a eu lieu en avril. Cette fois, il s’agissait de suspendre la Russie du Conseil des droits de l’homme. Les votes contre et les abstentions ont pris de l’ampleur à l’occasion de ce vote : en plus des pays susmentionnés, signalons l’abstention cette fois de l’ensemble des États du Conseil de coopération du Golfe (CCG).
Ces choix s’expliquent par trois facteurs : une défiance à l’égard des puissances « occidentales » et un besoin d’exprimer une politique étrangère autonome ; s’agissant du second vote, une méfiance vis-à-vis de la question des droits de l’homme ; enfin, une volonté claire de ménager la Russie, considérée par certains – au même titre que la Chine – comme une puissance alternative. Par ailleurs, il faut bien admettre que l’attitude de la Russie choque davantage en Europe qu’en Afrique. D’abord, parce que le continent africain demeure familier des conflits armés et des interventions militaires extérieures (les conséquences de l’intervention de l’OTAN en Libye se font encore sentir). Ensuite, parce qu’une partie des dirigeants et des opinions publiques sont sensibles aux arguments russes (sur la responsabilité de l’Alliance atlantique).
Dans ces conditions, il est possible d’affirmer que la Russie est isolée en Europe, certes, mais pas à l’échelle mondiale. En d’autres termes, en dépit de son action en Ukraine, Moscou peut encore compter sur des partenaires loin de ses frontières. Cette coopération, voire cette interdépendance, est notamment visible quand il est question des matières premières.
Un géant incontournable des matières premières
Qu’il s’agisse du blé ou des questions énergétiques, la Russie est une puissance difficilement « marginalisable ». Par conséquent, même les pays qui subissent prioritairement les conséquences de la guerre qu’elle mène en Ukraine (pénuries, inflation) n’entendent pas lui tourner le dos et, plus généralement, déplorent les sanctions comme outil de politique étrangère.
En ce qui concerne le blé, ce conflit est une menace pour la sécurité alimentaire de nombreux pays. Une nouvelle crise alimentaire, rappelant celle de 2007-2008 (hausse des prix des matières premières agricoles), serait synonyme de nouvelles « émeutes de la faim » dont les effets pourraient être aussi bien politiques (contestation des pouvoirs en place) que régionaux (migrations). À l’instar de ce qu’on a pu observer avec la pandémie, ce conflit ne fait que révéler les fragilités (sécheresses, production agricole insuffisante) auxquelles les pays arabes et le continent africain sont déjà confrontés. Le conflit vient rappeler le niveau de dépendance à l’égard du blé de la mer Noire : l’Égypte (plus gros importateur mondial de blé) dépend essentiellement de ce blé (70% des importations de blé en 2021), de même que le Yémen (60%), sachant qu’un pays comme l’Algérie – qui dépendait du blé français – a été séduit par celui de la mer Noire ces dernières années, en dépit de l’instabilité de la région.
Aujourd’hui, l’exportation des blés russe et ukrainien est bloquée par un obstacle physique (le blocage des ports et les mines) et un obstacle technique (lessanctions contre les transactions financières avec Moscou). Sur cette question, Moscou peut compter sur le soutien d’Ankara.
Pour ce qui est des hydrocarbures, l’attitude des pays du Golfe se caractérise par une certaine prudence et par un refus de céder aux pressions américaines. Il n’est pas question ici de faire subir à la Russie ce qu’on a infligé à l’Union soviétique dans les années 1980. En effet, les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), où l’Arabie saoudite tient une place centrale, ont refusé d’augmenter drastiquement leur production à l’issue de l’offensive russe en Ukraine et ont préféré se conformer à l’accord avec Moscou dans le cadre de l’OPEP+. Au début du mois de juin, une nouvelle augmentation est décidée par le duo OPEP-Russie, tandis que cette dernière doit désormais faire face à un embargo de l’Union européenne. Si certains observateurs extérieurs spéculent sur une rupture entre l’OPEP et la Russie, des pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats ont trois bonnes raisons de ne pas céder aux pressions américaines et européennes : conserver un moyen de pression vis-à-vis de Washington, consolider les relations avec une puissance qui jouit d’une influence certaine au Moyen-Orient et bénéficier d’un baril à plus de 100 dollars en limitant l’augmentation de la production.
Sur le marché du gaz, le Qatar est probablement le grand gagnant de la guerre en Ukraine. D’un côté, comme les autres pays du CCG, le Qatar entend conserver des relations cordiales avec Moscou. Malgré quelques discours fermes sur l’agression russe et l’intention exprimée de ne pas investir davantage en Russie, Doha est opposée aux sanctions économiques. De l’autre, en tant que principal exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL), le Qatar apparaît comme la principale alternative à la Russie sur le marché européen dans la mesure où l’Algérie, confrontée à une forte demande intérieure, peut difficilement compenser les exportations russes et se tourne vers les investisseurs étrangers pour explorer son sol. Entre le Qatar et la Russie, il est possible d’évoquer un partage du marché mondial : le Qatar fournirait de plus en plus de GNL à l’Europe, tandis que la Russie augmenterait ses livraisons vers l’Asie (en particulier la Chine). Là encore, la guerre en Ukraine ne fait qu’accélérer une tendance (et une méfiance à l’égard du gaz russe) perceptible depuis des décennies.
Les limites de la projection russe
En mobilisant à la fois des armées conventionnelles et des forces clandestines (les mercenaires du groupe Wagner, par exemple), la Russie a démontré une capacité de projection dans le cadre du conflit libyen et sa présence en Afrique subsaharienne ont fait de la Russie une véritable puissance mondiale, susceptible de s’imposer loin de ses frontières. Mais à quelles fins ?
La présence russe en Syrie et en Libye s’explique par plusieurs raisons. En Syrie, la Russie ne voulait pas d’un changement de régime qui lui serait défavorable ; elle entendait consolider sa présence en Méditerranée orientale (et la base de Tartous a servi au ravitaillement, à la maintenance et à l’approvisionnement de navires en direction de la mer Noire, avant le conflit en Ukraine), lutter contre le terrorisme transnational (susceptible de menacer son propre territoire) et endiguer l’influence « occidentale », après l’intervention militaire en Libye.
En Libye, quelques années après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, en soutenant Khalifa Haftar, la Russie entendait appuyer un pouvoir autoritaire, susceptible d’apporter la « stabilité » nécessaire (même si, cette fois, c’était contre le gouvernement reconnu internationalement), s’installer au cœur de la Méditerranée, récupérer les pertes financières subies après l’éviction de Kadhafi (au moins quatre milliards de dollars de contrats d’armements, selon les autorités russes) et, là encore, endiguer l’influence « occidentale ». Sur ce dernier point, en Syrie comme en Libye, il faut bien admettre que des puissances non-occidentales (la Russie et la Turquie essentiellement), jouent désormais un rôle prépondérant.
Mais ce n’est pas tout. La Russie a tendance à faire preuve d’activisme loin de ses frontières quand elle se sent menacée dans son environnement immédiat. En Afrique subsaharienne, paradoxalement, la Russie s’érige en défenseur des États en place en misant sur la clandestinité : le recours aux mercenaires du groupe Wagner. Dans sa guerre informationnelle contre la France en Afrique, la Russie pâtit aujourd’hui de l’image de ces mercenaires. En Centrafrique comme au Mali, ils sont accusés d’être liés à des massacres de civils.
L’Afrique n’est pas une priorité dans la doctrine russe. Ce qu’on appelait avant « l’étranger proche » est sa vraie priorité. Quand la Russie vient contrer l’influence française en Centrafrique et au Mali, c’est en partie pour disposer d’un levier au service de ses intérêts en Europe (en Ukraine, par exemple). On en est loin aujourd’hui. Certes, le Mali et la Centrafrique se sont abstenus à l’Assemblée générale des Nations unies. Mais on voit mal comment la présence russe en Afrique peut remédier – du moins dans un avenir immédiat – à l’isolement de la Russie en Europe. Si la Russie devait s’enliser en Ukraine et si les relations avec l’Europe dans les prochaines années devaient se résumer à des sanctions et des contre-sanctions, le Moyen-Orient et l’Afrique ressembleraient davantage à des substituts qu’à des leviers pour la Russie.
La Turquie, un partenaire précieux
D’un point de vue géopolitique, la guerre en Ukraine a eu pour la Russie des conséquences essentiellement européennes. Ailleurs, en Asie comme en Afrique, loin des sanctions, la Russie bénéficie encore d’une relative bienveillance. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est rendu le 8 juin en Turquie pour échanger sur le déblocage des céréales ukrainiennes (pas de déblocage imminent), mais aussi sur la situation en Syrie.
En dépit des désaccords idéologico-politiques exprimés à l’occasion des printemps arabes, la Russie et la Turquie ont fini par « domestiquer » leurs différends et par mettre en place un dialogue constant, censé résister aux divergences entre les deux pays. En Syrie, en Libye et dans le Haut-Karabagh, Moscou et Ankara ont beau soutenir des acteurs qui se font face. Chacun prend en compte les lignes rouges de l’autre. Au-delà de leurs relations bilatérales (qui ont trait à l’énergie, à l’armement, au commerce, au tourisme …), les deux pays partagent une même défiance anti-occidentale, alors même que la Turquie est membre de l’Alliance atlantique.
En intervenant en Ukraine, la Russie renforce la Turquie et donc s’affaiblit elle-même dans le cadre du dialogue russo-turc en Syrie
En Syrie, chacun a besoin de l’autre. Pour le dire autrement, chacun est conscient du pouvoir de nuisance de l’autre. La Russie a besoin de la coopération turque pour éviter un nouveau conflit d’ampleur contre le régime syrien et pour donner du crédit au processus politique. La Turquie a besoin de la coopération russe pour éviter une nouvelle offensive militaire à Idleb (qui serait synonyme d’un nouvel afflux de réfugiés en direction de la Turquie) et pour éloigner les combattants kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) de sa frontière.
En intervenant militairement en Ukraine, la Russie renforce la Turquie (et donc s’affaiblit elle-même dans le cadre du dialogue russo-turc en Syrie). En effet, non seulement la Russie offre à la Turquie – qui contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles, qui relient la mer Noire au bassin méditerranéen – un rôle de puissance médiatrice, mais elle la renforce aussi au sein de l’Alliance atlantique. La guerre en Ukraine pousse des pays comme la Suède et la Finlande à vouloir intégrer l’OTAN, ce qui offre à la Turquie l’occasion de brandir son veto en le justifiant par la complaisance de ces pays avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). En se rendant indispensable auprès des Américains sur ce dossier, la Turquie pourrait obtenir d’eux ce qu’elle n’aurait plus besoin d’attendre des Russes : le retrait des combattants kurdes. On n’en est pas encore là et la Russie dispose d’un atout : en cas de nouvelle offensive militaire turque en Syrie (avec un feu vert de Moscou ou, moins probablement, sans), elle pourrait contraindre les combattants kurdes à rejoindre définitivement le pouvoir syrien (et ainsi le renforcer). Mais seul leur lâchage par les Américains est susceptible de les pousser véritablement dans les bras de Damas. La Russie est loin d’être isolée au Moyen-Orient et en Afrique, comme elle l’est en Europe. Néanmoins, la guerre qu’elle mène en Ukraine a tendance à renforcer certains de ses interlocuteurs et à menacer cette sacro-sainte « stabilité » dont elle a voulu se porter garante./