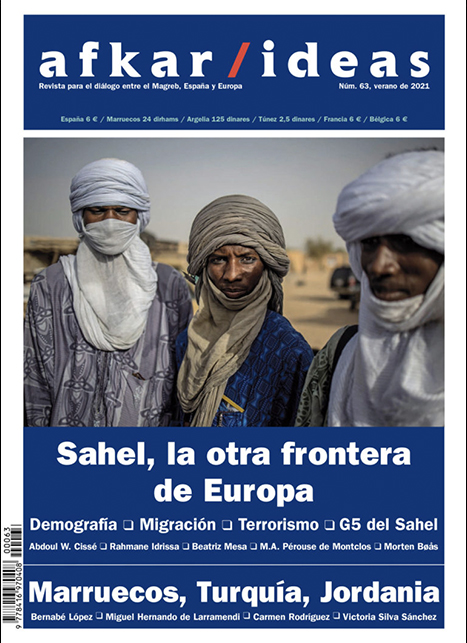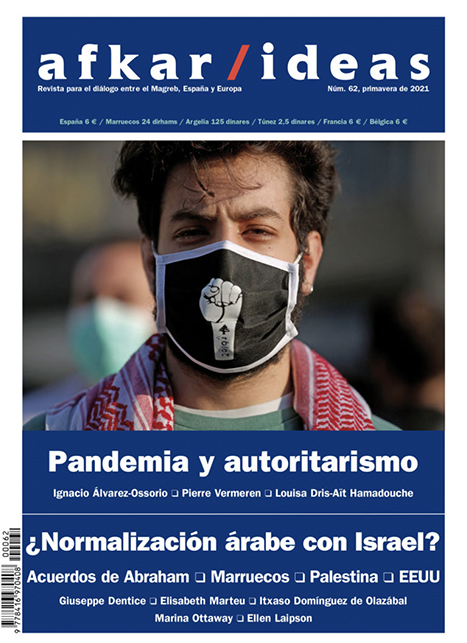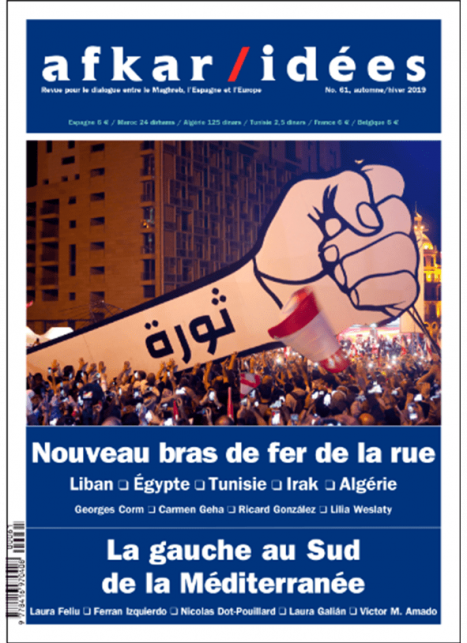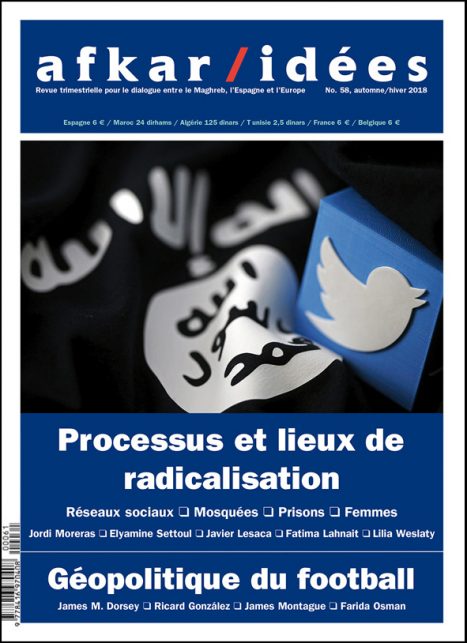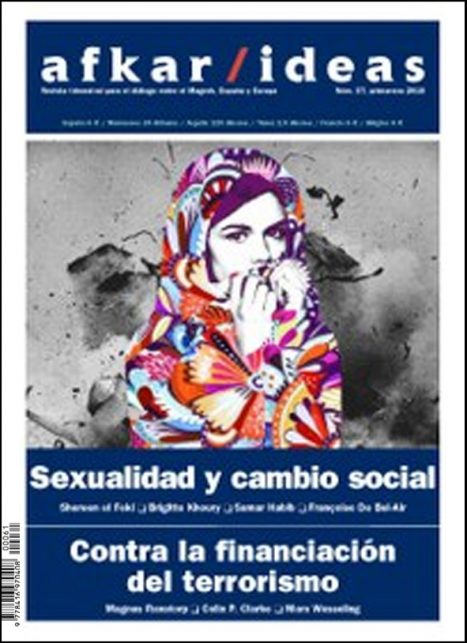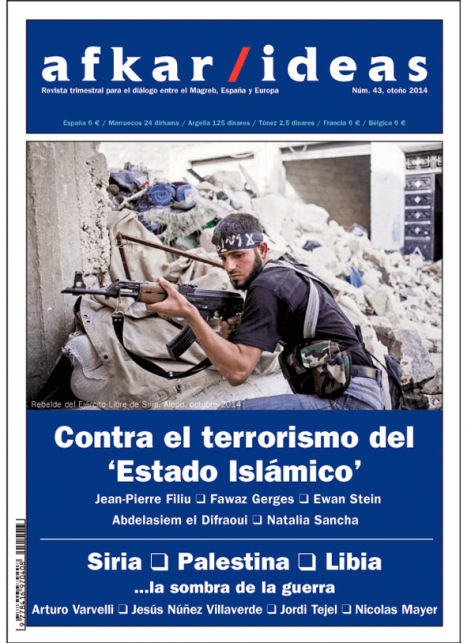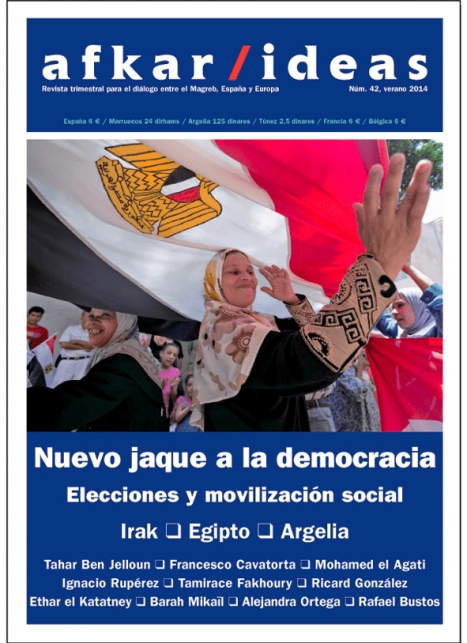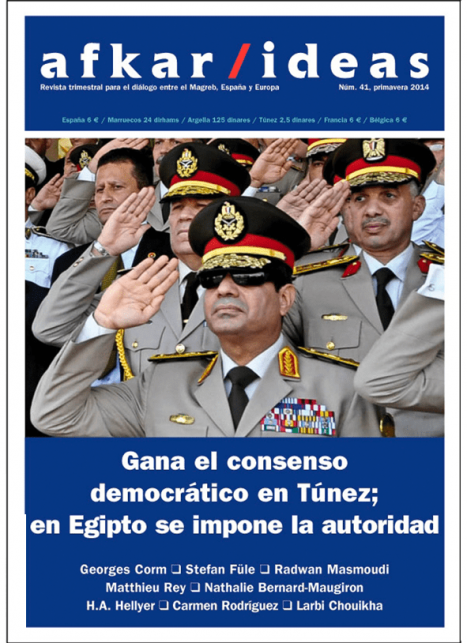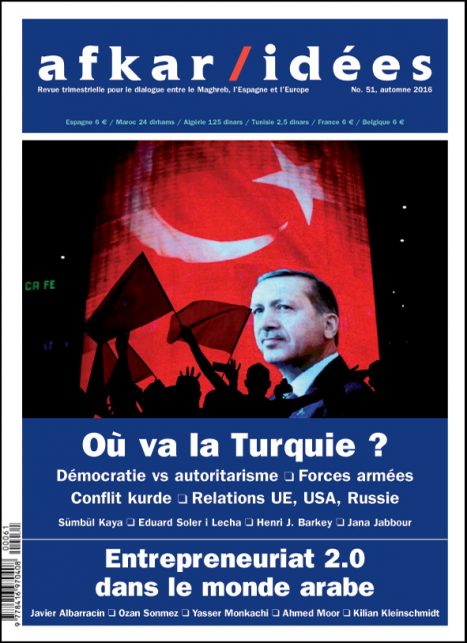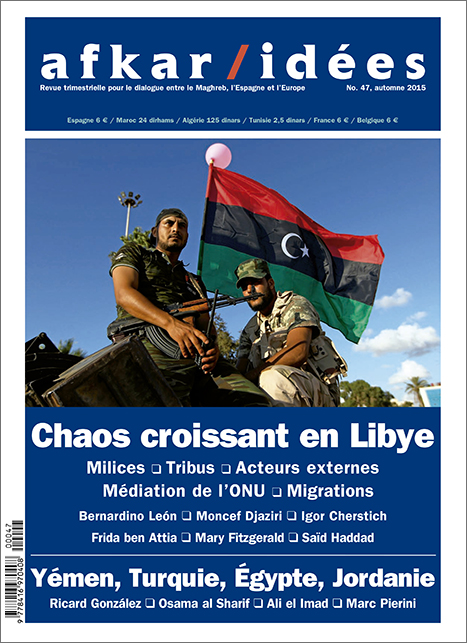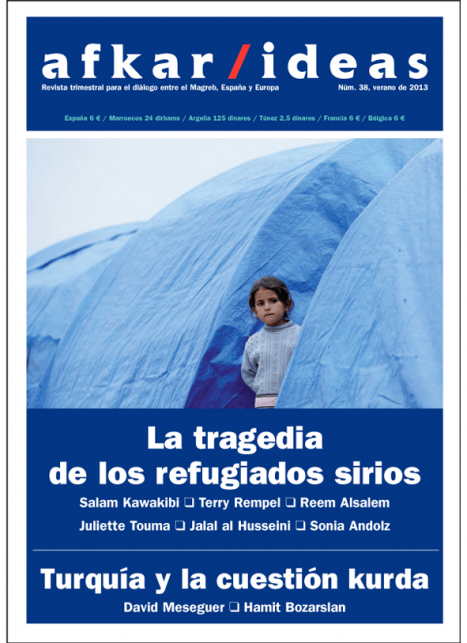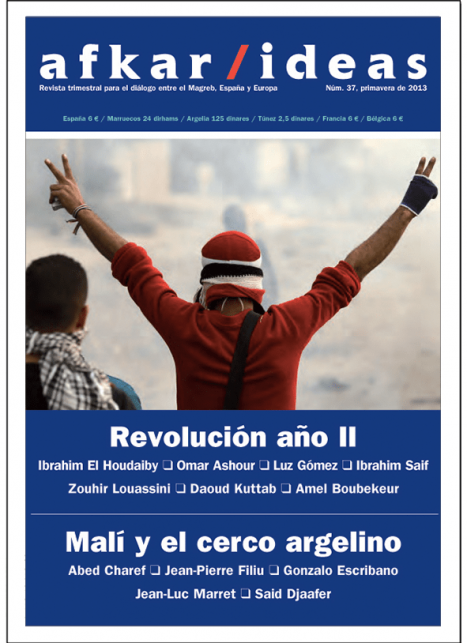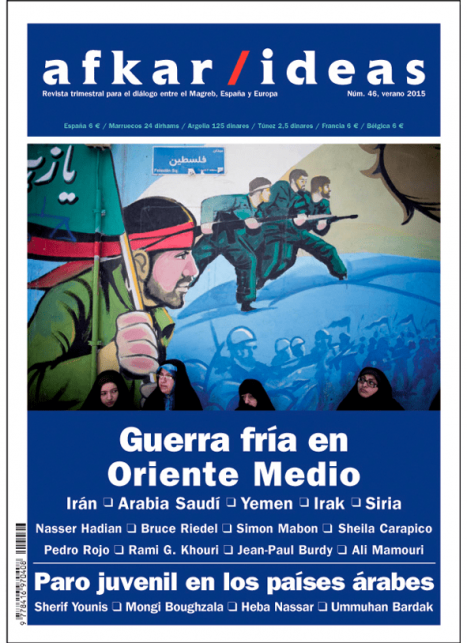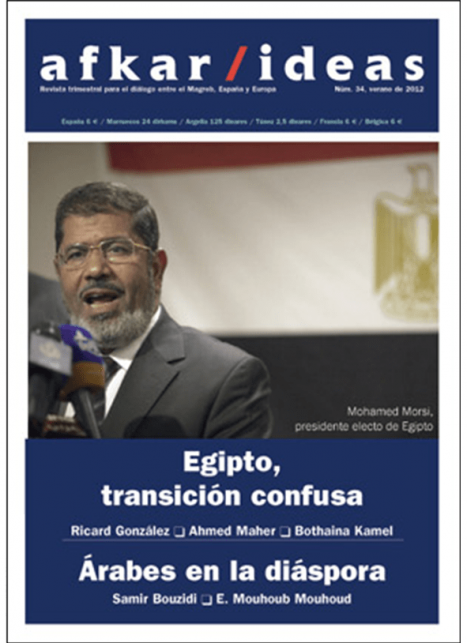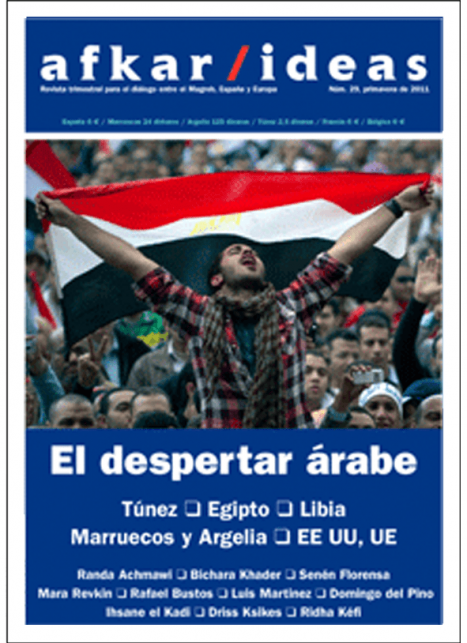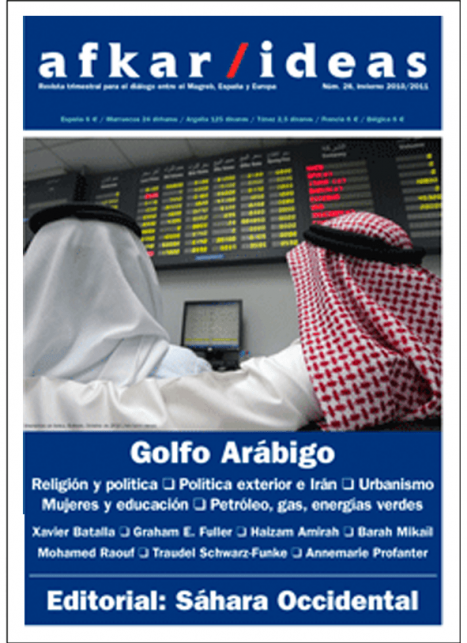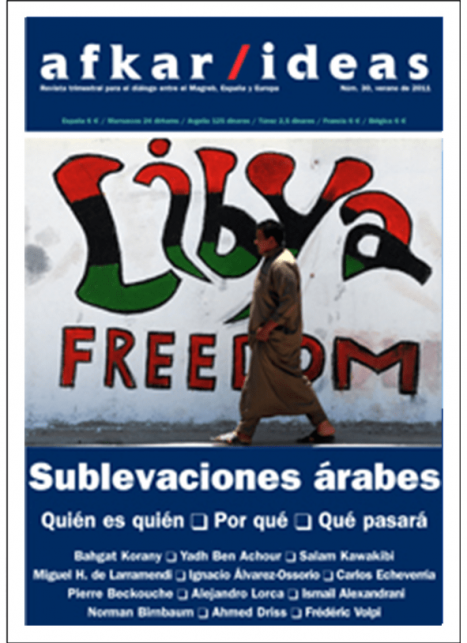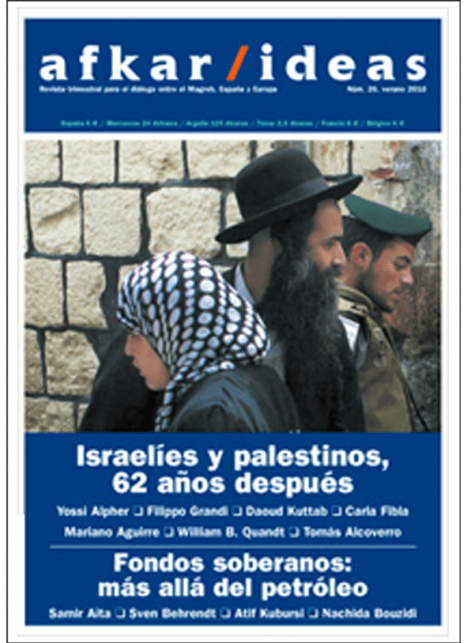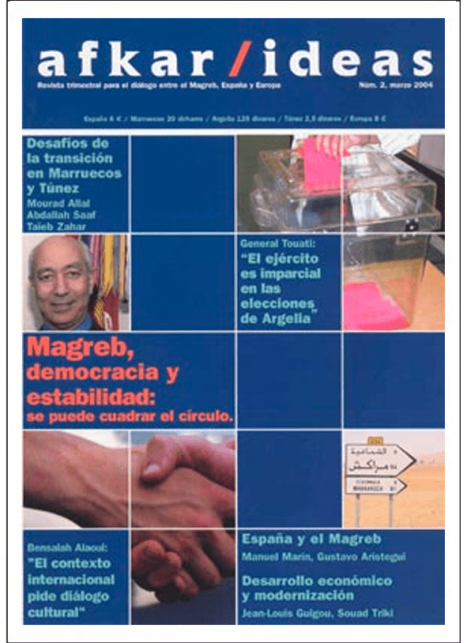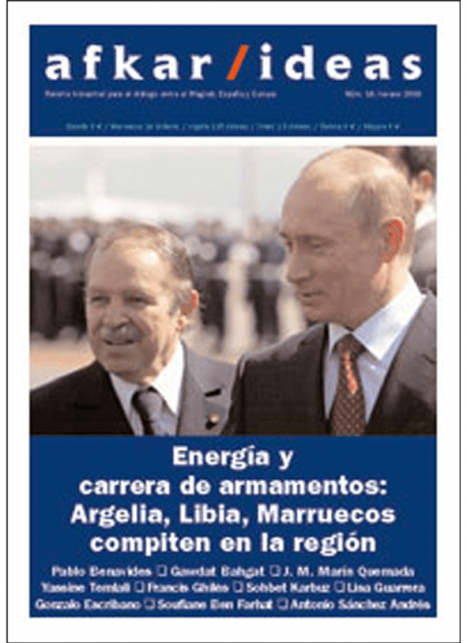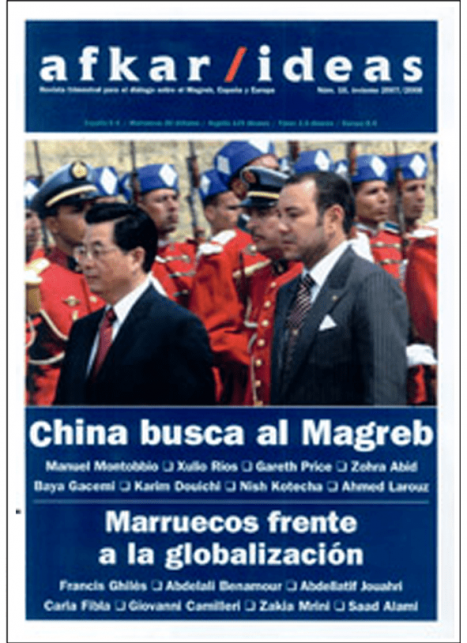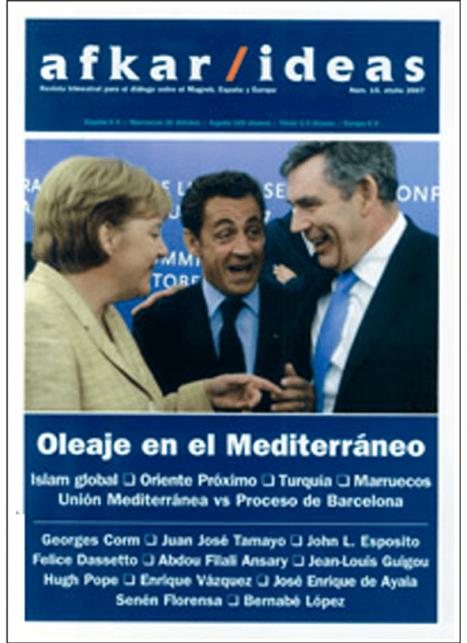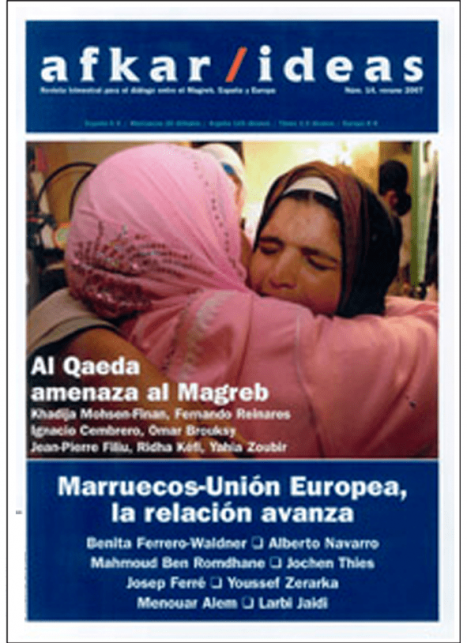Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
L’importance stratégique de la mer Rouge
Les attaques des Houthis à la suite de l’offensive israélienne à Gaza et la signature du protocole d’accord entre l’Éthiopie et le Somaliland ne sont que deux des récents événements politiques qui ont encore accru l’importance internationale de la mer Rouge. Voie de transit vitale pour le commerce maritime et les lignes de communication maritimes, la mer Rouge est située au carrefour de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et du Moyen-Orient. Elle représente un point nodal de l’initiative chinoise connue sous le nom de Belt and Road Initiative (BRI) ou nouvelle route de la soie. Ces facteurs expliquent l’intérêt croissant des acteurs extrarégionaux qui cherchent à exercer une influence dans la zone. Cependant, ils ne sont pas les seuls. Avec une population de près de 450 millions d’habitants, la région dispose d’importantes ressources qui dépassent les frontières nationales. En outre, la zone de la mer Rouge est une source essentielle de produits de base, ce qui souligne encore plus son importance économique, et présente un potentiel significatif pour la transition énergétique de l’Europe, dans la mesure où elle fournit des matières premières essentielles telles que l’aluminium, le cuivre, le phosphore et l’ammoniac.
Dans ce contexte, les acteurs régionaux et extrarégionaux sont confrontés à des défis communs. Tous sont soumis aux vulnérabilités présentées par les détroits de Bab el Mandeb et du canal de Suez. En outre, les attaques de pirates menacent la sécurité des routes maritimes. Mais ils doivent aussi faire face à d’autres défis communs, entre autres la prolifération d’activités criminelles telles que la contrebande de khat, de charbon, d’armes et de drogues, ainsi que la lutte contre le trafic d’êtres humains et la pêche illégale. L’importance géoéconomique de la mer Rouge en fait un complexe sécuritaire impliquant des acteurs locaux et divers acteurs internationaux. Nombre d’entre eux considèrent la région comme une porte d’entrée vers l’Indo-Pacifique via le transit du golfe d’Aden. L’existence d’intérêts communs entre de nombreux acteurs a favorisé la coopération et, plus important encore, la stabilité.
Cependant, le scénario de la mer Rouge dépasse sa dimension maritime. La dimension terrestre, contrairement à la dimension maritime, est marquée par une grande instabilité. La présence d’États faibles ou défaillants, de conflits intra et interétatiques, de personnes déplacées et de crises humanitaires cycliques fait des pays bordant la mer Rouge un foyer permanent d’instabilité régionale. Pourtant, tout se passe comme si ces deux dimensions n’étaient pas liées. La dernière décennie a vu se succéder des crises – du Yémen à l’Éthiopie, de la Somalie au Soudan –, dans lesquelles la dimension maritime a rarement été impliquée. Cette discontinuité entre le maritime et le côtier est donc une caractéristique structurelle de la mer Rouge. Ce n’est que récemment, à la suite de l’attaque israélienne contre Gaza, que les attaques des Houthis ont affecté la dimension maritime.
Lire l’integralité de l’article