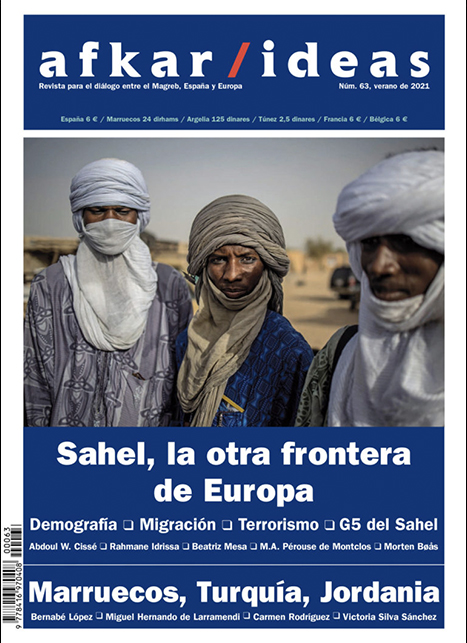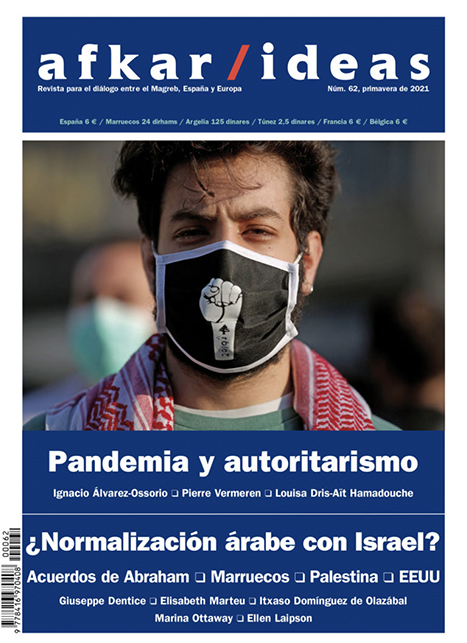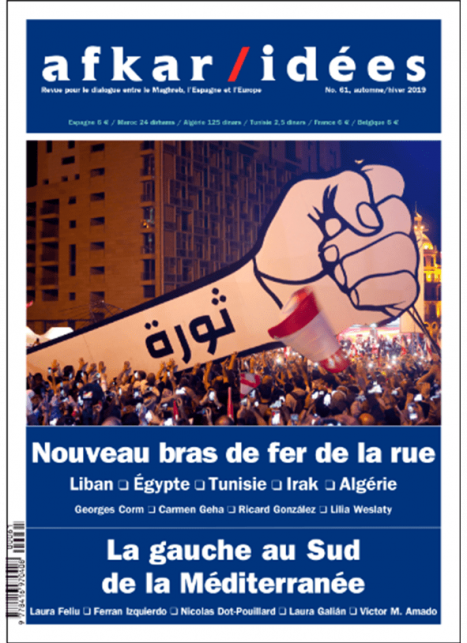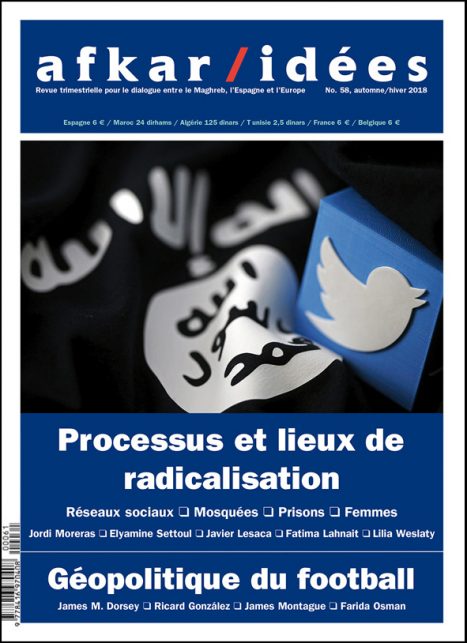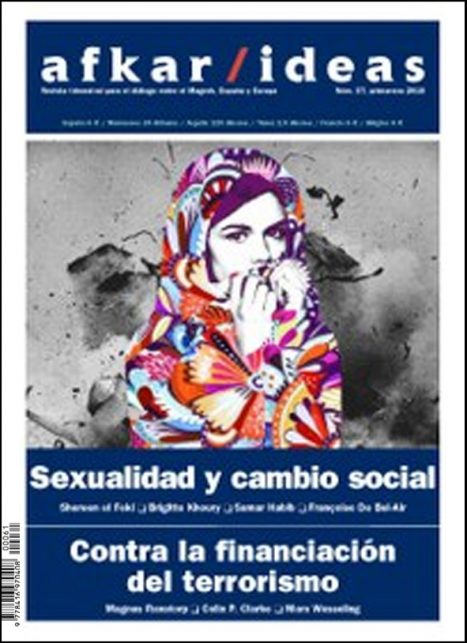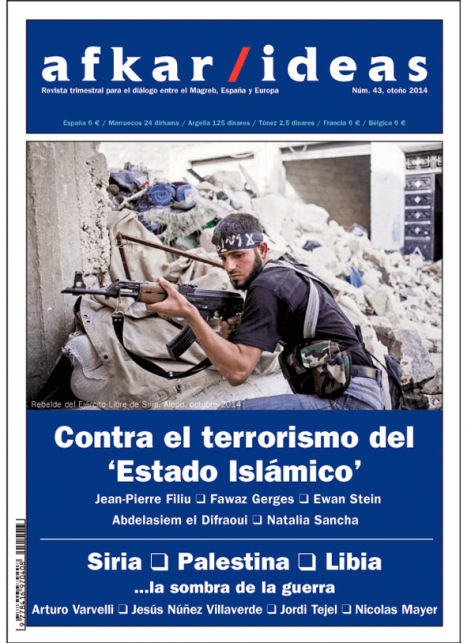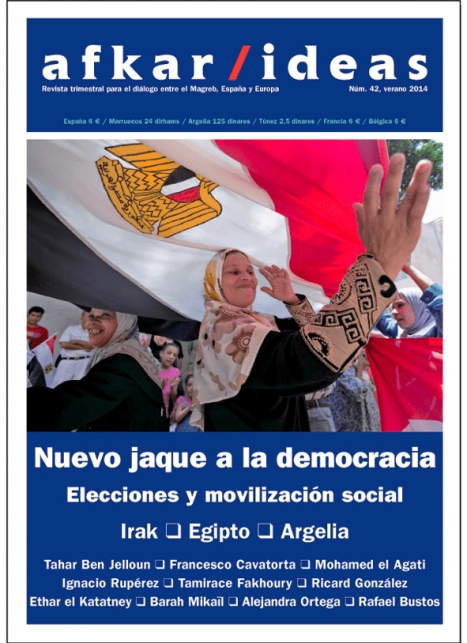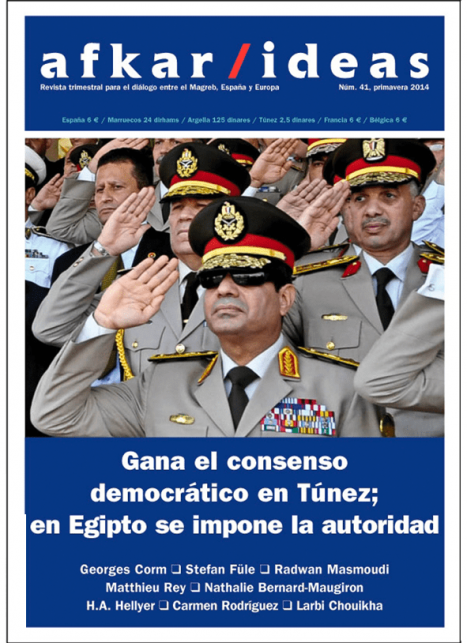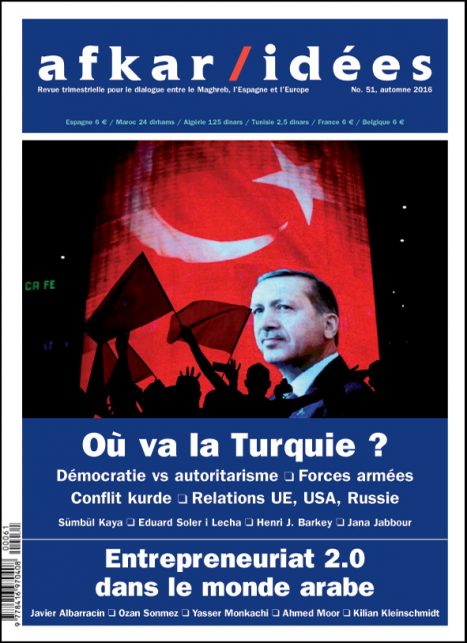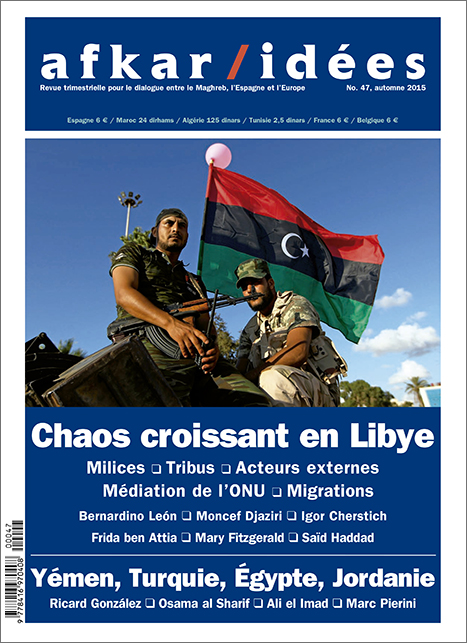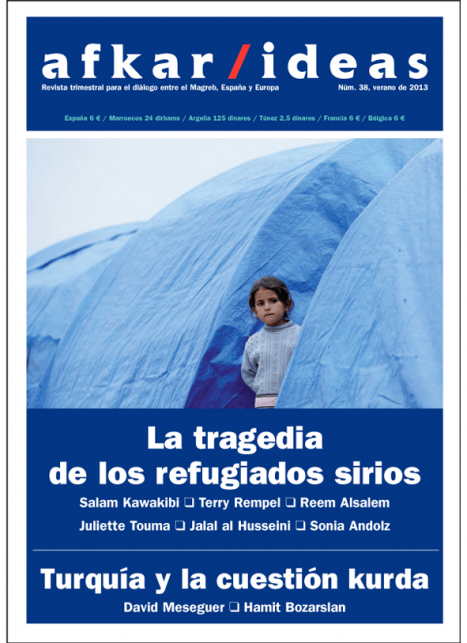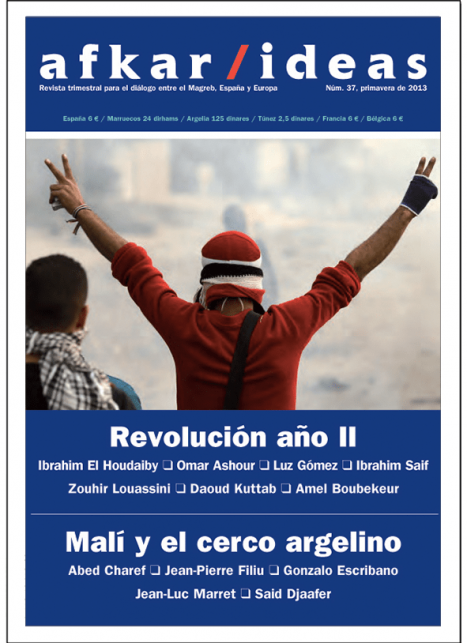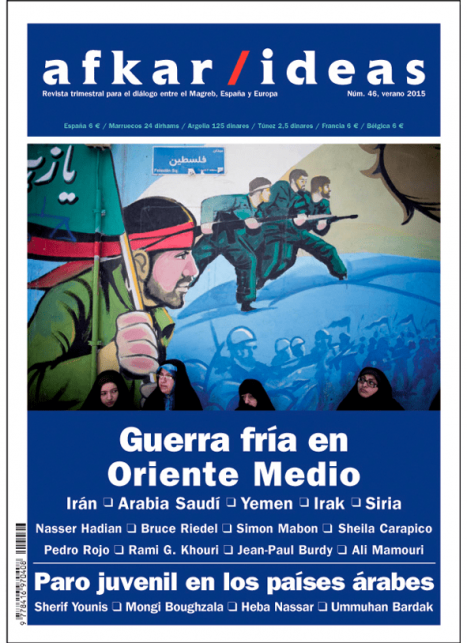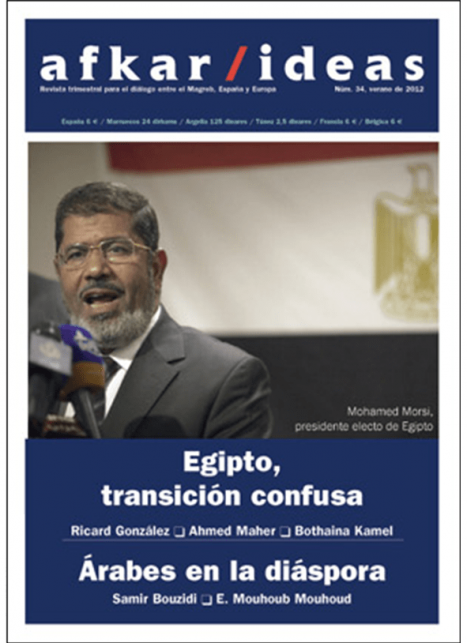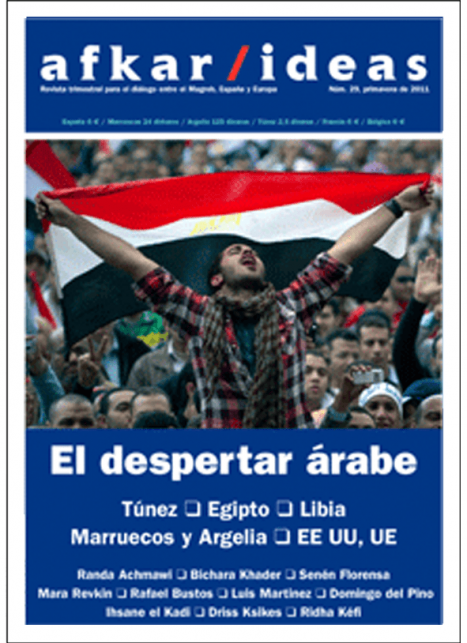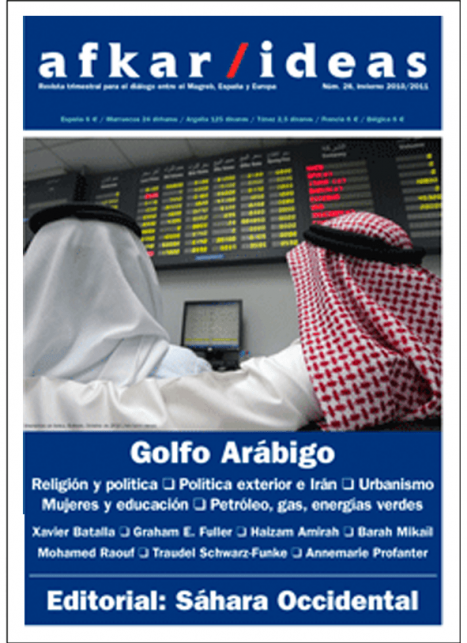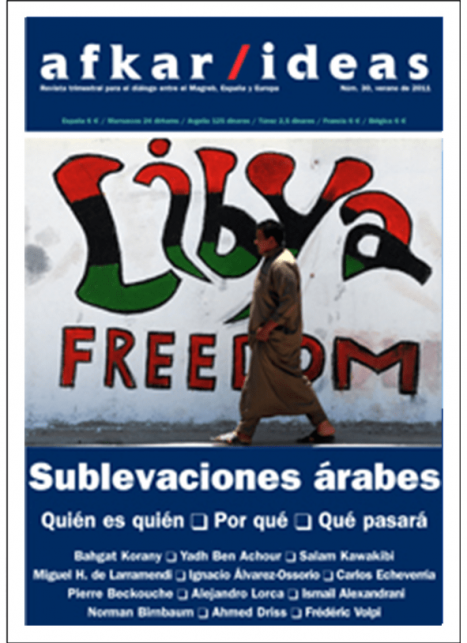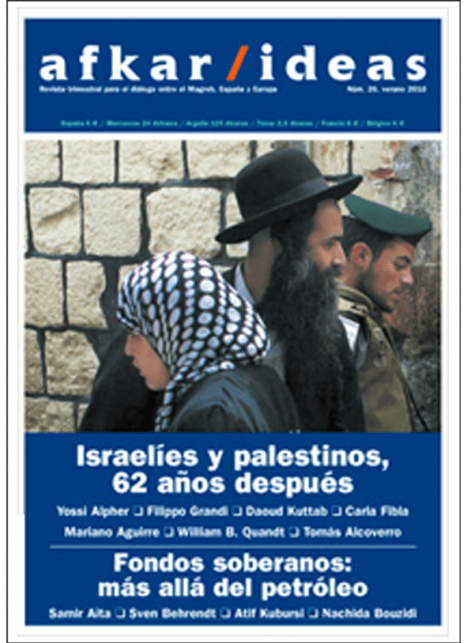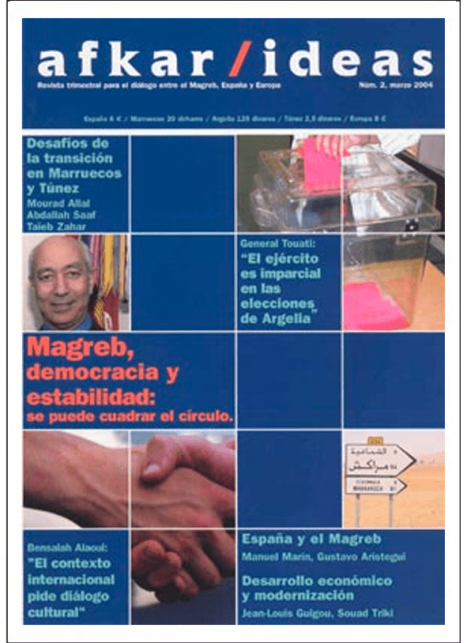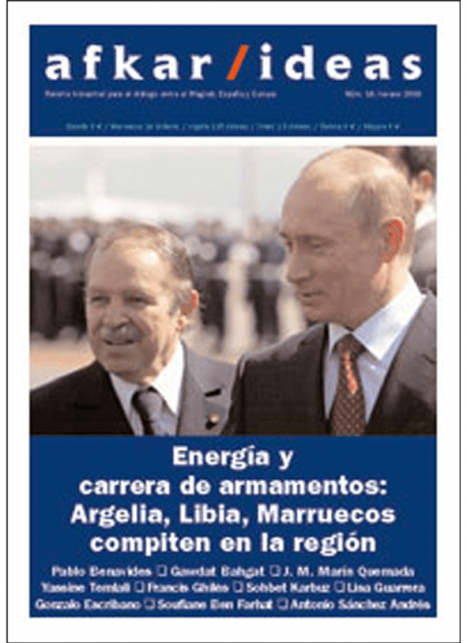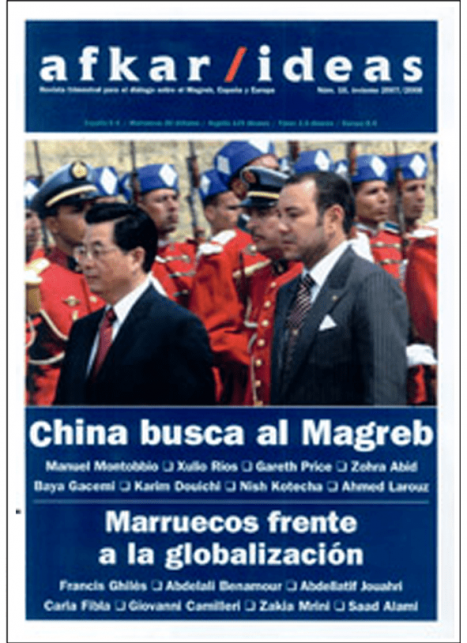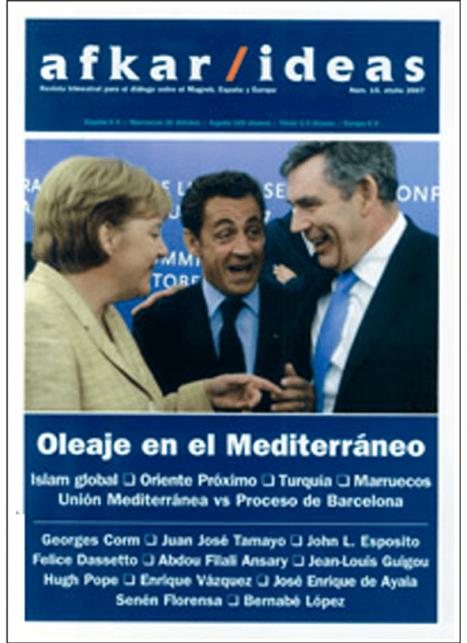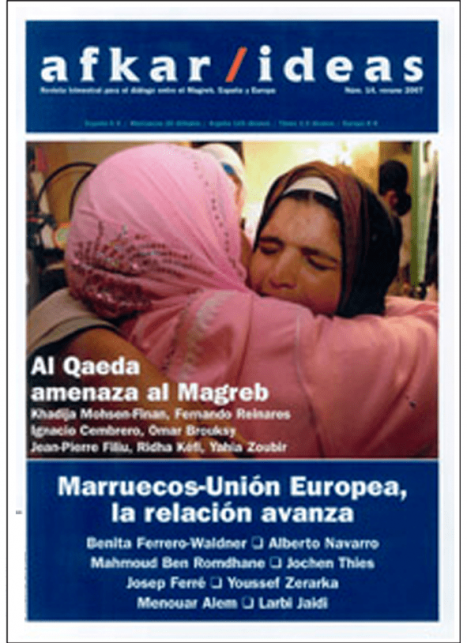Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Défis de la transition syrienne
Depuis 2018, Muhsen Al Mustafa est l’un des analystes de l’Omran Center For Strategic Studies, spécialisé dans les questions de sécurité. Basé à Istanbul pendant les années de la guerre civile syrienne, le Centre Omran était le principal think tank syrien aligné sur l’opposition au régime de Bachar Al Assad. Aujourd’hui, après sa chute, l’institution transfère ses activités à Damas. C’est là qu’a eu lieu l’entretien avec Al Mustafa, qui a également travaillé avec les think tanks américains Carnegie Middle East Center et The Tahrir Institute for Middle Eastern Policy (TIMEP).
« Il semble que Hayat Tahrir Al Cham soit conscient
que la Syrie n’est pas un État homogène sunnite, et c’est pourquoi il a déjà déclaré qu’il ne construirait pas un État sectaire »
Que pensez-vous du système dit de « réconciliation » qui permet aux officiers et aux policiers du régime de Bachar Al Assad de demander une amnistie ?
Je pense que c’est une bonne idée et une étape nécessaire pour les réintégrer dans la nouvelle Syrie. Le système permet de résoudre plusieurs problèmes pratiques à court terme. Tout d’abord, le fait qu’ils s’enregistrent et remettent leur carte d’identité militaire aidera les enquêtes à déterminer qui a commis des actes de torture et des crimes de guerre. Ensuite, ils doivent remettre leurs armes dans les centres d’enregistrement, ce qui constitue une contribution importante au processus de désarmement de la population après 13 ans de guerre civile. Enfin, ils reçoivent une carte d’identité temporaire valable pour une période de trois mois, qui leur permettra de se déplacer librement dans le pays. À la fin de cette période, ils doivent retourner au poste de police. En Syrie, lorsque vous rejoigniez l’armée, on vous retirait votre carte d’identité civile et on vous donnait une carte d’identité militaire. Ceux qui ne s’enregistreront pas auprès des nouvelles autorités risquent d’être arrêtés à un quelconque poste de contrôle d’identité parce qu’ils n’ont pas de carte d’identité civile.
De nombreux Alaouites considèrent les campagnes d’arrestation d’anciens fonctionnaires comme une forme déguisée de vengeance contre la communauté. Êtes-vous d’accord ?
Non, ce n’est pas vrai. Ce qui se passe, c’est que la communauté alaouite [environ 12 % de la population] était surreprésentée dans les forces de sécurité, d’où cette perception. Mais les campagnes et les incursions des forces de sécurité pour arrêter des officiers et des dirigeants paramilitaires qui n’ont pas participé au processus de réconciliation n’ont pas seulement visé les Alaouites, des officiers sunnites ont également été arrêtés. Certains ont résisté violemment, ce qui a donné lieu à des fusillades et à des affrontements. Au cours de ces hostilités, certains ont été tués, comme Shuja Al-Ali.

Pensez-vous que l’émergence d’une insurrection dans les zones à majorité alaouite va s’aggraver ?
Oui, c’est un scénario très inquiétant mais de plus en plus plausible. Ces régions, considérées comme des bastions du régime d’Al Assad, sont devenues instables principalement en raison des fractures au sein de la communauté alaouite elle-même et des actions des vestiges du régime qui cherchent à instrumentaliser l’identité sectaire. Des personnalités telles que Ghiath Dalla ont exploité les liens familiaux, les revendications locales et les réseaux d’anciens agents de renseignement pour rétablir des structures armées dans ces régions montagneuses et socialement soudées. Leur stratégie repose non seulement sur l’action militaire, mais aussi sur la réaffirmation de leur domination sur les communautés locales par la peur, la coercition et la promesse d’un rétablissement du statut.
Le poids symbolique que représente le fait de déclencher une rébellion au cœur de l’ancien régime vise également à envoyer un message, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, selon lequel l’« État profond » n’est pas mort. Le danger tient à la manière dont cette insurrection pourrait évoluer, passant d’attaques isolées à une force durable et intégrée. Le terrain, combiné à des structures claniques complexes et à des décennies de pouvoir sécuritaire, crée les conditions idéales pour des opérations clandestines et une survie à long terme. Si le nouveau gouvernement ne parvient pas à convaincre les communautés alaouites par le biais d’une gouvernance inclusive, d’une amélioration économique et d’une réforme du secteur de la sécurité qui les englobe au lieu de les cibler, il risque de laisser un vide que les insurgés ne demandent qu’à combler.
e plus, des acteurs extérieurs tels que l’Iran pourraient trouver un intérêt à maintenir un conflit de faible intensité dans cette région afin d’exercer une pression sur Damas et de gagner en influence. La situation exige une intervention urgente et réfléchie, non seulement sur le plan militaire, mais aussi par la réconciliation, la réintégration et la rupture du monopole de la peur que des personnalités comme Dalla exercent encore sur des segments de la population alaouite.
Comment l’armée est-elle en train de se reconstruire ?
Pour l’instant, elle est en train d’intégrer des groupes armés de l’ancienne opposition. Peut-être qu’à l’avenir, certains officiers de l’armée d’Al Assad seront également intégrés. Le processus de réforme du ministère de la Défense avance et une nouvelle chaîne de commandement unifiée est déjà en cours de création, mais le processus est lent, ralenti par le fait qu’Israël a détruit la majeure partie de l’infrastructure militaire. La priorité est donnée à l’infanterie pour contrôler les frontières et, surtout, pour mettre fin à la contrebande, ce qui a donné lieu à quelques affrontements à la frontière libanaise. D’autre part, il y a eu une controverse parce que certains officiers sont des combattants étrangers qui recevront la nationalité syrienne, mais je ne vois pas cela comme un problème. Beaucoup d’entre eux risquent la torture s’ils retournent dans leur pays d’origine, c’est donc un bon moyen pour résoudre la situation.
« Le poids symbolique que représente le
fait de déclencher une rébellion au cœur de
l’ancien régime vise à envoyer un message,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, selon
lequel l »État profond’ n’est pas mort »
Quelle est votre évaluation de l’accord entre Damas et les Forces démocratiques syriennes (FDS) à majorité kurde ?
Il constitue une étape importante, bien que fragile, vers la reconfiguration de l’État syrien selon des lignes plus inclusives et pragmatiques. Le gouvernement d’Ahmed Al Charaa cherche à construire une nouvelle réalité politique basée sur la coexistence plutôt que sur la domination, comme c’était le cas précédemment sous le régime d’Al Assad. L’accord pourrait également servir de mécanisme de stabilisation : il permet la réintégration du nord-est dans le cadre national, réduisant ainsi le risque de conflit ouvert entre les deux parties.
Cependant, le succès à long terme de l’accord dépendra de la manière dont ses termes seront mis en œuvre et de la façon dont ils seront perçus par les différents groupes. Pour les Kurdes et les autres groupes sous l’égide des FDS, la question clé est de savoir si Damas acceptera réellement les structures de gouvernance locale et les droits culturels, ou s’il cherchera simplement à les absorber dans une version rebaptisée de l’autorité centrale. Pour les puissances régionales, en particulier la Turquie et l’Iran, l’accord ouvre de nouvelles perspectives : Ankara pourrait considérer toute intégration kurde comme une menace si elle ne se concrétise pas comme souhaité, tandis que Téhéran pourrait y voir une dilution de son influence. Sur le plan intérieur, si l’accord s’accompagne de mesures significatives en faveur de la justice et du partage du pouvoir, il pourrait créer un précédent pour une réconciliation nationale plus large. Dans le cas contraire, il risque de devenir une nouvelle trêve tactique dans un pays toujours en proie à la fragmentation et à la méfiance.
« Je ne serais pas surpris que les bases
russes se maintiennent. La Russie est un
pays important et de nouveaux points de
coopération peuvent être recherchés. Nous
devons être pragmatiques »
Pensez-vous que le processus politique actuel aboutira à un système démocratique ?
C’est une question difficile. Pour l’instant, la priorité de la plupart des Syriens est de retrouver la sécurité et d’améliorer les conditions de vie. Ils demandent des solutions à des problèmes pratiques, comme le manque d’électricité [il y en a environ trois heures par jour], ou la pénurie de pétrole. Il n’y a pas d’inquiétude sur le fait que le gouvernement intérimaire soit composé de personnes proches de Hayat Tahrir al Cham (HTS). Dans une certaine mesure, il est normal que le HTS ait choisi des personnes en qui il a confiance. Le processus politique prendra du temps et ne sera pas facile. La prochaine étape consistera à convoquer une Conférence nationale de dialogue, à laquelle seront invitées quelque 1 200 personnes et où seront représentées toutes les forces politiques et les minorités du pays. Le succès de cette conférence n’est pas garanti, car certains s’attendent à être invités et seront en colère s’ils ne le sont pas.
Ahmed Al Charaa a fixé un délai de quatre ans pour la tenue des élections. Que se passerait-il si elles avaient lieu maintenant ou dans les prochains mois ?
Je pense qu’Al Charaa pourrait obtenir 60 % des voix. L’opposition à l’étranger n’est pas populaire à l’intérieur du pays. Elle est considérée comme un groupe inopérant qui n’a pas été capable de libérer un seul détenu. Elle n’est pas bien organisée, pas même un parti autrefois puissant comme les Frères musulmans.
Y a-t-il un risque qu’avec un tel niveau de soutien et une fois autoproclamé président intérimaire, il tente d’établir un État islamique et qu’il n’y ait pas d’élections libres ?
Il semble que le HTS soit conscient que la Syrie n’est pas un État homogène sunnite, raison pour laquelle il a déjà déclaré qu’il ne construirait pas un État sectaire.
Qu’adviendra-t-il des bases russes en Syrie ?
Des négociations sont en cours entre Moscou et le nouveau gouvernement, et je ne serais pas surpris que les bases soient maintenues. Les chances sont de l’ordre de 75 %, selon moi. La Russie est un pays important et de nouveaux points de coopération peuvent être recherchés. Nous devons être pragmatiques. Par exemple, nous devrons reconstruire l’armée, dont les capacités ont été presque entièrement détruites par les bombardements israéliens. Qui nous vendra les armes ou formera nos soldats ?
Certainement pas les États-Unis. De plus, Moscou pourrait également contribuer à la pacification de la région alaouite, où ils ont de nombreux contacts. D’autre part, l’accord actuel leur donne le droit de rester plus de 40 ans, et le droit International oblige à le respecter, même s’il a été signé par l’ancien régime. Il peut être rompu, mais ce n’est pas facile. Une fois le nouveau Parlement en place, l’accord pourrait être amendé et certaines conditions pourraient être modifiées, par exemple en réduisant la durée de maintien des bases.
Ce même pragmatisme ne s’applique pas aux relations avec l’Iran…
La situation n’est pas comparable. La Russie est une puissance mondiale qui dispose d’un droit de veto au Conseil de sécurité et avec laquelle il est bon de s’entendre. Ce n’est pas le cas de l’Iran. De ce fait, c’est Téhéran qui a envoyé des messages suggérant de tourner une nouvelle page dans les relations bilatérales, mais qui n’a pas reçu de réponse positive. Peut-être cela se produira-t-il à l’avenir. Pour l’instant, Damas n’est pas pressée. Outre les crimes commis aux côtés d’Al Assad, l’un des problèmes est que l’Iran réclame 30 milliards de dollars de dettes pour l’aide qu’il a accordée au régime d’Al Assad, que la nouvelle administration ne veut pas rembourser. Les relations avec l’Irak ne sont pas faciles non plus, et il y a des réticences. Al Charaa a combattu en Irak et des milices irakiennes ont également combattu en Syrie.
L’Iran et la Russie en passe d’être écartés, quels pays seront désormais les principaux alliés de Damas ?
Le Qatar et la Turquie, ainsi que l’Arabie saoudite, destination du premier voyage officiel d’Al Charaa à l’étranger. Ces trois pays s’efforcent d’aider la nouvelle administration et le peuple syrien. Par exemple, Doha et Riyad ont demandé aux États-Unis de lever les sanctions. Le Qatar, de plus, pourrait peut-être aussi aider en jouant un rôle de médiateur auprès d’Israël pour qu’il se retire des territoires occupés du Golan après la chute du régime. D’ailleurs, il joue déjà ce rôle à Gaza. La Syrie ne constitue aucune menace pour Israël et ne tentera pas de reprendre les territoires par la force. Je crains toutefois qu’Israël ne veuille pas se retirer du mont Hermon, qui représente pour eux une position stratégique importante.
L’Égypte et les Émirats arabes unis (EAU), très hostiles à l’islamisme politique, peuvent-ils tenter de saboter la transition en Syrie ?
En ce qui concerne l’Égypte, il faut noter que depuis la chute d’Hosni Moubarak, elle a perdu beaucoup de poids dans la région. Nous n’avons pas de frontière commune et sa capacité d’influence en Syrie est limitée, ce n’est donc pas un problème sérieux. Quant aux EAU, c’est plus compliqué car plusieurs milices rebelles, et pas seulement le HTS, sont considérées comme des groupes terroristes. Mais le ministre des Affaires étrangères Al Shaibani s’est déjà rendu deux fois aux EAU, et des rumeurs laissent entendre qu’Al Charaa se rendra également dans le pays prochainement. Le message de la nouvelle administration, selon lequel la Syrie ne veut être une menace pour personne et que toutes les énergies seront consacrées à la reconstruction de l’État, devrait apaiser les inquiétudes de ces deux capitales. De plus, ici, il n’y a pas d’Abdelfattah al Sissi, ni de Khalifa Haftar, ni de possibilité de retour d’Al Assad. Ils doivent comprendre que toute la région, et même l’Occident, à tout intérêt à ce que la Syrie soit stable.
À ce sujet, comment évaluez-vous les relations avec les pays occidentaux ?
Il y a eu plus d’émissaires européens en deux mois qu’au cours des 10 dernières années sous Al Assad ! C’est très positif. L’Allemagne, par exemple, a déjà alloué 200 millions d’euros d’aide. Je pense que l’Union européenne lèvera les sanctions avant les États-Unis. Les relations avec l’administration Trump ne seront probablement pas faciles, car elle défend l’idée qu’Israël annexe de nouveaux territoires.
Comment jugez-vous la situation économique du pays, y a-t-il une évolution positive ?
La situation économique reste fragile, principalement en raison des sanctions économiques qui rendent impossibles les investissements ou l’aide financière de l’étranger. Le gouvernement a pris des mesures positives, par exemple en réduisant les droits de douane à l’importation, ou en autorisant les exportations vers la Turquie, interdites depuis 2011. L’écart important du taux de change avec le dollar entre le marché noir et la Banque centrale – 9 000 livres contre 13 000 livres –
pose problème. Les prix restent élevés. La question des salaires des fonctionnaires n’est toujours pas réglée. La nouvelle administration a promis une augmentation de 400 %, mais ne l’a pas encore mise en œuvre. Certains problèmes sont apparus, notamment des rumeurs selon lesquelles un État du Golfe pourrait débourser l’aide financière nécessaire, mais les sanctions l’ont empêché. En outre, on a découvert que jusqu’à 400 000 fonctionnaires n’exerçaient aucune fonction et ne se rendaient même pas à leur bureau. Le régime d’Al Assad les avait embauchés pour des raisons politiques ou pour assurer la paix sociale.
Connaissez-vous le nombre de réfugiés qui sont déjà rentrés chez eux et prévoyez-vous un retour rapide et massif ?
Au cours du premier mois, quelques 100 000 personnes sont revenues, et à l’approche de l’été, ce nombre augmentera de manière significative. Pour de nombreuses familles, la priorité est que leurs enfants puissent terminer l’année scolaire en cours. Pour beaucoup d’enfants, le retour constituera un défi parce qu’ils s’expriment et écrivent mieux en turc qu’en arabe. C’est le cas de ma propre fille de sept ans. Un autre problème plus grave est que les maisons de nombreux réfugiés sont détruites. Des quartiers entiers ont été détruits et, par exemple, les transports publics n’y ont plus accès. Ce sera un grand défi pour la nouvelle administration./