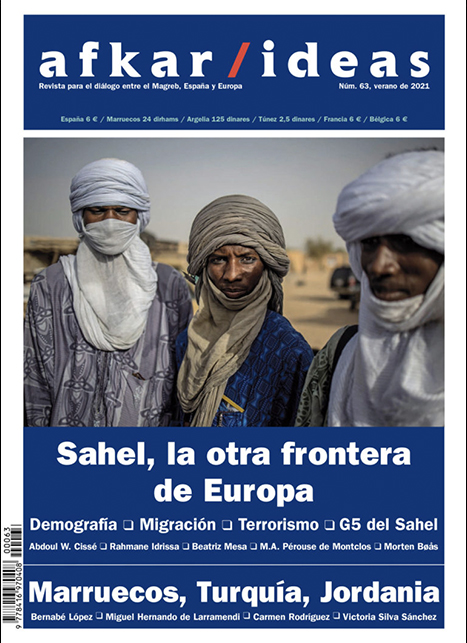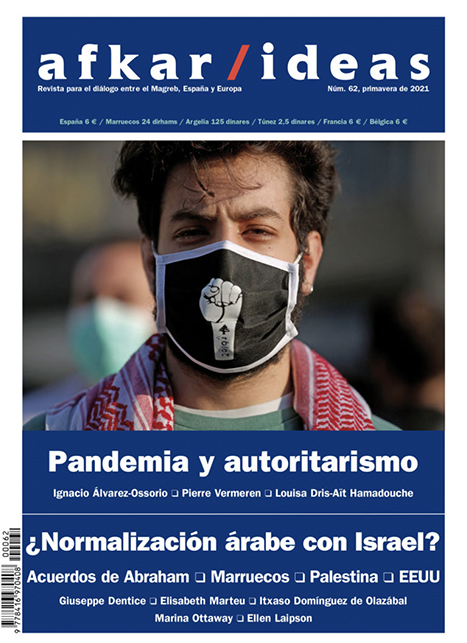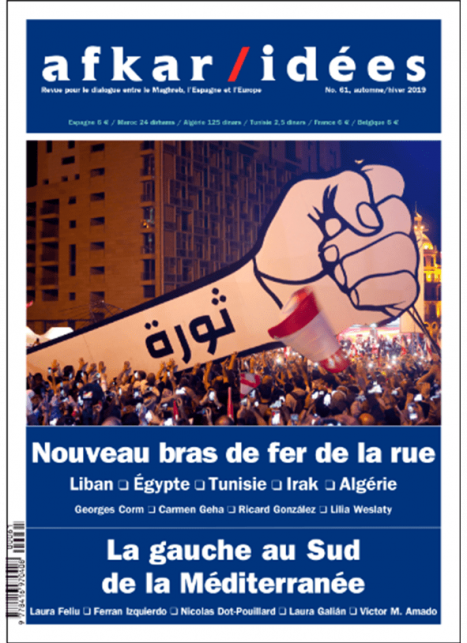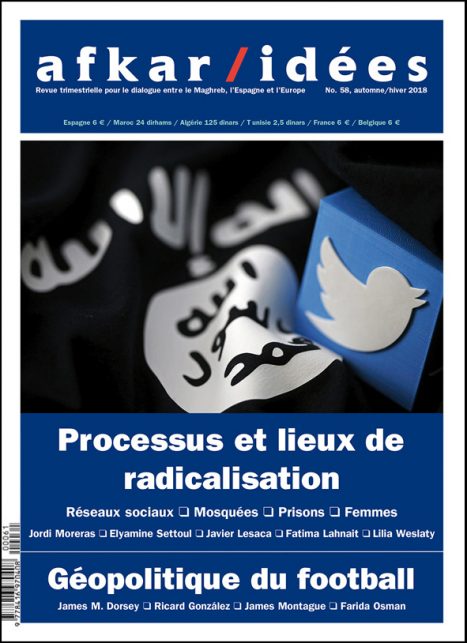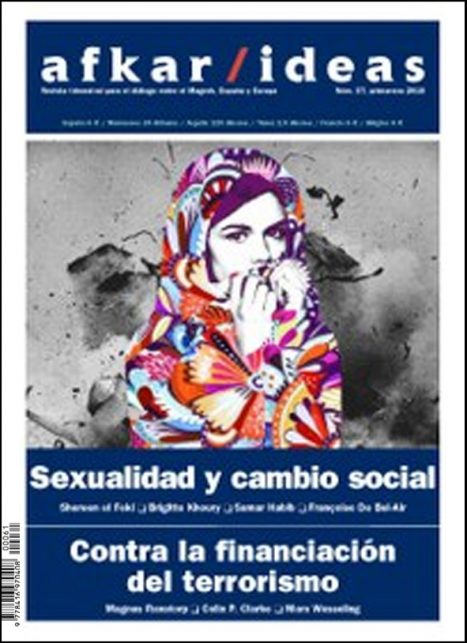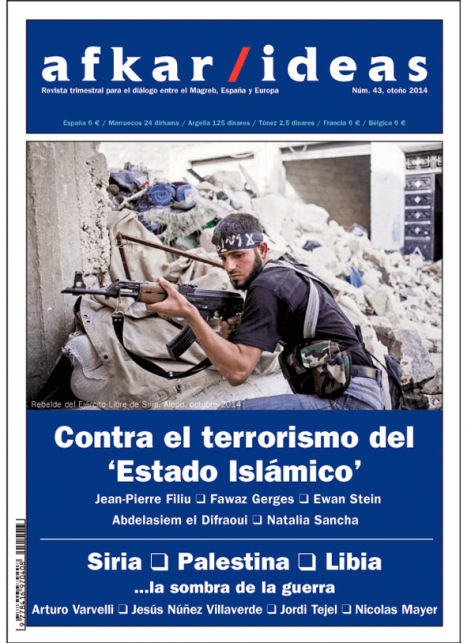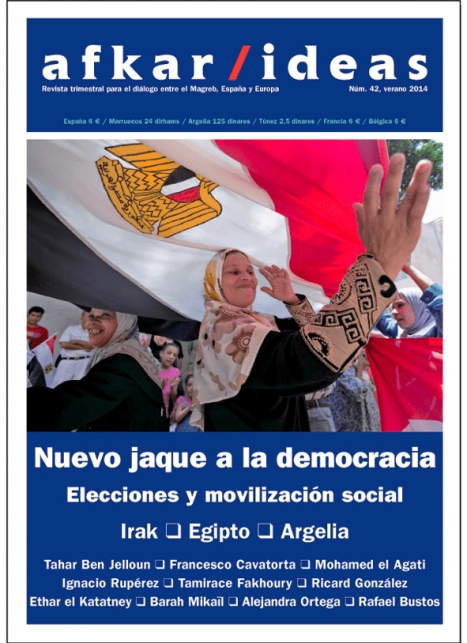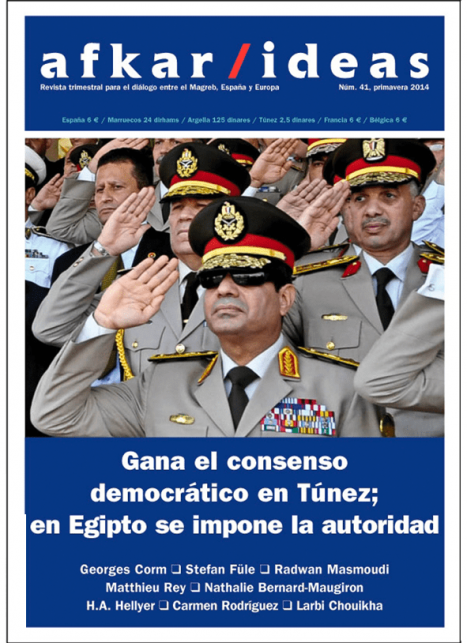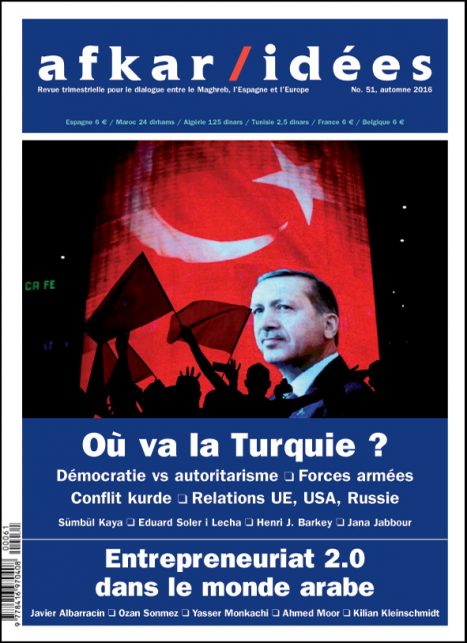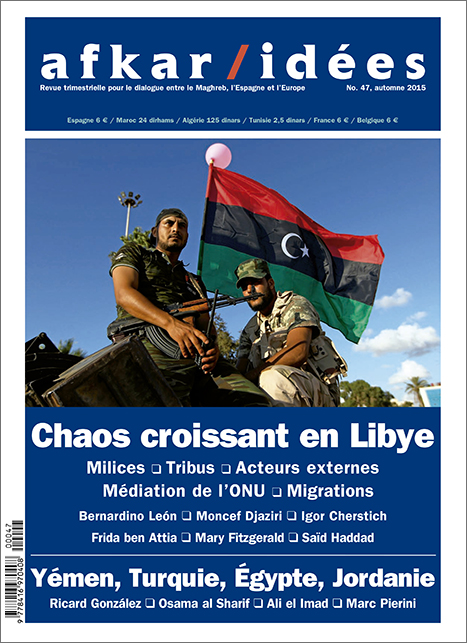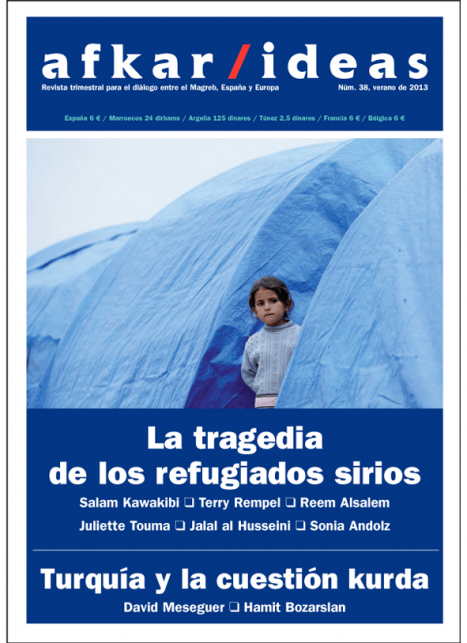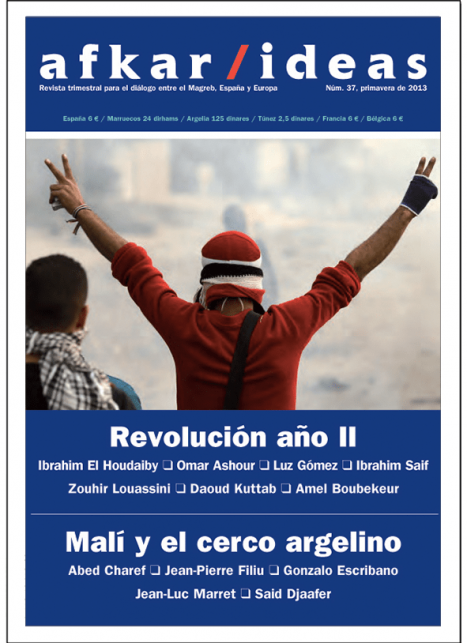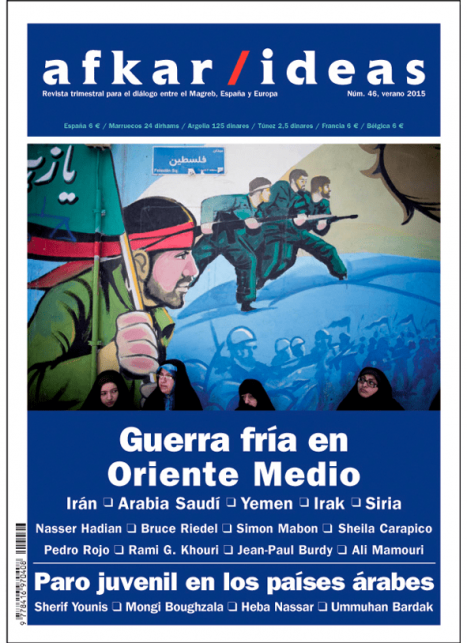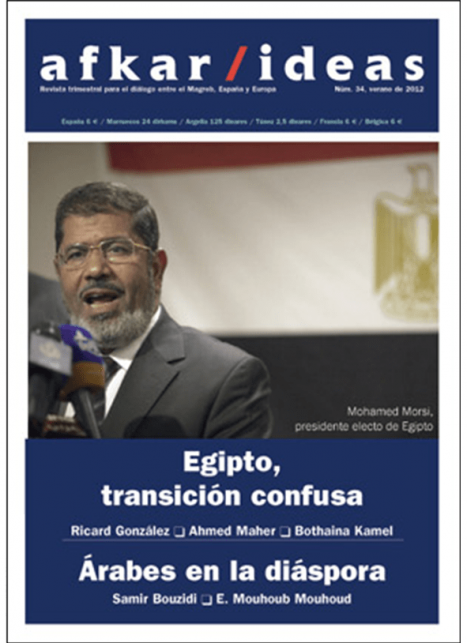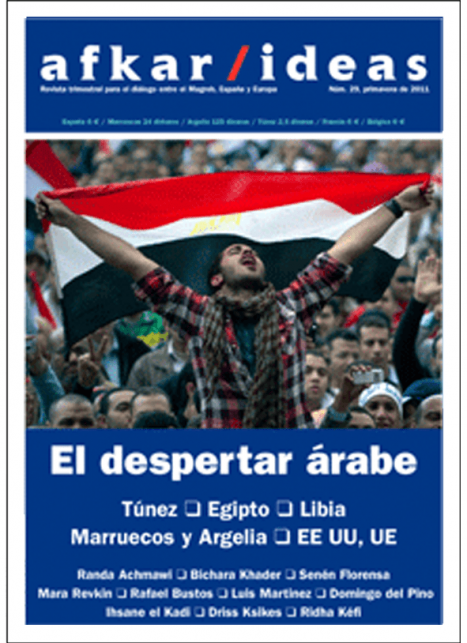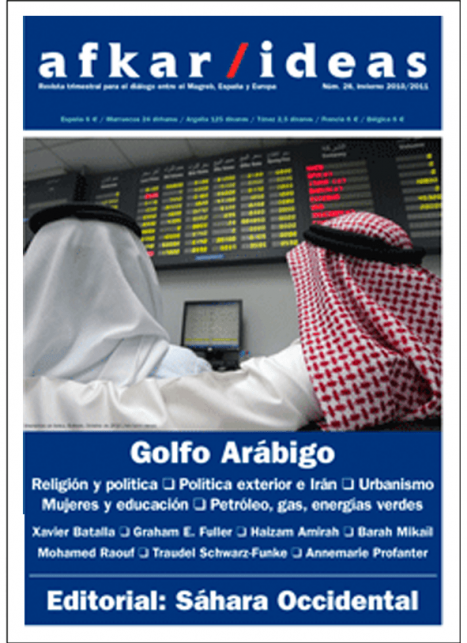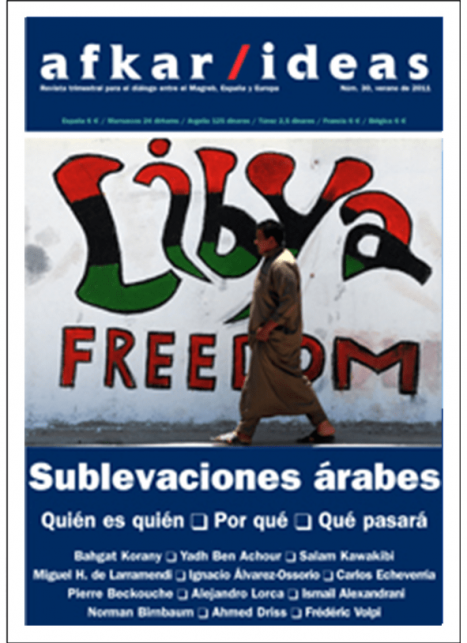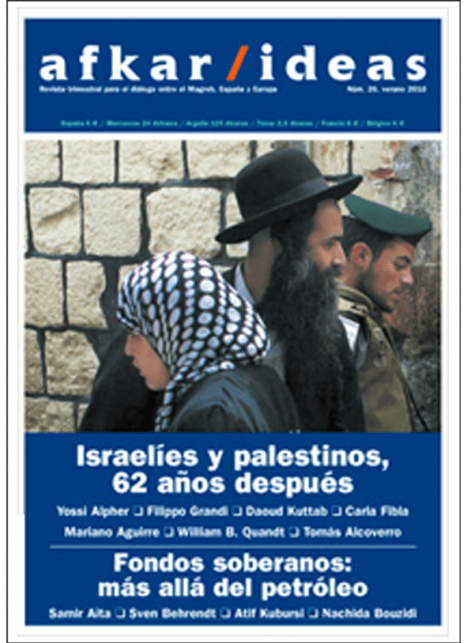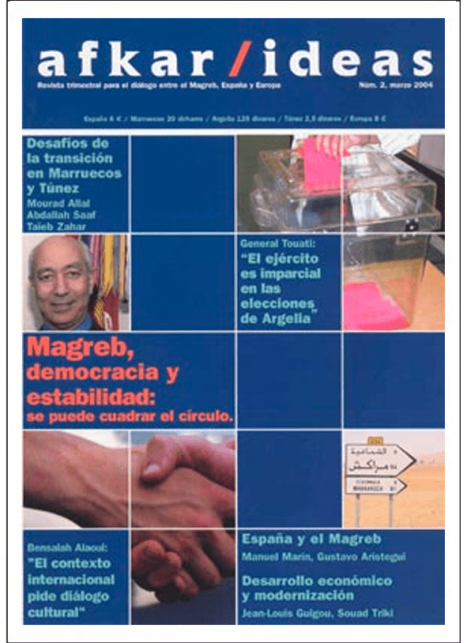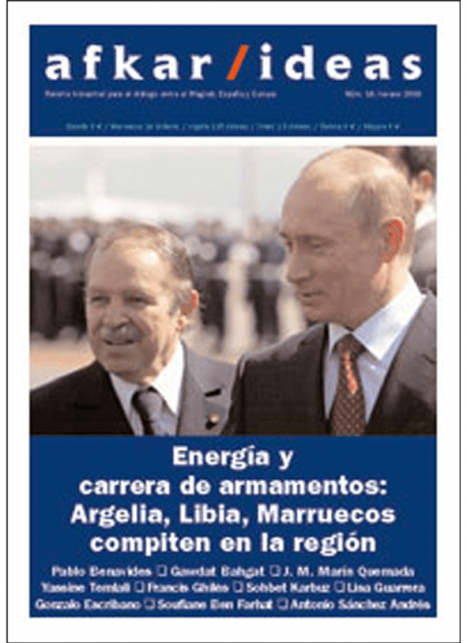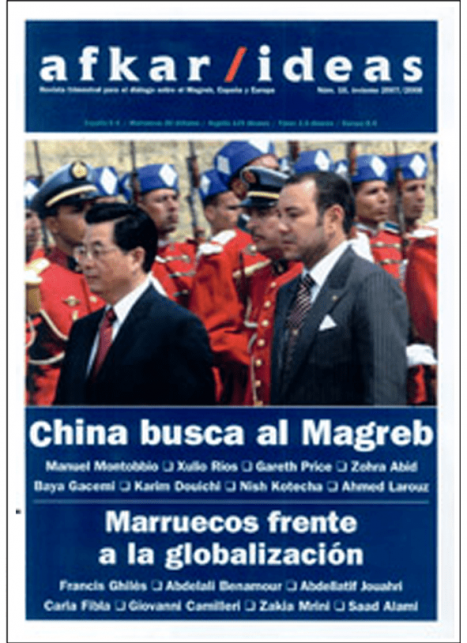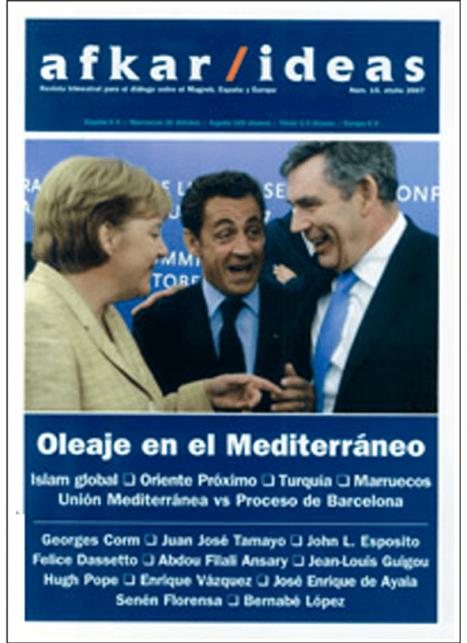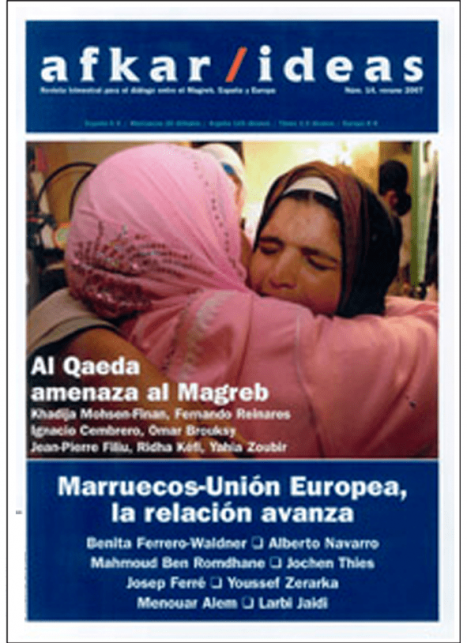Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Contre l’antisémitisme et tous les racismes: un combat solidaire
L’attaque et le massacre de 1 200 civils israéliens les 7 et 8 octobre 2023 par des commandos du Hamas et du Djihad islamique, la capture d’environ 240 otages, puis la riposte israélienne causant près de 48 000 morts (majoritairement des civils, des femmes et des enfants) et 111 000 blessés à Gaza, a causé un véritable séisme dans le monde. Car les causes de ce qu’on appelle le
« conflit israélo-palestinien » sont très anciennes et la communauté internationale pleinement impliquée. Or, cette dernière s’est montrée incapable de mettre fin à l’occupation et à la colonisation des territoires conquis en 1967 par Israël.
La situation dans ce territoire est d’ailleurs le fruit d’une double tragédie impliquant les États du monde entier et, en particulier, l’Occident : l’une créée par l’antisémitisme et sa brutalité en Europe et en Russie pendant plus d’un siècle, donnant naissance –même si ce n’est pas la seule cause– à la revendication d’un foyer national juif en Palestine ; l’autre, consécutive au partage de la Palestine en 1947 et à la guerre de 1948, causant l’expulsion de 700 000 Palestiniens ainsi que la destruction de leurs villages.
Juifs, Musulmans et Chrétiens sont divisés face aux sionismes et leur historiographie et diffèrent fréquemment. Mais il existe aussi, en particulier entre Juifs et Palestiniens, une sorte de mise en miroir permanente. D’un côté, après une période d’antisémitisme ultra-violent, le génocide des Juifs d’Europe que les Juifs qualifient de Shoah – qui veut dire « catastrophe » – intervient en arrière-fond de chaque moment de crise. De l’autre côté, pour les Palestiniens, en 1948, la Nakba, terme créé par Constantin Zureiq, c’est la catastrophe, l’exode, un évènement, mais aussi un processus continu comme en témoigne l’intensification des attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie (plusieurs centaines de morts au cours des deux dernières années) ou le projet scandaleux d’expulsion des Palestiniens de Gaza.
Voilà donc une histoire où les survivants d’un génocide issus d’un groupe ayant connu dans son histoire de nombreux exils, s’enracinent dans un pays, créant de ce fait une situation d’exil permanent pour les Palestiniens qui vivaient là depuis des siècles. Pour Elias Sanbar, ancien ambassadeur de la Palestine à l’ONU qui s’exprime sur France Inter le 15 décembre 2023, quand un enfant palestinien est tué, c’est aussi « une partie d’un sentiment, celui que nous sommes un peuple de trop, que nous n’avons pas de place… ». Quiconque a été ému, de par sa trajectoire personnelle ou pas, par l’histoire juive ne peut qu’être bouleversé par une phrase aussi tragique et aussi vraie, au point qu’on pourrait penser qu’être juif aujourd’hui, c’est se sentir palestinien.
Une vérité malheureusement bien loin d’une réalité qui est celle d’un affrontement où trop rares sont ceux et celles qui pensent cohabitation et égalité entre deux peuples malgré des souffrances, fussent-elles infligées ou non par l’ennemi actuel, mais dont la signification est universelle. Israéliens juifs et Palestiniens vivent actuellement pour nombre d’entre eux dans le même pays et ils ne sont pas séparés par des montagnes ou des fleuves. Ils vivent aussi dans la même modernité, dans la même religiosité parfois, dans la même mondialité.
Leur histoire a des répercussions mondiales : elle divise le monde politique, elle provoque des polarisations et des identifications exclusives, elle exacerbe la manipulation des imaginaires par ces entrepreneurs de haine qui pullulent sur les réseaux sociaux.

L’IMPACT DE LA GUERRE SUR LA PROGRESSION DU RACISME
L’impact de la guerre sur la progression du racisme est mondial, même si elle n’en est pas l’unique facteur. Aux États-Unis, en 2023, les discriminations et les agressions à l’encontre des musulmans et des Palestiniens ont augmenté de 56 % par rapport à l’année précédente. En octobre, un enfant américain d’origine palestinienne de six ans a été tué à l’arme blanche et en novembre, trois américains d’origine palestinienne ont été assassinés. On observe dans la même période une hausse de 203 % des actes antisémites selon la Ligue anti-diffamation (ADL), principal groupe de défense des droits des juifs.
En Allemagne, pays particulièrement sensible du fait de son histoire, le réseau CLAIM, l’Alliance contre l’islamophobie et la musulmanophobie, a constaté une augmentation de 114 % du nombre d’agressions physiques ou verbales contre des personnes de confession musulmane en 2023, par rapport à l’année précédente (1 926 incidents islamophobes en 2023 contre près de 900 en 2022). Le nombre d’actes antisémites a augmenté de plus de 80 % au cours de la même année avec 4 782 incidents antisémites en 2023 contre quelque
2 600 en 2022, selon l’Association fédérale des centres de recherche et d’information sur l’antisémitisme (RIAS, selon les sigles en allemand), qui fait référence en la matière.
En France, pour la première fois, les sympathisants d’extrêmedroite, qui restent le groupe politique le plus antisémite (51%,
alors que la moyenne est de 41%), est aussi celui qui a le moins
d’opinions négatives vis-à-vis d’Israël (33 %)
En France, pays qui compte en Europe le nombre le plus élevé de citoyens de confession musulmane (8 % de la population globale, soit environ quatre millions de personnes) et de confession juive (0,6 %, environ
500 000 personnes), l’impact est considérable. Le rapport de la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) sur l’année 2023 montre une hausse importante des actes racistes en général (+32 %), en particulier des actes antisémites (+ 284 %), mais aussi islamophobes (+29 %).
Pour la première fois, on observe une baisse de l’indice de tolérance envers toutes les minorités, plus marquée pour les juifs (- 4 points) avec une hausse des préjugés antisémites, en particulier la croyance selon laquelle « Pour les juifs français, Israël compte[rait] plus que la France » (+ 7 points). Ceci s’accompagne d’une augmentation de l’image négative d’Israël qui passe de 34 à 45 %. À noter que pour la première fois, les sympathisants d’extrême-droite, qui restent le groupe politique le plus antisémite (51 %, alors que la moyenne est de 41%), est aussi celui qui a le moins d’opinions négatives vis-à-vis d’Israël (33 %).
QUEL ROLE JOUE L’IMAGE DU SIONISME ?
À la question « le sionisme évoque-t-il pour vous quelque chose de très positif, assez positif, ni positif ni négatif, assez négatif, ou très négatif ? », une majorité des personnes interrogées (54 %) refuse de trancher (« quelque chose de ni positif, ni négatif» pour 20%, « je ne sais pas » pour 27 %, refus de répondre pour
7 %). Comme le note le rapport : « Il est donc difficile de voir dans l’antisionisme le ressort clé de l’antisémitisme contemporain, qui reste structuré par les ‘vieux préjugés’ liés au pouvoir et à l’argent. Il n’y a pas de relation statistiquement significative entre image négative du sionisme et niveau d’antisémitisme tel que mesuré dans ce baromètre. En revanche, une image négative du sionisme est associée à une image négative d’Israël, et à l’imputation de la responsabilité du conflit à Israël. »
Dans ce contexte, le débat sur le ou les sionismes, s’il est vrai qu’il recouvre toujours la question de la double légitimité israélienne et palestinienne, de son acceptation ou de son refus, peut apparaître aussi comme un débat vicié. Certes, une mauvaise opinion d’Israël peut se traduire par des préjugés antisémites ou inversement. Mais une personne peut aussi être pro-israélienne tout en étant antisémite parce qu’elle est aussi islamophobe. La manière dont s’articulent de préjugés racistes et des positions politiques est particulièrement complexe.
Quant à l’étude du ou des sionismes, elle renvoie aussi en permanence au sujet on ne peut plus confus de l’identité juive, chacun la définissant selon sa propre position politique. Par ailleurs, il existe plusieurs antisionismes : soit la critique de la politique de l’État d’Israël, soit la critique de la genèse même de la création de l’État d’Israël, son « essence », ce qui conduit irrémédiablement à occulter l’analyse des facteurs qui y ont concouru et celle actuelle, des sociétés israéliennes et palestiniennes telles qu’elles existent, telles qu’elles se vivent, avec les forces politiques qui les travaillent.
C’est donc tout à la fois un débat réducteur en ce qu’il réduit les sionismes à un aspect unique (en résumé, pour les sionistes, le sionisme est un mouvement d’émancipation, et pour les antisionistes c’est un mouvement colonialiste) et très riche, en ce qu’il réinterroge, à partir du cas d’école que représente la création de l’État d’Israël, toute une série de concepts : qu’est-ce qu’un peuple ? Qu’est-ce qu’une nation ? Qu’est-ce qu’un lien avec une terre ? Qu’est-ce que l’émancipation ?
Comment penser les territoires, les frontières, en dehors de la post-colonialité ou avec la post-colonialité tant il est difficile, voire impossible, d’imaginer redistribuer entièrement les espaces aujourd’hui.
Ce débat, on le comprend, est central pour les Palestiniens qui voient dans l’immigration de Juifs européens et dans l’ingérence de la communauté internationale un colonialisme qui leur a coûté leur terre. Ce débat est aussi interne aux Juifs qui vivent dans d’autres pays et se revendiquent de tel ou tel héritage, par exemple pour les antisionistes, du mouvement internationaliste du Bund, ou encore de penseurs antisionistes juifs laïques ou religieux qui considèrent la création de l’État d’Israël comme une trahison de l’histoire juive ou des textes bibliques. Ajoutons que les sionismes, comme tous les mouvements politiques, sont traversés par des courants différents. Ainsi, l’idée bi-nationale qui a été perçue comme « antisioniste », fait en réalité partie intégrale du, des sionismes, comme l’écrit Denis Charbit, dans « Les sionismes au 20ème siècle, entre contextes et contingences » (Revue d’histoire 2009/3, n°103).
Une mauvaise opinion d’Israël peut se traduire par des préjugés
antisémites ou inversement. Mais une personne
peut aussi être pro-israélienne tout en étant antisémite
parce qu’elle est aussi islamophobe
Quiconque définit le sioniste comme celui qui a immigré en Israël déclare, en fait, qu’aucun sioniste ne se trouve hors de ce pays. Ce qui est faux. Et que dire de ceux qui sont nés en Israël ? Seraient-ils sionistes de naissance ? Reste à savoir quel État désiraient ceux qui en soutenaient le projet. Chaque sioniste affichait sa propre vision et son programme. Le sionisme n’est pas une idéologie. Si l’on retient comme définition de l’idéologie la conjonction systématique et unifiée d’idées, de conceptions, de principes et de mots d’ordre à l’aide desquels s’incarne une vision du monde d’un groupe, d’un parti ou d’une classe sociale, le sionisme ne peut sûrement pas être tenu pour une idéologie, mais juste comme une très large plateforme de différentes idéologies, parfois même antagonistes.
Pour Denis Charbit la question n’est pas de savoir si le sionisme est une idéologie ou un mouvement politique, mais plutôt, tout en continuant à travailler sur l’histoire, de s’interroger sur les présupposés de la discussion.
Comme tous les adeptes d’un culte, les sionistes purs
et durs sont immunisés contre la logique.
Leur raisonnement est circulaire. Il se nourrit de
l’antisémitisme, il ne peut pas s’en passer
Face à l’adversité, les partisans d’un sionisme transcendant soit affirment la pureté virginale d’un mouvement qui, pourtant, a plongé les mains dans l’Histoire, soit décrètent l’absolution pour tout ce qui pourrait lui être reproché. À ce dogme d’une pureté immaculée que rien n’affecte, que rien n’altère, que rien ne trouble, répond la vérité révélée inverse et tout aussi dogmatique de ceux qui appréhendent le sionisme avec des catégories théologiques, tel le « péché originel »… Celui-ci ne relève presque pas de l’histoire, mais de la mémoire militante : mémoire malheureuse pour les uns, bienheureuse pour les autres, commémoration de la Nakba qu’il a délibérément programmé ou de la tkouma (relèvement) qu’il a préconisé sous la forme de l’État d’Israël tel qu’il existe, le sionisme n’est pas, c’est le moins qu’on puisse dire, une passion refroidie.
La notion de « sionismes » est donc intrinsèquement liée à celle d’antisionismes, positions qui ont précédé la création de l’État, y compris dans des mouvements juifs comme le Bund, puis s’est recyclée en se nouant de façon inextricable aux revendications de justice, de dignité, d’égalité pour les Palestiniens. Jonathan Cook dans un article publié le 7 mars 2024 dans Middle East Eye, constate la faillite à ses yeux du sionisme : la croyance qu’Israël est le sanctuaire qui protègera les Juifs contre les non-Juifs qui rêveraient soi-disant de se livrer à un nouveau génocide des Juifs, aurait dû voler en éclat au cours des cinq derniers mois. Si pour être rassuré – pour avoir un refuge « au cas où » – il est nécessaire de massacrer et mutiler de dizaines de milliers d’enfants palestiniens, et d’affamer des centaines de milliers d’autres, alors ce refuge ne vaut pas la peine d’être préservé. Ce n’est pas un sanctuaire, c’est un problème. C’est une tache. Il doit disparaître, pour être remplacé par quelque chose de mieux pour les Juifs et les Palestiniens dans la région, « du fleuve à la mer ». Pourquoi donc ces partisans d’Israël n’ont-ils pas été capables de parvenir à une conclusion aussi évidente sur le plan moral pour tout le monde – ou du moins pour ceux qui ne sont pas asservis aux intérêts des élites occidentales ? Parce que, comme tous les adeptes d’un culte, les sionistes purs et durs sont immunisés contre la logique. Leur raisonnement est circulaire. Il se nourrit de l’antisémitisme, il ne peut pas s’en passer. L’antisémitisme est sa source de vie, la raison même de l’existence d’Israël. Sans l’antisémitisme, les Juifs n’auraient pas besoin d’Israël, pas besoin de sanctuaire.
CRIMINALISATION DU MOUVEMENT DE SOLIDARITE ET INSTRUMENTALISATION DE L’ANTISEMITISME
Dans ce contexte de confusion évidente dans les usages des termes sionismes et antisionismes, la définition de l’antisémitisme par l’HIRA (l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste), ne fait qu’ajouter de la confusion. À juste titre les mouvements de solidarité avec les Palestiniens ont alerté sur ses dangers. Adoptée par 34 pays dans le monde, elle influe également sur des législations, la France étant actuellement en train de travailler à une redéfinition ou à des ajouts, la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui définit l’injure raciste, la diffamation, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence.
Selon la définition de l’HIRA, « le fait de nier au peuple juif son droit à l’autodétermination » est en soi, antisémite. L’IHRA dénonce également « le traitement inégalitaire de l’État d’Israël à qui l’on demande d’adopter des comportements qui ne sont ni attendus ni exigés de tout autre état démocratique ».
Cette définition à laquelle la Ligue des droits de l’Homme, la CNCDH et de nombreuses associations et intellectuels se sont opposés, est à la fois indigente et dangereuse. Elle contribue à renforcer ce qu’elle prétend combattre : l’assimilation des juifs aux Israéliens. Assimiler l’antisionisme – sans en donner de définition précise– à l’antisémitisme crée de fait un délit d’opinion politique.
Plus précise et plus opérationnelle, la déclaration de Jérusalem propose des exemples très clairs sur les cas où l’antisionisme peut être qualifié d’antisémite et les cas où au contraire : il s’agit de la liberté de critiquer la politique israélienne, ses institutions, voire sa genèse historique sur la base des principes du droit International. Cette définition permet de combattre conjointement le déni de l’antisémitisme et de son augmentation et son instrumentalisation par l’État d’Israël et ses soutiens. Dans le contexte actuel d’une guerre impitoyable menée à Gaza, en Cisjordanie et au Liban, lutter contre l’antisémitisme, c’est s’attaquer à la fois à son déni et à son instrumentalisation.
Et rappeler inlassablement que la lutte contre les racismes est indivisible./