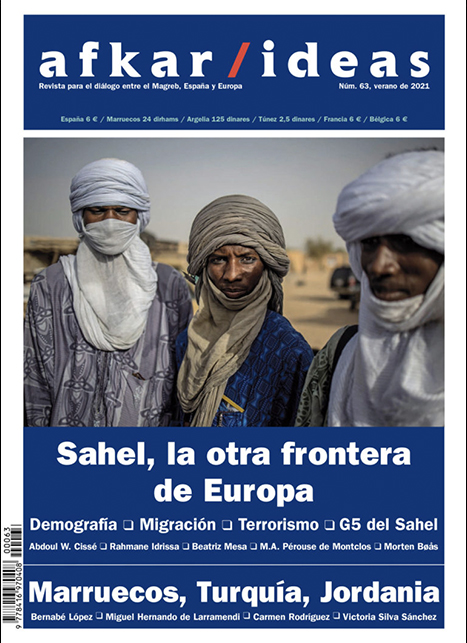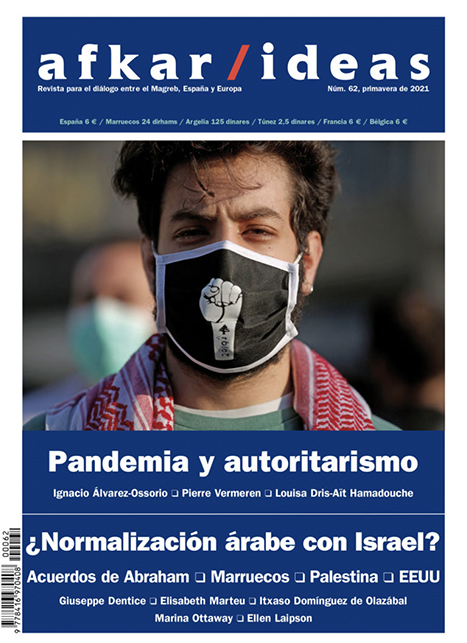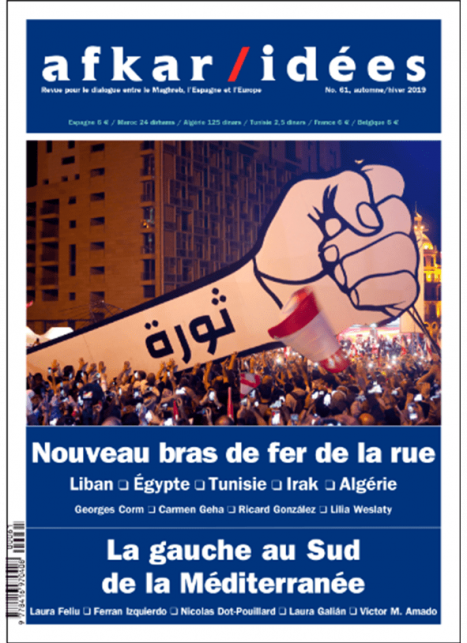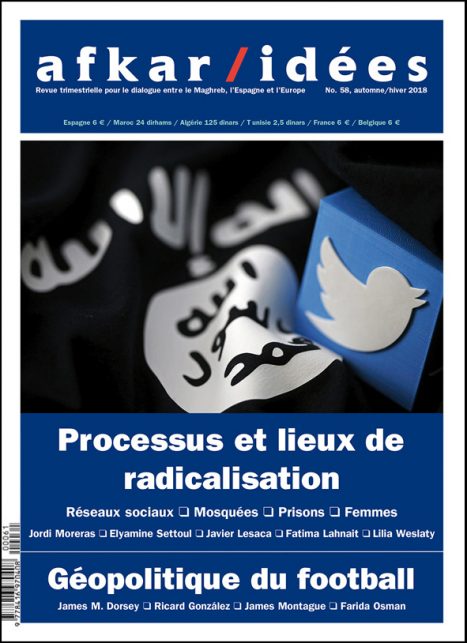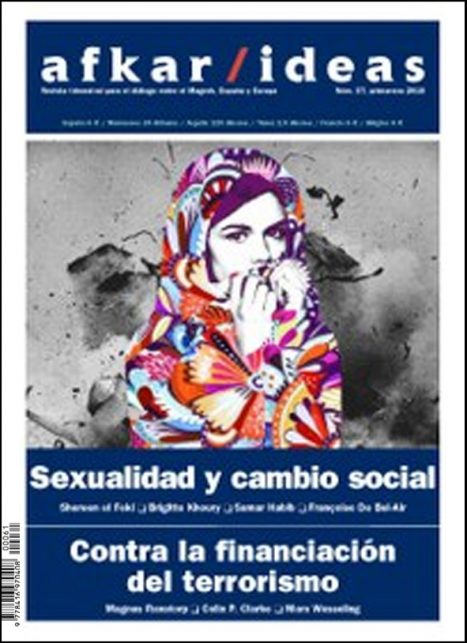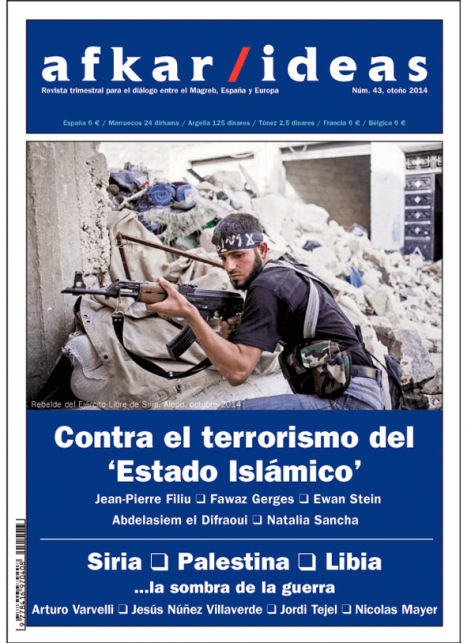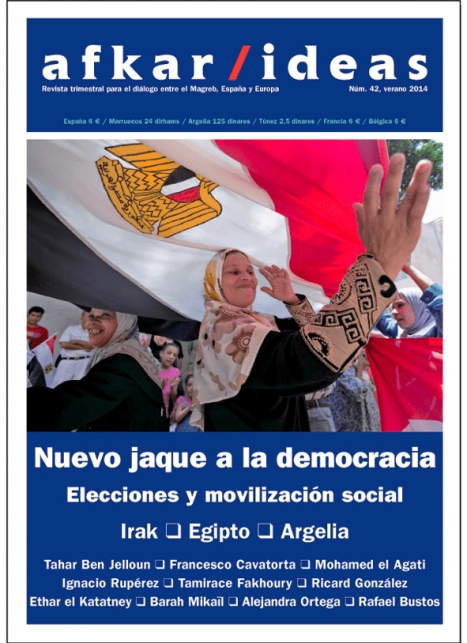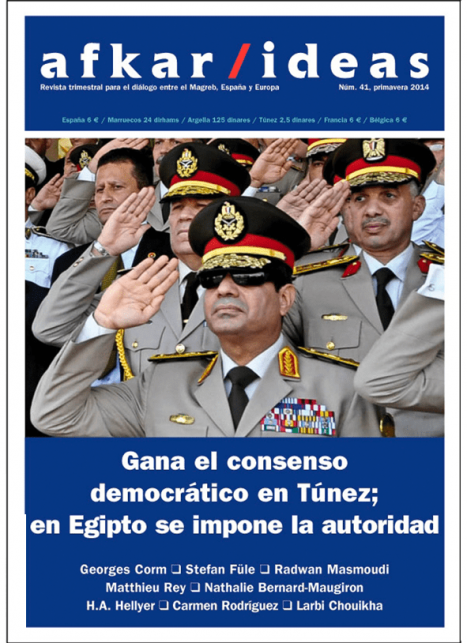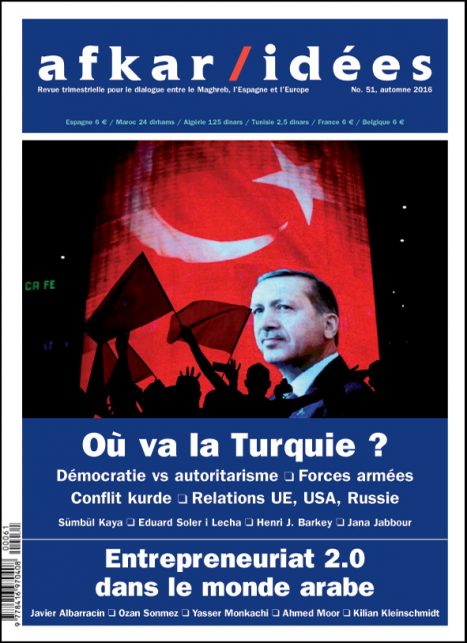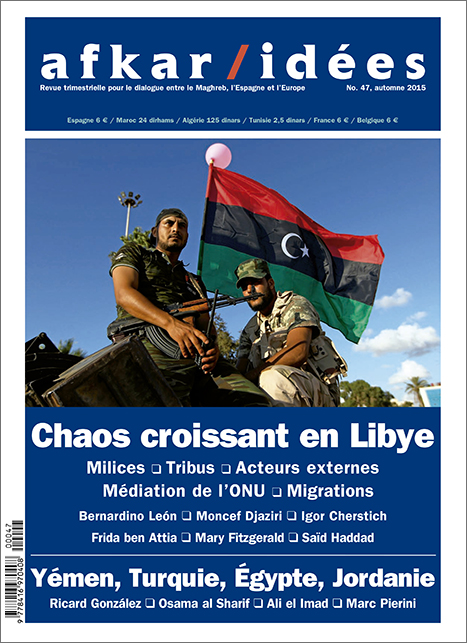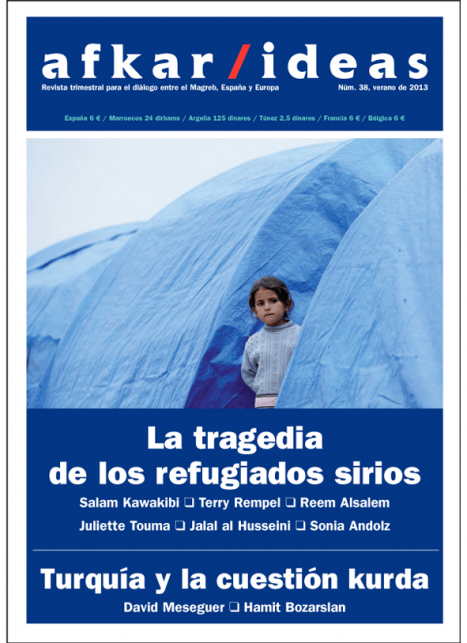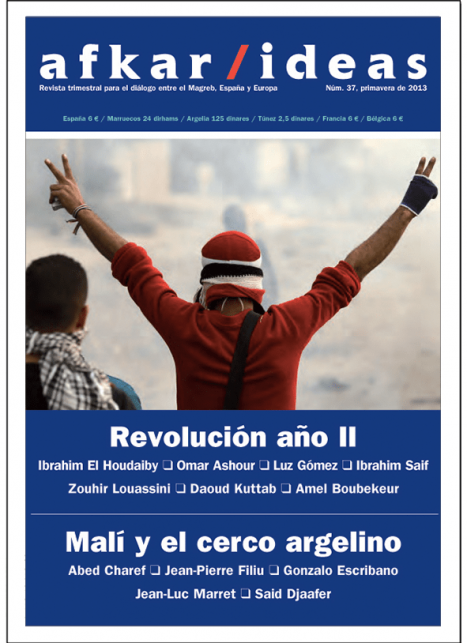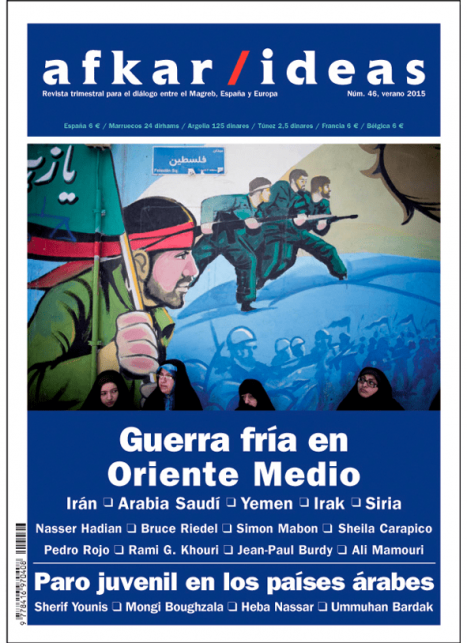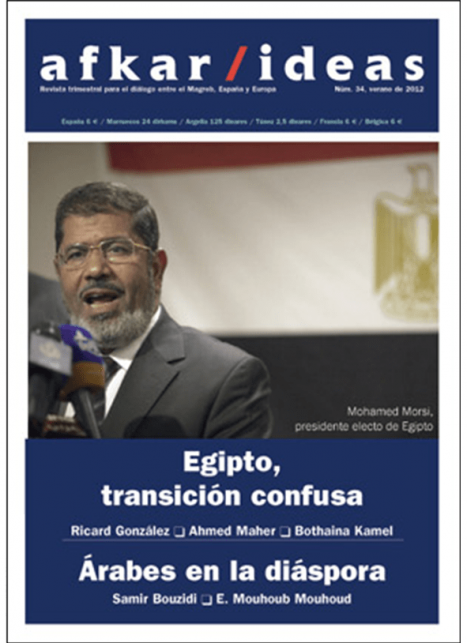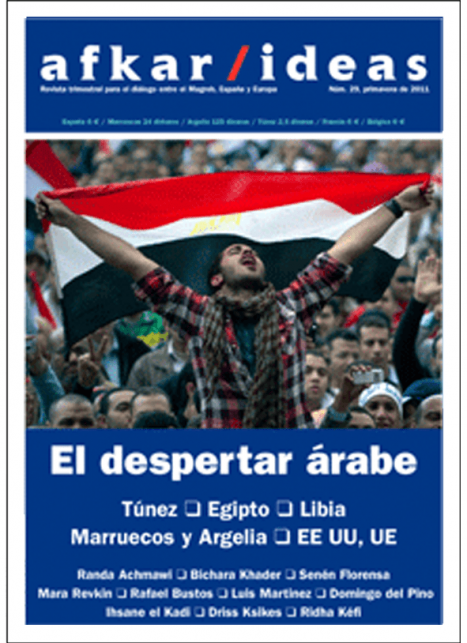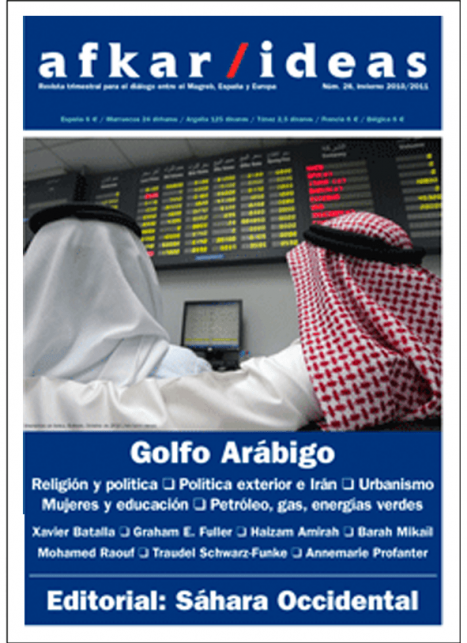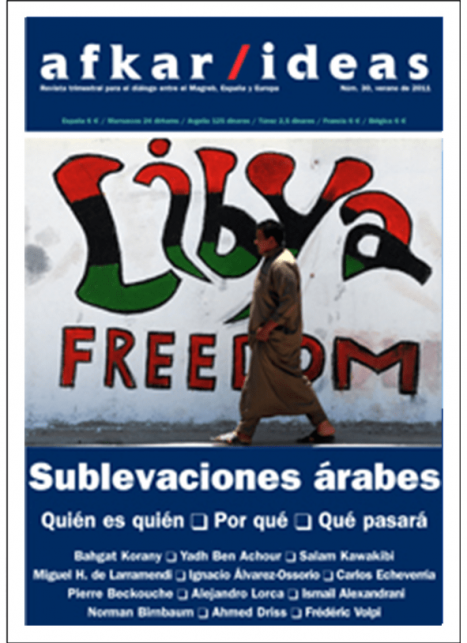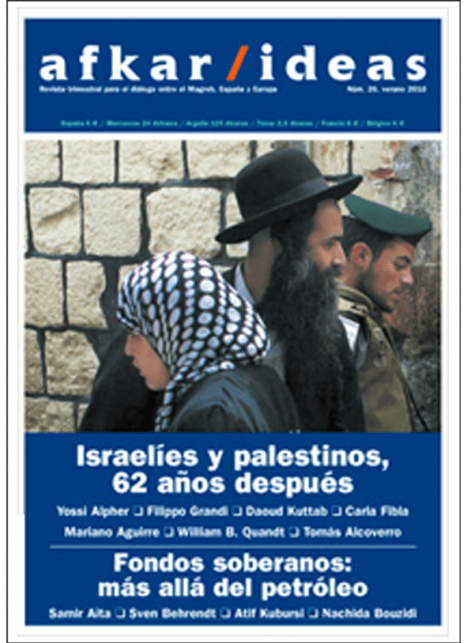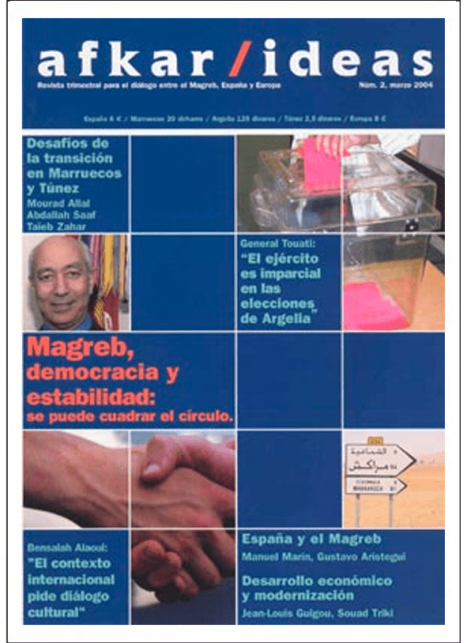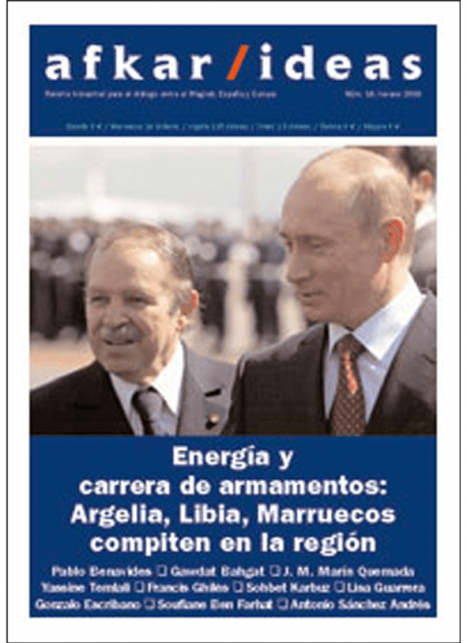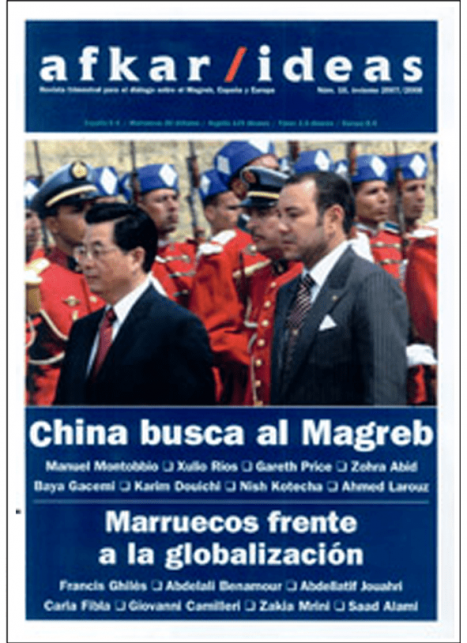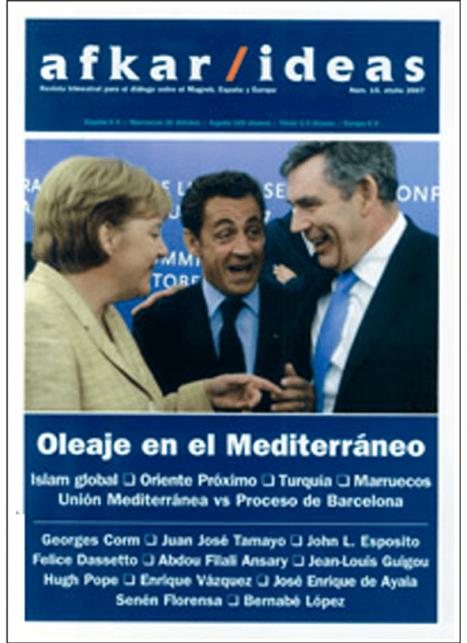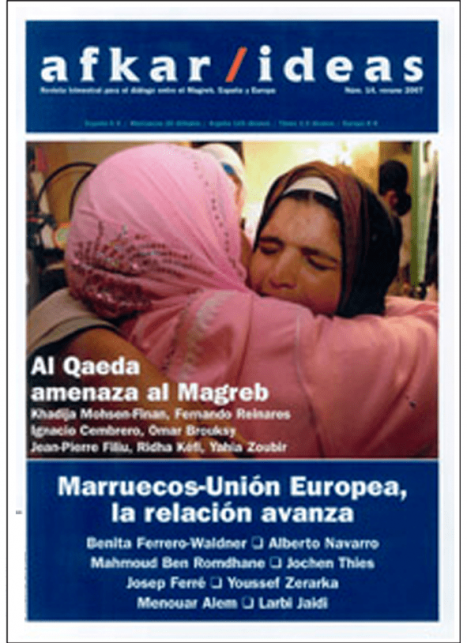Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
Co-edition with Fundación Análisis de Política Exterior
L’autoritarisme décomplexé s’impose en Algérie et en Tunisie
Le déroulement des processus électoraux qui ont eu lieu en Algérie (présidentielles du 7 septembre) et en Tunisie (le 6 octobre) met en lumière la dérive autoritaire des régimes en place, sans que cela ne suscite l’émoi de leurs principaux partenaires européens. La déconnexion normative entre l’Union européenne (UE) et ses États membres et l’évolution politique des pays du Maghreb est de plus en plus flagrante.
Les processus électoraux en Algérie et en Tunisie montrent que les régimes, bien qu’affaiblis par la contestation populaire, poursuivent leur dérive autoritaire, sans susciter l’inquiétude de l’Europe.
Les mentions ou les avertissements relatifs à la démocratie et à l’État de droit ont presque disparu des agendas diplomatiques européens lorsqu’il s’agit de relations bilatérales ou multilatérales. Il est également exclu d’envoyer des missions internationales d’observation qui pourraient un tant soit peu freiner les abus et les fraudes qui ont entaché des exercices électoraux histrioniques. Le spectacle des élections algériennes nous montre que les dirigeants sont de moins en moins soucieux de cacher les mécanismes autoritaires qui caractérisent leur gestion politique : taux de participation grossièrement gonflé, réélection du président avec 94,5 % des voix sans pouvoir cependant occulter la majorité silencieuse qui, en s’abstenant, a prolongé la protestation pacifique du Hirak – le taux de participation réel est estimé à 20 %.
Dans un contexte international marqué par le déclin de l’ordre occidental libéral et la perte d’influence de l’Europe dans un monde multipolaire où les stratégies de multi-alignement se déploient tout azimuts, les régimes maghrébins se libèrent de plus en plus des contraintes normatives et font de moins en moins de concessions ne serait-ce que formelles concernant la démocratie et les droits humains.
ALGÉRIE: UNE SCÈNE POLITIQUE DE PLUS EN PLUS VERROUILLÉE
Le verrouillage en amont du processus électoral pour sécuriser l’élection du candidat officiel est un signe de la nervosité des élites au pouvoir conscientes de la fragilité de leur légitimité. En Algérie seuls trois candidats ont pu participer : Abdelaali Hassani Cherif pour le parti islamiste Mouvement de la Société pour la Paix, Youcef Aouchiche pour le Front des Forces Socialistes et Abdelmajid Tebboune. Une volonté bien militaire de mettre de l’ordre sur la scène politique. Plusieurs candidats ont été rejetés et certains mêmes poursuivis par la justice pour fraude et achat des signatures nécessaires pour pouvoir se présenter comme candidat. Trois autres aspirants ont été soumis à des procédures judiciaires comme Saida Neghza (Confédération Générale des Entreprises algériennes), Belkacem Sahli de l’Alliance Nationale Républicaine et Abdelkrim Hamadi, un indépendant. Les conditions nécessaires pour pouvoir être candidat obligent le recueil de 600 signatures d’élus ou 50 000 signatures d’électeurs inscrits répartis sur 29 wilayas (départements).
D’autres candidats, comme Louisa Hanoune, avaient refusé de participer à un scrutin joué d’avance et sans garanties de liberté et de transparence.
Comme prévu (le second tour n’était même pas sur l’agenda), Abdelmajid Tebboune a été réélu pour un second mandat avec un score de 84,3 % des suffrages, revu à la baisse par la Cour Constitutionnelle après une première annonce affichant un score de 94,65 %.
Le cafouillage autour des chiffres de participation n’a fait que renforcer le discrédit d’élections sous contrôle et sans surprises. Les trois candidats à la présidentielle algérienne du 7 septembre 2024 ont d’ailleurs dénoncé les « ambiguïtés, des imprécisions, des contradictions, et des incohérences qui ont été relevées lors de l’annonce des résultats provisoires par l’autorité électorale, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) ». Cette polémique a permis d’occulter le chiffre le plus significatif du scrutin, à savoir un taux de participation très bas, inférieur à 25 %, après avoir annoncé un chiffre de 48,03 % basé sur les taux de participation dans les wilayas divisés par leur nombre, 58. La majorité silencieuse a infligé, comme lors des scrutins qui se sont succédé après la contestation populaire du Hirak de 2019, une lourde défaite au système politique algérien qui prétendait asseoir ou renforcer la légitimité fragile du régime en place.

Le contraste entre les formules empruntées par les médias officiels pour célébrer la victoire d’Abdelmajid Tebboune et l’expression populaire dans les stades et les réseaux sociaux sur le processus électoral témoigne d’une déconnexion croissante entre le discours officiel et la réalité populaire. Dans le stade d’Oran, le public scandait : « wallah qu’on ne votera pas, nous serons des clandestins dans les bateaux ». Le chant de désespoir des supporters de l’équipe nationale d’Algérie faisait allusion à la seule perspective migratoire dans un État qui continue à négliger sa jeunesse.
La mascarade électorale organisée en septembre risque de creuser encore plus le fossé entre le pouvoir et la population, mais fissure aussi la façade civile de la scène politique algérienne contrôlée par l’armée.
Cette dernière a renforcé son emprise sur le système politique et prend aussi de moins en moins de peine à l’occulter. La Constitution de 2020 lui confie la mission de préserver « les intérêts vitaux et stratégiques du pays » (art. 30, al. 4), comme l’indique Messensen Cherbi, et sa présence a été renforcée au sein du Haut Conseil de Sécurité qui chapeaute le processus de décision politique. À la veille du lancement de la campagne présidentielle, le décret présidentiel nº46 renforce encore ses prérogatives sur la scène politique en permettant aux hauts gradés d’occuper des fonctions importantes dans des secteurs stratégiques et de souveraineté de l’État. La visibilité de l’armée a aussi été renforcée : le chef d’État-major de l’armée, Said Chengriha, accompagne le président dans de nombreux actes publics, comme par exemple l’inauguration du stade de football de Tizi Ouzou durant la campagne électorale.
La militarisation accrue de la gestion politique a été accompagnée depuis le soulèvement populaire du Hirak par une répression de plus en plus arbitraire et sévère de l’opposition : plus de 200 prisonniers politiques ; harcèlement judiciaire des militants qui s’expriment sur les réseaux sociaux ; fermeture totale de l’espace médiatique avec la disparition de journaux importants comme Liberté et des journalistes emprisonnés comme Ihsane el Kadi (libéré le 1er novembre après une grâce présidentielle) et la dissolution de médias indépendants comme Maghreb Émergent et Radio M en avril 2023 ; dissolution d’organisations de la société civile (le Rassemblement Action Jeunesse en 2021 et la Ligue Algérienne de Défense des Droits Humains (LADDH) en 2022). Des partis politiques ont été visés par ces mesures de répression comme le Parti Socialiste des Travailleurs (PST) et le Mouvement Démocratique et Social (MDS), suspendus pour une durée indéterminée. Le cinéma a même été visé en mars 2024 par l’adoption d’un projet de loi à l’Assemblée Nationale qui prévoit des peines de prison pour les professionnels du cinéma qui ne se conforment pas aux valeurs et constantes nationales, aux références religieuses, à la souveraineté nationale, aux intérêts suprêmes de la nation et aux principes de la révolution nationale.
Depuis 2020, les autorités ont aussi restreint le droit de manifestation et, même dans le contexte marqué par les attaques du Hamas du 7 octobre et la guerre génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza, les manifestations de solidarité avec la Palestine ont été interdites. Une seule manifestation a été autorisée le 19 octobre 2023 et sous contrôle des autorités.
La répression systématique des voix de l’opposition a été facilitée par l’adoption de mesures légales comme la révision du Code pénal en juin 2021 et l’article 87-bis, qui permet de poursuivre pour terrorisme ou sabotage quiconque appelle à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. Une terminologie suffisamment vague pour pouvoir utiliser la justice afin de criminaliser l’opposition.
Cette volonté de tout contrôler et le nécessaire déploiement de toute cette panoplie d’instruments politiques et légaux pour faire taire l’opposition est aussi un aveu de faiblesse et d’épuisement des ressources de la résilience du système, comme l’indique Louisa Dris-Aït Hamadouche, ainsi qu’une déconnexion entre les élites au pouvoir et les demandes et attentes de la société algérienne. L’achat de la paix sociale, même si les revenus du gaz dans le contexte de la guerre en Ukraine ont permis de réactiver certains de ses mécanismes, ne suffit plus aux jeunes qui continuent de souffrir du chômage, du mépris de leurs dirigeants et de l’absence de perspectives d’avenir.
L’embellie de la situation économique grâce aux revenus de la rente des hydrocarbures en hausse depuis le début de la guerre en Ukraine – en 2022, les revenus des hydrocarbures ont atteint 60 milliards de dollars contre 35 milliards de dollars en 2021, ce qui représente une augmentation inattendue de 70 % – a permis à l’Algérie d’avoir une croissance du PIB à 4,2 %, des réserves de change qui atteignent les 70 milliards de dollars. Cependant, d’autres indicateurs ternissent le tableau et montrent la faible attractivité de son économie : le niveau des IDE s’est réduit de 1,1 milliard en 2020 à 870 millions en 2021 et 89 millions de dollars en 2022.
Les régions périphériques continuent d’être négligées et les déficits de gouvernance sont de plus en plus évidents au fur et à mesure que les conséquences des défis globaux, comme le changement climatique, s’accentuent. Une grave pénurie d’eau a provoqué des manifestations et des blocages de routes à Tiaret en juin 2024 face à l’absence de réponse de l’État.
Le manque d’attractivité économique de l’Algérie reste un fardeau pour l’économie du pays qui, bien qu’elle n’ait pas de dette extérieure (et s’en vante à la télévision algérienne en la comparant par exemple à la dette française), a une capacité limitée à attirer les investissements extérieurs et à diversifier son tissu économique. L’hyper-dépendance aux hydrocarbures est également un point de vulnérabilité, et les fluctuations des cours peuvent à tout moment menacer la pérennité de ces fragiles équilibres.
La rente énergétique permet à l’État d’adopter des mesures sociales qui, cependant, ont du mal à compenser l’inflation galopante et les scandales récurrents sur les prix de certains produits de base, comme le prix des sardines.
LE CAS TUNISIEN
Comme en Algérie, la dérive autoritaire s’accentue en Tunisie, alors que ce pays avait été à l’avant-garde des processus révolutionnaires de 2011. En quelques années, des avancées majeures s’étaient produites sur le plan institutionnel malgré toutes les difficultés traversées sur le plan économique et sécuritaire : célébration d’élections libres et pluralistes et mise en place d’institutions publiques et privées capables de garantir leur bon déroulement ; adoption de la Constitution de 2014, l’une des plus progressistes dans le monde arabe et s’inscrivant, comme l’affirme son préambule, dans « les objectifs de la Révolution de la liberté et de la dignité, Révolution du 17 décembre 2010-14 janvier 2011 » garantissant droits et libertés individuelles.
Le désenchantement postrévolutionnaire et le fait que ces progrès institutionnels ne se soient pas traduits par des progrès équivalents dans les domaines sociaux, ainsi que la permanence de profondes inégalités, ont favorisé la consolidation du populisme autour de la figure de Kaïs Saïed. Élu président en 2019, il jouissait d’une forte popularité parmi la jeunesse déçue par l’absence de perspectives économiques et le discrédit de partis politiques dont la légitimité a été très vite entachée par la corruption et leur incapacité à répondre aux attentes de la population.
À partir d’une interprétation populiste de l’expérience révolutionnaire tunisienne et se revendiquant de l’esprit du 17 décembre 2010 (en référence à l’immolation du jeune Bouazizi à Sidi Bouzid, événement déclencheur de la contestation populaire), le président a dévitalisé progressivement les institutions créées depuis 2011, accusant les partis politiques et les organisations de la société civile de tous les maux politiques et économiques du pays. La dissolution du Parlement le 25 juillet 2021 en s’appuyant sur l’article 80 de la Constitution et l’adoption en 2022 d’une Constitution hyper-présidentialiste ont marqué le tournant autoritaire orchestré par le président.
Cependant, cinq ans après son élection, la formule populiste du président n’a pas réussi à sortir le pays du marasme économique et le « souverainisme » économique n’a pas permis de résoudre les problèmes de chômage et d’inflation, qui poussent de plus en plus la jeunesse tunisienne sur la voie de l’immigration.
Dans ce contexte marqué par l’effritement de sa popularité, Kaïs Saïed a essayé de garantir par tous les moyens une réélection sans surprise. Le premier moyen déployé et renforcé avec le lancement de la campagne électorale a été l’adoption de mesures répressives portant atteinte aux droits, aux libertés d’expression et d’association, et intensifiant le harcèlement des opposants politiques. Ainsi, 97 membres du parti islamiste Ennahda ont été arrêtés les 12 et 13 septembre.
Comme en Algérie, la répression est devenue arbitraire, aussi bien en ce qui concerne les cibles (défenseurs des droits humains, journalistes, migrants, avocats) que les chefs d’accusation, qui s’appuient sur la notion vague de complot contre la sûreté de l’État. L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani a, elle, été condamnée mi-septembre à huit mois de prison ferme pour des propos jugés hostiles à l’égard du président.

La criminalisation des candidats potentiellement dangereux pour sa réélection a aussi été utilisée afin de réduire le nombre de candidats. L’autorité électorale en Tunisie n’a finalement retenu que trois candidats à la présidentielle du 6 octobre, parmi lesquels le président sortant Kaïs Saïed, Zouhair Maghzaoui, un ancien député de la gauche panarabe, et Ayachi Zammel, un industriel peu connu, chef d’un petit parti libéral. Ce dernier a été interpellé pour des soupçons de faux parrainages dans son dossier de candidature et condamné à 12 ans de prison. Abdellatif Mekki, ancien dirigeant du mouvement islamo-conservateur Ennahda, Mondher Zenaidi, ancien ministre du régime Ben Ali, et Imed Daimi, conseiller de l’ex-président Moncef Marzouki, également proche d’Ennahda, qui avaient pourtant été réadmis par le Tribunal administratif, ont été définitivement exclus malgré les pétitions des ONG tunisiennes et internationales et des juristes appelant l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) à respecter les décisions du Tribunal administratif. Noyautée par le pouvoir, l’ISIE n’est plus en mesure de garantir la transparence du scrutin. D’autres institutions privées qui avaient vu le jour après 2011 comme Mourakiboun ou Iwatch n’ont pas été autorisées à participer comme observatrices du processus électoral.
À quelques jours du scrutin, le 27 septembre, l’Assemblée des représentants du peuple de Tunisie a adopté une nouvelle loi qui prive le Tribunal administratif de sa compétence en matière électorale pour neutraliser l’autonomie de cette institution.
Les manifestations réunissant un millier de personnes contre le virage autoritaire du président indiquent cependant que la peur ne s’est pas complètement installée et que la société a encore son mot à dire. Beaucoup de jeunes de 20, 25 ans aujourd’hui n’avaient que 10 ans en 2011 et ont vécu toute leur adolescence dans un contexte de liberté d’expression.
L’utilisation des discours complotistes désignant des boucs émissaires répondant à des intérêts extérieurs comme responsables des maux dont souffre la population au quotidien a une efficacité limitée. Force est de constater qu’après cinq ans de pouvoir et trois ans de pleins pouvoirs, le quotidien de la population tunisienne ne s’est pas amélioré, avec un taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans atteignant 41 % au deuxième trimestre 2024 et un taux d’inflation de 7,2 % en 2024.
Dans ce contexte délétère, le poids de l’armée dans l’équation politique tunisienne s’est renforcé. Si jusqu’à présent le président tunisien a été soutenu par l’armée, certains observateurs indiquent que ce soutien pourrait se fissurer et ne fait pas l’unanimité.
Le virage autoritaire de Kaïs Saïed, comme l’indiquent Riccardo Fabiani et Michael Ayari, a des bases fragiles et l’usage de la répression est aussi, comme dans le cas algérien, un indicateur de la moindre efficacité de ses systèmes de contrôle et de vigilance de la société, en ayant détruit une grande partie des institutions intermédiaires qui permettaient une remontée de l’information : « Ce manque de connaissances granulaires limite également la capacité du système à identifier les réseaux de mécénat, à redistribuer les fonds aux circonscriptions clés et à acheter la paix sociale et la loyauté politique ».
En Algérie comme en Tunisie, on retrouve la même contradiction entre, d’un côté, les discours populistes et nationalistes souverainistes et, de l’autre, l’importance stratégique des relations externes dont ils dépendent de plus en plus pour assurer la continuité de systèmes politiques fragilisés par la contestation populaire. Le record d’abstention qui a marqué les élections présidentielles algériennes et tunisiennes est aussi un indicateur de la faiblesse de la légitimité des présidents élus. En Tunisie, le taux de participation de 28,8 % est le plus faible depuis l’avènement de la démocratie en 2011./